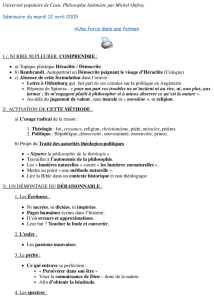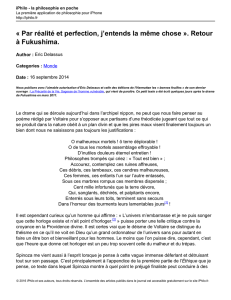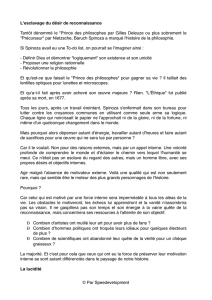Spinoza

1
Daniel Pimbé
Spinoza
Collection dirigée par Laurence Hansen-Løve
Edition numérique : Pierre Hidalgo
La Gaya Scienza, © octobre 2011

2
Table des matières
Introduction : biographie .............................................. 5
Un philosophe en exil ...................................................... 5
Pour l’indépendance de la philosophie ............................ 7
Chapitre 1 : La connaissance humaine ........................ 10
La force du préjugé ........................................................ 10
L’idée fausse ................................................................... 14
L’idée vraie ..................................................................... 16
La connaissance du premier genre : l’imagination ........ 18
La connaissance du deuxième genre : la raison ............. 22
La connaissance du troisième genre : la science intuitive24
Indications de lecture .................................................... 27
Chapitre 2 : Dieu et l’homme ...................................... 28
La substance unique ...................................................... 28
Quelques erreurs sur Dieu ............................................. 34
L’essence et l’existence des choses singulières .............. 37
Le parallélisme entre les attributs de Dieu .................... 40
Le corps humain et l’âme humaine ................................ 43
Indications de lecture .................................................... 48
Chapitre 3 : La servitude passionnelle ........................ 49

3
« Persévérer dans son être » .......................................... 49
Le désir........................................................................... 52
Les passions ................................................................... 55
Les hommes naturellement ennemis les uns des autres 58
La critique du moralisme ............................................... 60
Le problème de l’éthique ................................................ 64
Indications de lecture .................................................... 69
Chapitre 4 : Ethique et politique ................................. 70
Justification de la politique............................................ 70
L’identité du droit et de la puissance ............................. 72
La puissance du nombre ................................................ 76
Les limites du pouvoir politique .................................... 79
Le meilleur régime politique .......................................... 82
Les formes de gouvernement ......................................... 84
Indications de lecture .................................................... 89
Chapitre 5 : La libération............................................. 90
La conversion des passions en actions ........................... 90
Impuissance et puissance de la raison ........................... 93
Le remède aux affections : l’amour de Dieu ................... 97
L’éternité de l’âme......................................................... 101
L’amour intellectuel de Dieu ........................................ 104
Le salut : liberté et béatitude ....................................... 107

4
Indications de lecture ................................................... 111
Conclusion .................................................................. 113
Bibliographie .............................................................. 115
À propos de cette édition électronique ....................... 117

5
Introduction : biographie
Un philosophe en exil
Spinoza naît à Amsterdam le 24 novembre 1632, dans
une famille juive venue du Portugal jusqu’aux Pays-Bas
pour y jouir de la liberté religieuse garantie en 1579 par
l’Union d’Utrecht. Son grand-père, Baruch Michael, est le
chef de la communauté séfarade d’Amsterdam ; son père,
Michael, est directeur de l’école juive de cette ville. Pré-
nommé Baruch (« béni » en hébreu), le jeune garçon sera
appelé plus tard Benedictus (Benoît) dans les documents
latins et officiels.
Outre l’instruction essentiellement religieuse qu’il re-
çoit à l’école hébraïque de la communauté, Spinoza ap-
prend l’espagnol et le hollandais auprès de son père, qui
souhaite le préparer à la carrière des affaires. Plus tard, il
est initié aux mathématiques, à la physique et à la philo-
sophie par Van den Enden, un ancien jésuite libre penseur
qui avait ouvert une école à Amsterdam (d’où il sera chas-
sé plus tard pour athéisme) : c’est Van den Enden, proba-
blement, qui fait découvrir à Spinoza la philosophie nou-
velle, celle de Descartes.
Conduit par ses études scientifiques et ses lectures à
douter de ce que les rabbins lui ont enseigné, Spinoza tient
publiquement des propos contraires à l’orthodoxie juive.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
1
/
118
100%