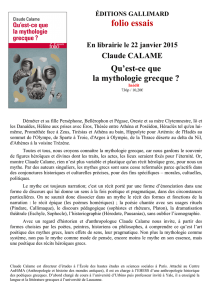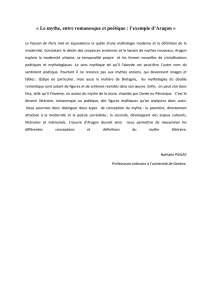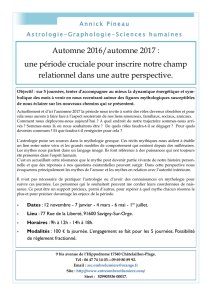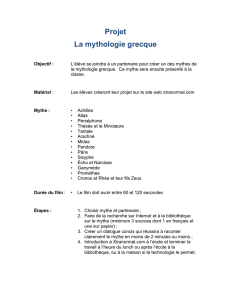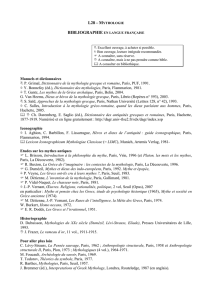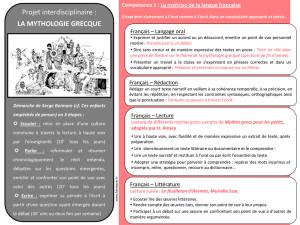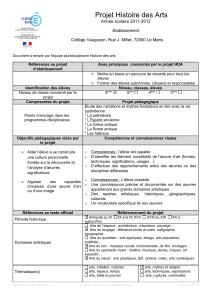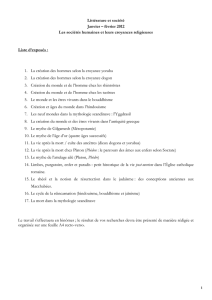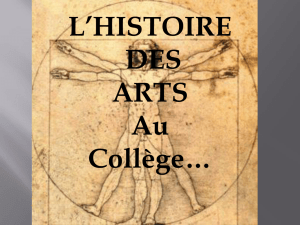PDF sample


Claude Calame
Qu’est-ce que la mythologie grecque ?
Gallimard

COLLECTION FOLIO ESSAIS

Claude Calame est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales à
Paris. Attaché au Centre AnHiMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques), il est en
charge à l’EHESS d’une anthropologie historique des poétiques grecques. D’abord chargé de
cours à l’université d’Urbino puis professeur invité à Yale, il a enseigné la langue et la
littérature grecques à l’université de Lausanne.

Avant-propos
Qu’est-ce que la mythologie grecque ?
La constitution indigène d’une mythologie (Homère, Hésiode, Orphée) ; les usages des
mythes, de la poésie chantée (Pindare) à la pédagogie (sophistes, rhéteurs) en passant par la
dramatisation théâtrale (poètes tragiques), par l’historiographie (Hérodote, Thucydide) et par
l’iconographie ; la tradition des mythes grecs (locale vs panhellénique, Alexandrie, Rome, le
christianisme) ; les origines des mythes grecs (le paradigme indo-européen, l’inuence
proche-orientale, l’Égypte) ; les approches et interprétations contemporaines : l’approche
historique, la question des relations sociales de sexe, le « mythe noir », l’interprétation
psychanalytique, le rite d’initiation, la narratologie, l’histoire des interprétations. Tels sont les
problèmes et thèmes proposés aux lectrices et lecteurs de mythes grecs par l’un de ces
recueils de savoir encyclopédique et académique que sont les Companions anglo-saxons (1).
Mais que dire des actions humaines et divines que les mythes grecs mettent en scène — ruses,
violences, meurtres, incestes, aveuglements, suicides, sacrices humains, métamorphoses,
immortalisations, etc. ? Et que dire de leurs grands protagonistes tels Œdipe, Ulysse, Médée,
Héraclès, Hélène, Antigone, Prométhée, Achille, ou Aphrodite, Héra, Artémis, Apollon et
Zeus ?
Deux aspects semblent mis entre parenthèses dans compagnons et dictionnaires de la
mythologie grecque. Se pose d’une part la question de l’inépuisable richesse sémantique et
gurée des récits que nous identions comme mythiques ; les versions multiples des mythes
grecs nous entraînent dans des mondes de création ctionnelle qui invitent à de constantes
réinterprétations, et à de puissantes recréations. D’autre part cette profusion créative assure
aux mythes grecs une remarquable ecacité sociale, religieuse et culturelle ; cette
pragmatique est fondée sur une mise en discours d’ordre poétique, avec des eets de
guration et de sens particulièrement frappants (2). Monde de ction d’une part, pragmatique
de l’autre, avec ce paradoxe : plus la polysémie d’un mythe le soumet à la recréation, plus sa
portée pragmatique semble forte. Incontournable est ici la forme poétique et esthétique : elle
transforme en parole ecace une intrigue narrative avec ses protagonistes ; ils appartiennent
à un monde de dieux et de gures héroïques et sont engagés dans des actions exceptionnelles.
Poétique au sens fort du terme par l’inventivité verbale (ou iconographique) travaillant sur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%