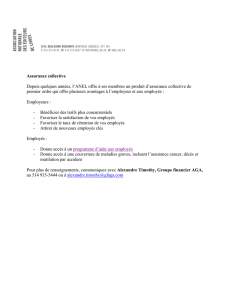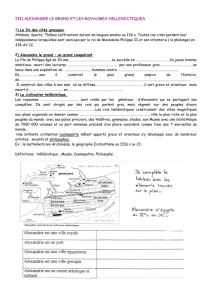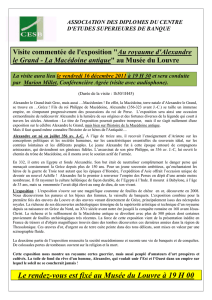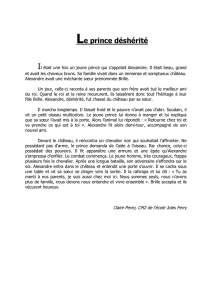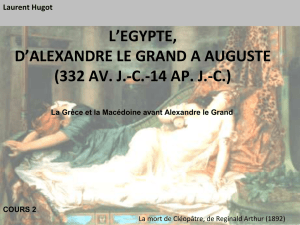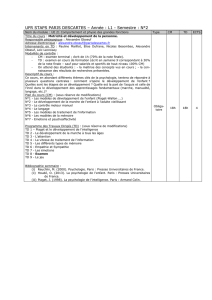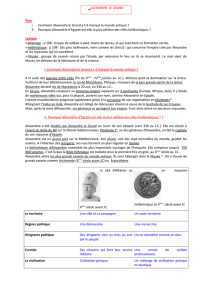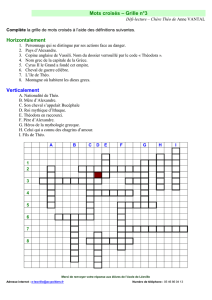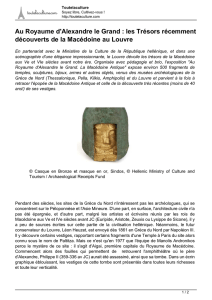La jeunesse d`Alexandre

Première partie
Alexandre bouillait de colère. Ses yeux, dont le droit était d’un noir
très foncé et le gauche bleu-vert, lançaient des flammes. Ses longues
boucles blondes, séparées par une raie médiane, frémissaient sur sa tunique
de pourpre. Près de lui, vêtu d’une tunique verte, les cheveux noirs aussi
bouclés et les yeux bleus, Ephestion, son inséparable, partageait son
courroux. Ils étaient nés le même jour de la même année, il
y
avait quinze
ans. Leur beauté était différente, comme leur taille
:
Alexandre était plus
viril et Ephestion plus grand. Arrivés la veille
à
Olympie, ils étaient ce
matin, au lever du jour, dans l’hôtel de ville, en face du comité olympique.
Derrière les dix juges, ils apercevaient l’ennemi de la Macédoine, qui
prétendait faire exclure des jeux l’attelage du roi Philippe venu concourir
pour les grands jeux
:
l’Athénien Démosthène, le fils du fabricant de
.
couteaux de Péanie, village de l’Attique.
Cet orateur de quarante-cinq ans, aux traits sévères,
à
la barbe en
pointe,
à
l’aspect disgracieux, mais dont l’éloquence était irrésistible, avait
convaincu les juges que le père d’Alexandre, en assiégeant Périnthe et
Byzance, villes alliées d’Athènes, avait rompu le traité de paix signé avec
elle et violé la trêve olympique.
((
Ce barbare, avait-il dit, ce destructeur de
villes grecques, sorti d’un pays misérable qui ne put jamais fournir
seulement un bon esclave, a déjà usurpé la présidence des jeux Pythiens et
il cherche
à
mettre la main sur ceux d’Olympie, par l’intermédiaire de son
fils. Renvoyons ce gamin
à
Delphes,
où
il pourra danser nu quelque danse
lascive en l’honneur du dieu. Nous n’avons que faire ici de ses chevaux, de
ses cochers, de ses soldats et de son mignon. Que le comité olympique se
montre digne de Jupiter Olympien
:
qu’il restaure les lois de la Grèce et

ROGER PEYREFITTE
8
donne une leçon
à
cette dynastie qui en est le fléau.
1)
Par six voix sur dix, le
conseil s’était rallié
à
cet avis.
((
Infâme! s’écria Alexandre, qui tendait le bras vers Démosthène
comme s’il tenait une épée. Toi que, depuis ton enfance, on surnomme
((
Derrière », tellement tu as abusé de ton corps! toi qui as installé ton
mignon Cnosion au domicile conjugal et que ta propre épouse fait cocu avec
lui
!
Toi qui as ruiné Aristarque, dont tu étais l’amant et dont tu soutirais
l’argent, même lorsqu’il eut été exilé
!.
.
. Est-ce que tu t’es prostitué jadis
à
ces vénérables juges pour les avoir trompés
à
ce point?
1)
Le comité
olympique sourit de ces mots avec indulgence.
((
Le petit jeune homme de
Pella n’a pas l’éducation athénienne
»,
fit Démosthène ironiquement.
Alexandre tapa du pied avec rage, contre le sol de marbre, mais il avait
pâli
:
Démosthène le touchait au point sensible en citant le nom de la
caoitale de la Macédoine, qu’il avait qualifiée, dans un de ses discours, de
((
bourgade chétive et inconnue
».
Voyant l’effet produit, l’orateur voulut
le renforcer
:
((
Citoyens juges, ajouta-t-il au comité, pardonnez
à
ce gamin
de contester vos suffrages. Les barbares n’ont pas l’habitude de la
démocratie.
-
Chien
!
dit Alexandre. Tu oses répéter en ma présence l’injure que
tu as adressée
à
mon père
!
Je descends d’Hercule par lui et d’Achille par
ma mère, qui est sœur du roi d’Epire et des Molosses, et ta mère
à
toi
descend d’un barbare, d’un Scythe! Et c’est Hercule qui a fondé les jeux
Olympiques.
-
Je reconnais, fit Démosthène avec
la
même ironie, que mon
ascendance est plus facile
à
prouver que la tienne. Hercule et Achille
à
part,
ni
les Molosses
ni
les Epirotes ni les Macédoniens n’étaient considérés
comme Grecs au temps de Périclès et n’étaient admis aux jeux Olympiques.
-
Menteur! dit Alexandre qui ne pouvait commencer toutes ses
réponses que par une violente exclamation. Le roi d’Epire, Tharypas,
arrière-grand-oncle de ma mère, eut la citoyenneté d’Athènes, comme mon
ancêtre paternel, le roi de Macédoine Alexandre
Ier,
qui portait le surnom
d’Ami des Hellènes, et c’était au temps de Périclès.
-
I1
n’était donc pas un Hellène, dit l’orateur.
-
Insolent! répliqua Alexandre.
I1
vint concourir en personne
à
Olympie, prouva qu’il était Argien d’origine et arriva second
à
la course du
stade. Enfin, un cheval de mon père remporta le prix, le jour même de ma
naissance. Un de ses chars avait précédemment gagné.
-
C’est vrai,
ô
Alexandre, dit un des juges, et Démosthène s’est
trompé.
-
Son ignorance est égale
à
son impudence, dit Alexandre. Héro-
dote, qui
a
lu son
Histoire
aux jeux Olympiques,
y
écrit expressément, au
sujet du premier Perdiccas, du premier Amyntas et du premier Alexandre
de Macédoine
:
((
Ils se disent Hellènes et je suis en mesure de savoir que

9
La
jeunesse d’Alexandre
c’est vrai et je le démontrerai.
))
Et
il
le démontre,
ô
Démosthène, Scythe
de Péanie.
n
Le comité pria l’orateur de s’éloigner vers le fond de la salle et délibéra
à
voix basse. Ephestion s’était agenouillé pour renouer le lacet de cuir d’une
des sandales d’Alexandre, qui s’était défait quand il avait tapé du pied. Le
jeune garçon reformait amoureusement l’entrelacs rouge sur le cou-de-pied
et sur la cheville, puis sur le bas de la jambe. Au-dessus du dernier tour, un
triple cercle d’or serrait le mollet. Un cercle semblable serrait la jambe
d’Ephestion, qui baisa celle d’Alexandre, avant de se relever. Les deux
amis s’étaient apaisés
:
ils comprenaient que la défaite de Démosthène se
préparait.
Celui-ci le comprit également.
((
Méfie-toi, fils de Philippe, cria-t-il du
fond de la salle, tu n’es qu’un lionceau et votre ami Eschine m’appelle un
lion.
1)
Le nom de l’orateur rival de Démosthène et représentant des
intérêts de Philippe
à
Athènes, retentit comme un autre signe de bon
augure pour la Macédoine
:
leurs joutes dans l’assemblée du peuple, sous
les murs de la citadelle, étaient fameuses et Démosthène n’avait pas été
constamment le vainqueur. La voix limpide d’Ephestion éclata. La
noblesse de sa naissance et ses sentiments pour Alexandre lui inspiraient
peut-être encore plus de mépris et de colère qu’à lui.
((
Fils de coutelier, cria-t-il
à
l’adresse de l’illustre Athénien, tu es un
lion en paroles et Alexandre sera un lion en action. Tu ignores sans doute
que, lorsque sa mère était enceinte de lui, Philippe rêva qu’elle avait sur le
ventre le sceau d’un lion. Le devin Aristandre de Telmesse interpréta ce
songe en disant que l’enfant qui naîtrait, aurait, comme son ancêtre
Achille, un cœur de lion.
n
Pour le remercier, Alexandre baisa Ephestion sur
la
bouche.
I1
s’enorgueillissait de ce rêve de sa mère, parce que celle de Périclès avait
rêvé qu’elle enfantait un lion. Mais Alexandre comptait bien dépasser la
gloire de Périclès.
((
Citoyens juges, déclara-t-il, j’ai oublié de dire quelque
chose
:
le roi, mon père, m’avait prié de vous annoncer qu’en souvenir de
ses deux victoires,
à
la course des chars et
à
la course
à
cheval, aussi bien
que pour commémorer les victoires de ses armes, il construirait un
monument de notre famille dans l’enceinte de votre sanctuaire. Les plans
en sont déjà faits. Ce sera une rotonde
à
colonnades, avec cinq statues
grandeur nature, en
or
et en ivoire, la sienne, la mienne, celles de ma mère
Olympias, de mon grand-père Amyntas et de ma grand-mère Eurydice.
Elles sont déjà commandées
à
Léocharès, et elles iront
à
Delphes, si elles ne
peuvent plus venir
à
Olympie.
v
L’argument parut d’un autre poids que la question de savoir
si
Philippe avait rompu ou non la trêve olympique. Le chef des juges
se
pencha vers ses collègues pour leur parler
à
l’oreille; puis, malgré les
protestations de quelques-uns, il dit
à
Alexandre
:
((
Les suffrages que nous

ROGER PEYREFITTE
10
avons exprimés, n’ont pas été pris sur l’autel, ce qui ne leur a pas conféré
un caractère sacré. Après avoir invoqué le dieu et fait un second sacrifice,
nous allons effectuer un second vote, pour lequel ne nous manquera pas sa
lumière et devant lequel, par conséquent, tous devront s’incliner.
-
Je
l’accepte d’avance
))
dit Alexandre, en jetant
à
Démosthène un regard
ironique. L’Athénien devina qu’il avait perdu la partie
;
mais il dissimula sa
fureur, pour ne pas compromettre la faible chance d’un sursaut de dignité
chez les juges.
((
Je souhaite, leur dit-il seulement, que le dieu soit aussi
favorable
à
l’honneur de la Grèce et au vôtre que la première fois.
))
Malgré ces mots piquants, il lui était difficile de rien ajouter sans
provoquer de nouvelles réactions d’Alexandre.
I1
lui était impossible, en
tout cas, de s’élever contre un argument, même spécieux, d’ordre
liturgique. Alexandre, sur les lèvres de qui était revenu le sourire, voulut
achever d’écraser son adversaire par l’étalage de sa richesse, sous le couvert
de la religion.
((
Je suppose que cet homme, dit-il en le désignant, m’a
devancé pour invoquer le dieu. C’est maintenant
à
moi de faire un triple
sacrifice qui précédera le second vote et, si mon char gagne la course, je
sacrifierai cent bœufs
à
Jupiter. Ce seront vraiment cent baeufs, comme me
l’a commandé mon père, et non pas cent bœufs de nom, ainsi que dans les
hécatombes célébrées
à
Athènes,
où
il n’y en a que dix et parfois un seul.
-
((
Les Grecs, disait Démarate
à
Xerxès, sont pauvres, mais
vertueux
»,
rétorqua Démosthène.
-
Tu en es bien une preuve, dit Alexandre, toi qui es cousu d’or et de
vices.
-
Va, fils de Philippe, dit le chef des juges. Tu as tout loisir, car
notre cérémonie,
à
laquelle nous devons seuls participer, sera aussi longue
que la tienne.
n
Tant de déférence envers Alexandre indiquait déjà que le vote était
acquis et que l’on aurait pu s’en dispenser. Démosthène, prenant un pan de
son manteau avec sa main aux doigts chargés de bagues, se couvrit la tête
à
demi, en signe de deuil, et quitta la salle par une porte dérobée.
((
Vite, par Hercule! dit Alexandre
à
son petit esclave et
à
celui
d’Ephestion. Allez chercher nos tuniques blanches pour le sacrifice.
))
Les
deux garçons, Epaphos et Polybe, qui avaient le même âge que leurs
maîtres, et qui avaient entre eux la mê:me intimité, leur étaient dévoués
plus que personne
:
quand des marchands d’Asie mineure vinrent les
vendre
à
Philippe, son fils, qui avait donné l’un d’eux
à
son ami, avait
refusé de les laisser marquer au fer rouge. Ephestion et lui les aimaient
bien, comme de jolis animaux domestiques.
La maison de leur hôte Cléotime était toute voisine de l’enclos du
sanctuaire, près de la colline de Saturne. Ce riche marchand, l’un des
principaux citoyens de l’Elide, avait visité, dans sa jeunesse, la cour de
Macédoine et avait été le mignon de Philippe. C’est la première fois qu’il

11
La
jeunesse
d’Alexandre
revoyait Alexandre depuis
son
enfance et il lui vouait une adoration, égale
à
celle qu’il avait eue pour son père.
I1
avait été aussi indigné que lui en
apprenant le mauvais tour que leur jouait Démosthène et dont la
notification avait été faite
à
Alexandre la veille au soir, quand il était arrivé.
Or, les chevaux de Philippe étaient, selon la règle, entraînés
à
Olympie
depuis un mois.
La
manigance avait été préparée
à
l’insu de tous et le
résultat en avait été différé au dernier moment pour le rendre public devant
la Grèce réunie. Jaloux de la fortune de Cléotime, les juges lui avaient gardé
le secret. Alexandre avait voulu leur répliquer sans le secours de personne,
afin de montrer que, dans un lieu
où
il n’était jamais venu, il n’avait besoin
que de son nom et de la gloire de son père.
I1
avait même refusé d’être
accompagné de son ancien précepteur Léonidas, cousin de sa mère, lequel
lui servait de guide dans ce voyage. Celui qu’Alexandre et Ephestion
affublaient de l’épithète de
((
grave
»,
comme celles des héros d’Homère,
était resté chez Cléotime avec les soldats de l’escorte.
Tout courant, Epaphos et Polybe arrivaient. ils retirèrent
à
leurs
maîtres les tuniques de couleur. Selon son usage, Epaphos s’exclamait avec
admiration devant une nudité qu’il pouvait cependant contempler plu-
sieurs fois par jour.
((
Que tu es beau, mon maître
!
disait-il. Tu descends
d’un dieu, tu es un dieu et tu seras un dieu.
))
A
quelque distance, le comité
olympique, qui attendait, pour sa propre cérémonie, le départ
d’
Alexan-
dre, regardait cette scène avec intérêt. Ce qui plaisait
à
Alexandre et
à
Ephestion, c’est qu’ils étaient solides comme des athlètes et qu’on pouvait
les appeler beaux sans les faire rougir. Epaphos et Polybe avaient apporté
aussi des sandales
à
lacets blancs.
I1
leur fallut un moment pour nouer ces
lacets, puisqu’ils faisaient le nœud d’Hercule. C’est l’ancêtre d’Alexandre
qui en était l’inventeur
:
il
y
avait deux boucles, dont l’une passait en
dessus et l’autre en dessous du cordon. Ephestion avait procédé plus
sommairement pour le lacet rouge d’Alexandre
;
mais la différence, c’est
qu’Epaphos ne prenait pas la liberté de lui baiser le mollet.
Ils sortirent.
((
Tes cent bœufs, dit Ephestion
à
Alexandre, ont mis en
déroute l’armée athénienne. Je crois que ce qui a le plus humilié
Démosthène, c’est ton allusion
à
l’imposture des hécatombes.
-
Voilà ce
que c’est d’avoir pour précepteur Aristote, dit Alexandre
:
nous sommes
bien renseignés sur les Athéniens. Quelle chance que mon père leur ait
enlevé le plus grand de leurs philosophes, pour le restituer
à
la Macédoine
dont il est originaire!
))
L’allée
où
ils marchaient d’un pas léger bordée de chênes, de
peupliers et de statues, menait au temple de Jupiter. C’est là, au bas des
marches, que les trois grands prêtres en exercice, avertis de la célébration
demandée par Alexandre, l’attendaient pour le conduire
à
l’autel. Malgré
l’heure matinale, il
y
avait déjà beaucoup de monde. Les jeux ne devaient
commencer que dans quelques jours, le lendemain de la pleine lune de
 6
6
 7
7
1
/
7
100%