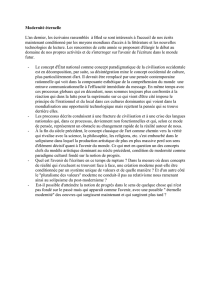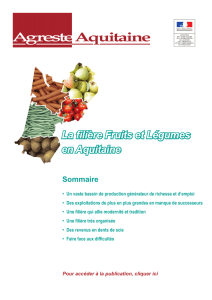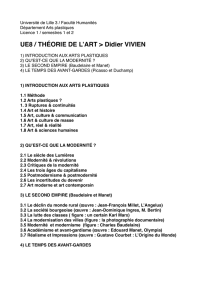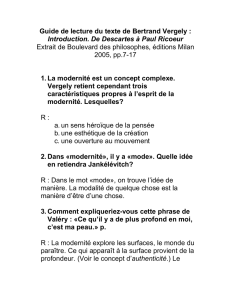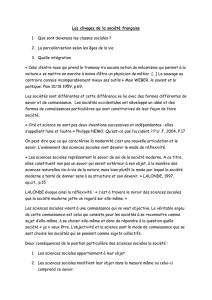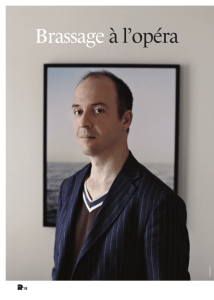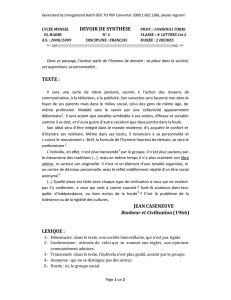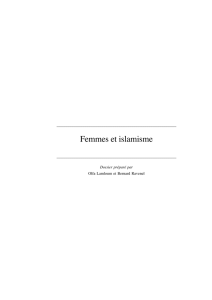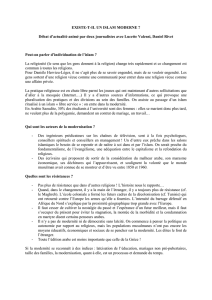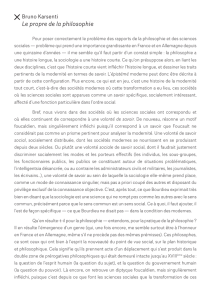Florence RUDOLF MSCS 16 : Approches sociologiques de la

Florence RUDOLF
MSCS 16 : Approches sociologiques de la modernité
Notes de lecture
La sociologie peut-elle produire des analyses complètes sur la modernité ? Cette
question confirme la thèse de Niklas Luhmann selon laquelle les
communications sociales demeurent en deçà de la forme qu’elles prétendent
couvrir, voire celle de Max Weber selon laquelle la science demeure une
entreprise inachevée. C’est encore cette question qui figure en introduction de
l’ouvrage de Peter Wagner. Dans ce cadre, elle confirme une des vocations de la
sociologie comme mode d’auto-observation de la modernité. Selon cette
définition, la sociologie accompagne la modernité à la manière d’un dispositif
de régulation de la modernité. Cette fonction est activée en période de crise :
«Une telle mise à distance devrait s’avérer plus facile dans les périodes de
doute et d’interrogation que dans les périodes de certitude. C’est en de telles
conditions qu’écrivirent les sociologues “classiques” tels que Max Weber ou
Émile Durkheim ; et le débat sur la postmodernité, parmi bien d’autres signes,
indique que notre situation est analogue», (Wagner, 1996, 9).
Régulièrement, la modernité est confrontée à des crises par rapport
auxquelles la sociologie l’assiste. À ce titre, la sociologie sert de dispositif de
pilotage de la modernité : elle s’avère une institution de régulation de la
modernité. Cette observation est confirmée par les différents courants de la
sociologie, qu’ils se rangent dans la tradition positiviste ou critique. Les théories
de la modernité se présentent comme des guides de l’action. La récurrence des
crises est indissociable de l’ambiguïté de la modernité. Cette dernière est ancrée
dans un rapport à l’action : elle est tributaire de la marge de manœuvre de
l’action humaine. «La compréhension de la capacité d’action humaine doit être,
selon moi, au centre de la théorie sociale», (Wagner, 1996 : 12). Comme
l’intitulé de l’ouvrage de Wagner en témoigne, la modernité est travaillée par le
couple formé par la discipline et la liberté, soit encore par l’opposition entre
l’organisation, l’ordre, la néguentropie et le chaos, le désordre et l’entropie. «Le
double concept de liberté et de discipline (…) saisit l’ambivalence de la
modernité selon trois dimensions essentielles : les rapports entre la liberté
individuelle et la vie collective, entre la capacité d’action humaine et la
contrainte structurelle, entre les existences concrètement situées et les règles
sociales d’ensemble» (Wagner, 1996 : 13). Entre des structures contraignantes
et des actions habilitantes quel est l’espace de la transformation des sociétés
modernes ? Comment peuvent-elles effectivement s’inscrire dans l’avenir et
dans le monde ? «On a souvent caractérisé la condition moderne par la liberté
et la démocratie, assurées par des institutions fondées sur le principe de libre
association. Les principales de ces institutions sont le régime politique
démocratique, l’économie de marché admettant la liberté du travail, et la

science comme quête illimitée de la vérité. À ce discours autoproclamé de la
modernité, depuis longtemps largement répandu, a cependant vite répondu une
interprétation alternative et critique, opposant à l’image d’une libération par
les institutions modernes celle de leur effet disciplinaire. Toute l’histoire de la
modernité est marquée par ces deux discours, qui le plus souvent sont restés
séparés : chaque observateur choisissait entre l’une ou l’autre de ces images et
généralement aussi entre l’approbation ou la condamnation de la modernité.
Seuls de rares penseurs, tels Karl Marx ou Max Weber ont su lire en celle-ci
une ambiguïté fondamentale – et reconnaître une foncière ambivalence dans
leur propre attitude vis-à-vis de la condition moderne», (Wagner, 1996 : 13).
Lorsqu’on s’intéresse à l’impact de la crise écologique sur la modernité,
on est directement confronté à cette tension. L’appel à la nature et à l’écologie
résonne, en effet, comme un rappel à l’ordre et à l’ensauvagement (Moscovici,
2001). Outre des explications structurelles, cette tension est l’expression de
l’autonomie et du pouvoir qui en résulte. Pour prétendre être en mesure de se
gouverner et d’orienter l’action encore faut-il être en mesure de se contraindre.
Le pouvoir est indissociable d’une certaine maîtrise, voire du développement de
forces susceptibles de s’opposer à des tendances adverses. «La modernité met
l’accent sur l’autonomie des gens, sur leur droit et leur devoir de se gouverner
eux-mêmes, mais sans leur fournir aucun conseil sur la manière de concevoir
ces règles ni de savoir avec qui s’accorder en cette matière. (…) À peu près
toutes les grandes controverses politiques ont à chaque moment tourné autour
du droit des individus à se définir eux-mêmes leur situation et leurs possibilités
d’action, ainsi que des bornes et des droits de l’ensemble politique dont ces
individus font partie. Depuis l’avortement ou les manipulations génétiques
jusqu’aux problèmes d’immigration, de nationalité ou de droits civiques,
jusqu’à la définition des États-nations tant en Europe occidentale que dans les
anciens pays socialistes, les incertitudes et les angoisses découlent du sentiment
fondamental que dans le monde moderne, les gens ont non seulement la
possibilité mais le devoir de se donner eux-mêmes leurs règles d’existence.
L’historicité de la vie sociale humaine constitue la forme générale et le cadre de
l’autodétermination. Nul ne saurait créer des règles ab nihilo, dans le vide»,
(Wagner, 1996 : 14).
L’ambivalence de la modernité est indissociable de la convergence entre
une situation sociale créatrice de liberté et par définition déterminante. Cette
convergence est au centre de la théorie de la structuration d’Anthony Giddens, à
laquelle se réfère également Peter Wagner. «Voici presque dix, ans, Anthony
Giddens décrivait son œuvre principale, The Constitution of Society, comme une
vaste discussion de la phrase de Marx [Les hommes font leur propre histoire,
mais ils ne la font pas de leur propre mouvement, ni dans les conditions choisies
par eux seuls, mais bien dans les conditions qu’ils trouvent directement, et qui
leur sont données et transmises]. Lui-même considère les institutions comme des
ensembles relativement stables de règles et de ressources, souvent d’une grande

extension spatio-temporelle, qui ne font pas que restreindre l’activité humaine et
la canaliser dans des structures prédéfinies, mais la rendent possible en
permettant aux gens de s’appuyer sur ces règles et ces ressources. En ce sens,
tout le présent ouvrage est à son tour une réflexion sur les concepts que propose
Giddens d’“habilitation” et de “contrainte”, une tentative de déterminer aussi
exactement que possible à quelle sorte d’activité, de qui et dans quelles
conditions, les institutions modernes apportent habilitation ou contrainte»,
(Wagner, 1996 : 14-15).
Cette lecture confirme, enfin, la pression qu’exerce la modernité sur les
individus. Ces derniers sont soumis à l’intégration nécessaire de nouvelles
compétences sociales. Cette pression n’est pas toujours assortie de conséquences
fâcheuses, mais elle pèse sur les individus qui sont soumis, pour paraphraser
Beck, aux incohérences des systèmes (Beck, 1996 ; Bauman, 2005). «Les
transformations historiques de la modernité exigent de puissants efforts des
individus pour définir leur place dans la société – avec des résultats souvent
bien incertains. La nécessité de ces efforts tient à la constante extension
historique des institutions et à la fracture des identités sociales qu’elle a pour
effet», (Wagner, 1996 : 16). Parmi les transformations qui semblent peser sur le
devenir des identités sociales, c’est la possibilité de convergence dans des
grands collectifs qui paraît la plus affectée. «Aujourd’hui, certaines formes
d’autoréalisation sont beaucoup plus accessibles, mais d’autres sont devenues
difficiles ou impossibles. Parmi ces dernières, figure la possibilité d’un rapport
de communication avec un collectif valable et assez nombreux, où déterminer
son propre destin. On peut parler à ce propos d’une tendance à l’auto-
extinction de la capacité d’action politique (du libéralisme, de l’utopie libérale),
(…)», (Wagner, 1996 : 17).
La crise actuelle serait liée à la transition entre une configuration sociale
organisée et une configuration sociale libérale restreinte. Une rétrospective
historique permettra d’asseoir cette thèse. «Ce retour sur le passé de la
modernité confirmera la thèse selon laquelle nous avons sous nos yeux une
restructuration majeure. C’est à tort que l’on y voit seulement un renforcement
de certaines tendances de la modernité, une poursuite de la “modernisation”.
Cela étant, les changements d’aujourd’hui sont bien loin de signifier une
quelconque “fin de la modernité”, “fin de l’histoire” ou “fin du sujet” (…). Ces
notions suggèrent la naissance d’une configuration sociale ne reposant plus sur
les idées constitutives, quant à la vie humaine et sociale, qui s’étaient
développées entre le XVI e et le XVIII e siècle. (…) Il convient bien plutôt de
comparer les changements actuels, quant à leur forme et leur portée, à ceux qui
vers la fin du XIX e siècle menèrent à ce que l’on devrait plutôt appeler “société
de masse” ou “société industrielle”. Pour ma part, je tenterai de caractériser la
configuration sociale de cette époque comme “modernité organisée”. La
configuration qui surgit maintenant, et dont les contours ne sont pas encore
pleinement ni clairement visibles, présente certains traits en commun avec les

sociétés du XIX e antérieures à la modernité organisée, celles que je décrirai
comme “modernité libérale restreinte”» (Wagner, 1996 : 11-12).
La rétrospective historique se justifie par la faiblesse de ce type
d’approches. Les travaux sociologiques s’en tiennent plus souvent à des
comptes-rendus de discours et de récits plutôt qu’à l’inventaire de faits. Lorsque
c’est le cas, ces derniers demeurent partiels et limités à des groupements
spécifiques et peu représentatifs. Il en va de même de mes travaux…
«Cependant ces différents travaux traitent, au sens large, de l’histoire des
concepts et des idées. Il est difficile de décrire des remaniements aussi
manifestes pour la société tout entière, au niveau des pratiques économiques,
sociales et politiques (…). On pourrait dire en ce sens que les révolutions ont
été beaucoup moins révolutionnaires, que les discours tenus à leur propos. (…)
Il y a affinité, mais non pas identité, entre les idées et les institutions de ce qu’on
appelle la modernité. (…) Une analyse historique de la modernité requiert donc
de distinguer entre le discours sur le projet moderne (…) et les pratiques et
institutions des sociétés “modernes”. À l’encontre de toute construction
idéaliste – normative et suprahistorique – de la notion de modernité, cela
signifie simplement de reconnaître, tant du point de vue sociologique
qu’historique, qu’il y a un peu plus de deux siècles que s’est produit un
remaniement des discours sur les gens et les sociétés. Cette rupture discursive a
établi les idées modernes comme significations imaginaires pour les individus et
les sociétés, et par là institué de nouveaux types de thèmes et de conflits sociaux
et politiques (Castoriadis, 1975 ; Habermas, 1973 ; Arnason, 1989b)»,
(Wagner, 1996 : 25-26).
Quand j’avance que l’époque change… il s’agit peut-être davantage de
discours et de récits qui se modifient que de pratiques… Ces derniers suivant de
près ou de loin les transformations sémantiques ! De manière similaire, on peut
remarquer que les discours consacrés à la modernisation écologique, voire au
développement durable, divergent par rapport aux pratiques susceptibles
d’attester de leur pertinence. Ce constat attire également l’attention sur une des
vocations de la sociologie : relayer les discours sociaux, les sonder, voire les
critiquer sur la base d’observations pratiques qui les mettent à l’épreuve.
Deux discours structurent notre expérience de la modernité. Le premier,
dit de libération, est indissociable de la philosophie des Lumières. «Il renvoie à
l’exigence d’indépendance dans la quête du savoir, pour ce qu’on appelle la
révolution scientifique, à la revendication d’autodétermination quant aux
révolutions politiques (avec le double modèle américain et français), enfin à la
libération de l’activité économique vis-à-vis de la surveillance et de la
régulation exercées par un État absolutiste. Dans ces trois domaines, la liberté
a été comprise comme un droit humain “inaliénable” et “incontestable”. Mais
on escomptait aussi que les diverses émancipations produiraient des résultats…
Au cours des deux derniers siècles, la pertinence de ce discours avec sa

généalogie intellectuelle n’est pas restée inquestionnée. Très vite est apparue
une critique centrée sur la différence entre le discours lui-même et les pratiques
sociales des groupes qui le tenaient. (…) Que l’on souscrive ou non à l’analyse
de Marx, il est certain qu’aux yeux de presque tous les observateurs, les sociétés
européennes du XIX e siècle présentaient d’énormes contradictions, entre une
rhétorique universaliste et de fortes barrières entre les groupes sociaux quant à
l’accès aux libertés. Les possibilités d’entreprendre, d’exercer des libertés
politiques, de participer à la recherche académique de la vérité, restaient
réservées à une très petite fraction de la population, par des limitations parfois
formelles (…) mais en tous les cas considérables. La notion d’un endiguement
de l’utopie libérale, d’un contrôle et d’une limitation de ses propres
conséquences, est centrale pour toute compréhension de la modernité»,
(Wagner, 1996 : 26-27).
Avec la levée des restrictions formelles et l’avancée de la mobilité sociale,
les discours de libération ont mis l’accent sur le rôle libérateur des arrangements
sociaux hérités de ces transformations. «Les performances croissantes de
l’économie, de la politique et de la science devaient libérer l’individu de nombre
des soucis qu’il connaissait dans les sociétés “traditionnelles”. On
reconnaissait, certes, que les arrangements nouveaux allaient soumettre les
individus à de nouvelles exigences, leur imposer, selon aussi leur statut, des
rôles multiples dans différentes sphères de la société. Cependant, la plupart des
analyses proposées dans les années cinquante et soixante accordaient bien plus
de poids aux progrès de la liberté qu’aux difficultés d’adaptation», (Wagner,
1996 : 27). La libération va progressivement être comprise comme processus
d’individuation (Wagner, 1996 : 28) auquel un mouvement, dit de
disciplinarisation, va s’opposer, dès la fin du XIX e siècle, après la première
guerre mondiale, en particulier.
[La crise écologique correspond à une inversion de cette lecture. Plutôt
que de mettre l’accent sur le caractère libérateur de la modernité, elle insiste sur
ses aspects contraignants, voire sur les effets de capture de la modernité. Cette
perspective ne met pas fin à l’idéologie libérale : on assiste à l’essor de discours
libérateurs qui vont mettre l’accent sur la rupture par rapport à la première
modernité. Cette dernière oscille entre un engagement pour un nouveau type de
modernité, voire de progrès, ou à l’écart de la modernité. L’individuation peut
contrer l’encadrement, voire l’emprise de la modernité sur les individus et leur
mode de vie, tout comme elle peut s’avérer un obstacle à la généralisation de
nouveaux modes d’existence écologiquement responsable. Cet éloge n’étant pas
toujours compatible avec les exigences de la crise écologique, par conséquent].
Le discours de disciplinarisation s’appuie sur l’essor du fascisme en
Europe et s’épanouit autour d’auteurs comme Nietzsche, Adorno et Horkheimer
et Foucault. Son effet de fascination sera affaibli par l’essor de la pluralisation
des formes de vie qui entretient l’illusion d’un mouvement de libération jusqu’à
ce que la thèse de la dissolution du sujet laisse à nouveau planer la thèse d’une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%