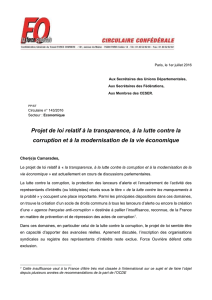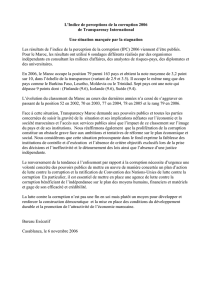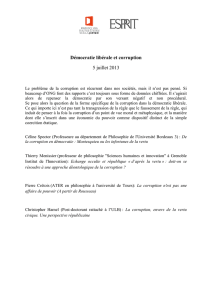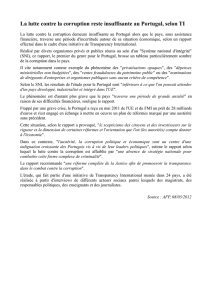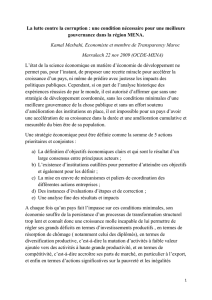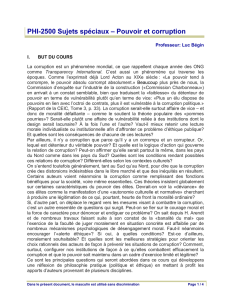État, développement et rationalité en Afrique : contribution à une

TRAVAUX ET DOCUMENTS
Responsable de la collection : Daniel Bach
État, développement et rationalité
en Afrique : contribution à une
analyse de la corruption
Alice Nicole Sindzingre
Chercheur CNRS – CERED/Forum
Université Paris X - Nanterre
N° 43 - 1994
CENTRE D'ÉTUDE D'AFRIQUE NOIRE
Institut d'Études politiques de Bordeaux
11, allée Ausone
Domaine Universitaire
F-33607 PESSAC CEDEX
Tél. (33) 05 56 84 42 82
Fax (33) 05 56 84 43 24
E-mail : c.cazenave@sciencespobordeaux.fr

2
ÉTAT, DÉVELOPPEMENT ET RATIONALITÉ
EN AFRIQUE : CONTRIBUTION À UNE
ANALYSE DE LA CORRUPTION
L’échec du continent africain *
A l’aube des années 90, le constat de la faillite, de la marginalisation, du “déclassement” international
de l’Afrique, selon l’expression de Z. Laïdi, est devenu un lieu commun plus ou moins complaisamment repris,
par les journalistes, les universitaires, les bailleurs de fonds, les Africains eux-mêmes. Tous les indicateurs
peuvent être convoqués un à un, montrant leur détérioration pendant la “décennie perdue”, malgré quelques
tentatives visant à déceler des signes d’amélioration, d’ailleurs rapidement controversés (Banque
mondiale-PNUD, 1989). Quelques chiffres catastrophistes parlent d’eux-mêmes : un exemple parmi d’autres,
en 1990, les ventes annuelles de l’Afrique subsaharienne (ASS) à l’Europe représentaient 0,33 % du PNB
européen, c’est-à-dire un jour de production de la communauté européenne, soit 21,2 milliards de dollars,
montant comparable au chiffre d’affaires annuel de BMW, 30e entreprise européenne (Colin et al., 1993).
Confortant “l’afro-pessimisme”, de multiples explications ont été fournies, dans la littérature du
développement, à cette régression en terme de niveau de vie du continent durant les années 80, pour la plupart
bien connues, qu’il suffira donc de rappeler ici brièvement. Ce n’est que récemment que la “mauvaise gestion”,
les phénomènes de corruption ayant régi les relations entre les divers protagonistes, au Nord et au Sud, ont été
avancés comme facteurs déterminants (par exemple, Michaïlof et al., 1993 ; Adda et Smouts, 1989 ; Agir ici,
1992). L’argument général est ici que la redécouverte de la corruption est une étape discursive parmi d’autres,
qu’il faut saisir à l’intérieur du dispositif de discours croisés tenus par les agences d’aide, les économistes, les
Africains eux-mêmes. Ce concept apparaît plutôt comme un label, qui fait référence à de multiples contenus et
disciplines, et sa valeur explicative, à lui seul, est très inégale.
*Cette recherche s’appuie sur de nombreuses enquêtes de terrain menées depuis 1978 dans différents pays d’Afrique
de l’Ouest, notamment la Côte-d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, effectuées dans le cadre du CNRS ou d’agences d’aide.
Le ministère de la Recherche français a contribué en 1991 à une mission portant spécifiquement sur les thèmes
analysés ici.

3
On présentera d’abord les points de vue des institutions de développement et des économistes, ensuite
les perspectives des politistes, puis une analyse de la corruption elle-même - ceci afin de suggérer que malgré
l’intégration de ce facteur, les approches et mesures choisies par ces institutions rencontrent leur limite dans le
cadre conceptuel de départ ; au regard de la méconnaissance des organisations et représentations locales,
celles-là ont même pu intensifier les comportements corruptifs. On esquissera enfin une explication des
phénomènes de corruption en termes de situations : sous contraintes de représentations issues de l’histoire
économique et politique des États, et des règles sociales spécifiques aux sociétés rurales africaines qui en
forment le substrat, les individus agissent rationnellement. Ceux-ci sont en effet à l’intersection de réseaux de
normes générant des droits et des obligations qui sont hétérogènes et peuvent être incompatibles. La figure de
l’État n’est qu’un réseau de règles parmi d’autres. Par leur interaction avec les contraintes externes précipitées
par un contexte de crise et avec les représentations locales de la pauvreté et de la réussite, induisant des
raisonnements relevant de l’assurance au sein d’environnements devenus instables et incertains (l’acquisition
volontaire de réseaux supplémentaires par exemple), ces comportements individuels ont transformé les règles
“publiques”, et expliquent les phénomènes corruptifs et les inefficiences étatiques. Ces derniers, par des effets
de durée et de formation d’anticipations, rétroagissent à leur tour sur les calculs et arbitrages individuels,
aboutissant à une stabilité du dispositif que méconnaissent les “experts” du développement.
Les causalités économiques avancées dans la littérature du développement
L’environnement externe défavorable et de mauvaises politiques économiques menées par les États
sont les causes les plus fréquemment mises en avant. A l’évidence, les dépendances africaines à l’égard des
quelques produits de base, dont les prix ont fortement diminué, ont gravement affecté leurs termes de
l’échange. Les exportations de ces produits comptent toujours pour un pourcentage élevé des PIB des États
africains, parfois même croissant depuis le second choc pétrolier. Couplés à la montée des taux d’intérêts réels
durant les années 80, les conséquences sont connues : raréfaction des devises, incapacité à assurer le service de
la dette, creusement des déficits des balances des paiements. Des conditions météorologiques adverses, le plus
fort taux d’accroissement démographique mondial (3,2 %) ainsi que l’absence de transition démographique,
contribuent à l’assombrissement des perspectives. L’impossibilité subséquente d’importer suffisamment de
biens d’équipement pour faire redémarrer l’économie, et la faiblesse de l’investissement privé (1) sont
également à l’origine de l’aggravation de l’environnement économique.
Les chocs externes liés à l’accroissement brusque des prix des produits d’exportation, (uranium
nigérien, cacao ivoirien, pétrole nigérian, etc., selon la configuration classique de “dutch disease”) figurent
parmi les causes les plus fréquemment avancées. Fondés sur une fiscalité frappant des produits aux prix
hautement volatils et faiblement transformés, qui ont par ailleurs décru dès le début des années 80, les budgets
publics ont été consacrés pendant la période d’expansion des années 70 à des investissements improductifs et
à l’expansion du secteur public. Le processus a été maintes fois décrit : lors d’un boom, le gouvernement est
politiquement tenu de partager la richesse, d’embaucher des fonctionnaires, ce qui accélère les migrations
rural-urbain, et subventionne la consommation de cette population urbaine (2). Lors de l’inévitable phase de
décroissance des prix, les États se sont retrouvés dans une position financièrement et politiquement intenable
- licencier, réduire les salaires ou les subventions. Les solutions les plus faciles sont de réduire les dépenses
d’importation de biens intermédiaires, de tailler dans les budgets d’investissement et de fonctionnement, de
taxer davantage les producteurs, de recourir à la banque centrale où à l’endettement externe : cercle vicieux
qui aggrave la détérioration économique, dont la gestion des États africains ne porte pas l’entière
responsabilité (cf. par ex. Wheeler, 1984).
Les “politiques économiques défectueuses” des États constituent la deuxième grande série de causes
incriminées. Le meilleur exemple est une programmation des investissements étrangement fondée sur le
maintien de cours élevés, croyance que les agences d’aide n’ont par ailleurs pas clairement démentie à
l’époque. L’extension du secteur public s’est faite au détriment des agriculteurs (marketing boards, prix du
vivrier maintenus volontairement bas, processus aggravés dans certains pays par l’aide alimentaire) ainsi

4
découragés de produire, et par appropriation du secteur industriel par l’État. Les entreprises publiques se sont
partout multipliées, inefficaces, protégées, puis surcapacitaires à la fin des belles années, évinçant un secteur
privé qui trouvait ses niches dans les activités commerciales et de transport, ou dans la fuite des capitaux.
L’accumulation de dettes, largement favorisée par le système bancaire du Nord (3) a servi à combler les
déficits. Avec le recul, le vrai problème des années 80, s’avère avoir été l’augmentation des prix des matières
premières, l’afflux soudain de devises, que les structures des États post-coloniaux n’avaient pas les moyens de
gérer (Collier, 1990).
Ces processus sont bien connus, et ont induit les mises en place des programmes de stabilisation et
d’ajustement structurel (PAS) étendus à la plupart des pays africains au début des années 80 (4). Le
soulagement financier (prêts ou dons) qu’ils représentent est assorti de conditionnalités, qui furent initialement
d’ordre économique et exprimées dans le seul langage économique. Le “package” de mesures est toujours à
peu près identique : contraction de la demande et réorientation de l’offre, réduction drastique des déficits de la
balance des paiements, des finances publiques, correction de la surévaluation des taux de change, élimination
des distorsions imposées par l’État en défaveur de l’agriculture, libéralisation du commerce et du marché du
travail, retrait de l’État des secteurs productifs (donc privatisations, liquidations, réduction des salaires des
fonctionnaires, compression des effectifs de la fonction publique). Ces conditionnalités justifiées par une aide
à la balance des paiements ont induit des flux financiers massifs vers les États (5), et une “intrusion majeure”
dans leurs politiques intérieures à laquelle n’ont cessé de résister les États suffisamment importants ou riches
pour en avoir les moyens (Oyejide, 1990). Les résultats sont mitigés et controversés quant à l’efficacité
respective des PAS et de l’injection de tels flux (cf. Killick, 1990), ce qui commence à être reconnu par la
Banque mondiale elle-même (Elbadawi, 1992) (6).
Le point à souligner ici est que ce bilan a introduit une nouvelle tonalité dans les analyses des bailleurs
de fonds, manifestement accélérée par les événements politiques survenus à l’Est et dans le continent à la fin
des années 80 : celle de la découverte de l’importance des institutions, de la nature de l’État et des
organisations socio-politiques. Avec la publication notamment du rapport de la Banque mondiale sur l’avenir
à long terme de l’Afrique (1989), de nouveaux éléments sont apparus dans le discours des agences d’aide
comme déterminants dans la croissance économique : les “ressources humaines”, le “renforcement des
institutions”, la “dimension sociale”, l’équité, les collectivités locales et l’“appropriation” par les destinataires
des mesures qui leur sont appliquées (ce dernier point fait, ce qui ne laisse pas de surprendre, figure
d’innovation). Surtout, sont entrées en scène la politique, la nature de l’administration, la “mauvaise gestion”
et la corruption, sujets auparavant tabous (7). Ces nouveaux “concepts” accèdent à la légitimité. Les
conditionnalités financières se muent progressivement en conditionnalités économiques et politiques,
notamment avec celle de l’instauration de la “démocratie” émergeant au début des année 90 : la “governance”
(terme typiquement anglo-saxon, désignation neutre d’institutions politiques pluralistes et respectées, cf.
Young 1991), la “gouvernementalité” sont désormais associées aux causes économiques externes et internes,
pour expliquer l’échec des politiques antérieures, celles de l’aide et celles des États africains.
L’apparition de cette nouvelle thématique n’est pas fortuite. Elle sanctionne aussi des situations qui
tiennent surtout à l’évolution des institutions d’aide : moindre intérêt des investissements en Afrique, constats
d’échec et effets de lassitude, renouvellement des élites, justification du retrait des protagonistes du Nord eu
égard à leur nouvel intérêt pour les pays de l’Est. A ceci s’ajoute la difficulté à gérer le paradoxe qu’affrontent
les prémisses libérales des programmes d’ajustement, tenus statutairement de transiter par des États pour
précisément amener ceux-ci à des politiques de désengagement de l’État. Récemment redécouverte, la
“faiblesse de l’administration” est pourtant un phénomène documenté pour les institutions d’aide depuis
longtemps, mais qui demeurait inaudible (8), autant qu’un aspect empirique de “terrain”, des projets et autres
aides budgétaires ou alimentaires souvent évaporés dans les structures impliquées, et par là-même anecdotique.
Le fait inédit tient à sa prise en compte comme candidat officiel à part entière à l’explication, des échecs de
politiques économiques.
En bonne logique libérale, les PAS ont soutenu que l’État en Afrique n’était pas, comme le croyaient
les décennies suivant les indépendances, un moteur de la croissance économique. Mais ensuite, l’échec d’une
décennie de mesures d’ajustement a conduit à une réflexion sur l’économie politique même de ces États et de
l’assistance financière dont ils sont les destinataires, muée en conditionnalité politique dont chacun admet que

5
sa mise en oeuvre concrète est beaucoup plus délicate (Feinberg, 1990 ; Healey et Robinson, 1992).
Cependant, eu égard aux limites conceptuelles de la théorie économique sous-jacente, le diagnostic se borne le
plus souvent aux constats suivants : l’administration est dans l’incapacité de coordonner ou d’appliquer les
réformes, le niveau de formation est faible, les groupes d’intérêts politiques se sentent menacés par les mesures
de privatisation et de décentralisation qui modifient l’équilibre de la distribution des pouvoirs et de la richesse,
les gouvernements hésitent à promulguer des mesures socialement impopulaires.
Ces observations ont pour trait commun de rester le plus souvent descriptives, ou normatives. Elles
s’inscrivent à l’intérieur du paradigme néo-classique ou dans le cadre opérationnel des analyses des bailleurs
de fonds : actuellement défectueuses, les administrations sont nécessaires au fonctionnement du marché, à
condition d’être minimales et performantes, il faut donc les “renforcer”. Faisant le constat d’États
hypertrophiés par rapport à leur productivité et de rentes de fonctionnaires prélevées sur le monde agricole ou
sur les rentes pétrolières ou minières, l’économie libérale trouve ses limites dans les hypothèses qui la
constituent, c’est-à-dire, schématiquement, l’État et le secteur privé s’opposent l’un à l’autre, celui-là est
cause de distorsions et d’imperfections des marchés, et décourage l’investissement privé et la recherche du
profit. Pourtant, même d’un strict point de vue économique, ces prémisses ne vont pas de soi. On sait
qu’aucun État développé ne pourrait affronter sans difficultés les chocs et contre-chocs de prix qui ont affecté
les pays africains dans les années 80, puis la déprotection brutale préconisée par les PAS. Par ailleurs, certains
économistes, se réclamant du néo-structuralisme, ont montré que dans un PED, l’État, loin d’être toujours un
facteur d’éviction de l’initiative privée (crowding out), peut être la condition du développement de celle-ci
(crowding in, Pegatienan, 1987). Lorsqu’elle est juxtaposée aux facteurs tenant à l’environnement externe et
aux mauvais choix de politique économique, la mise en avant des variables “État”, “mauvaise gestion”,
“corruption”, par les recommandations des économistes du développement achoppe sur l’absence
d’instruments disponibles dans l’économie néoclassique pour penser la nature et le rôle des États africains (9).
Dans cette optique, en résumé, le fonctionnement actuel des administrations n’est que l’expression d’un
dysfonctionnement, qui pourra être amélioré par des mesures appropriées, par exemple une meilleure
formation des cadres, une réorganisation des services, une modernisation des infrastructures, etc.
Malgré la thématique désormais classique du “rent-seeking” (par exemple Krueger, 1974 ; Tollison,
1982), la structure de l’État reste une “boîte noire”, où ne peuvent être prises en compte les dimensions de
l’histoire de ces États, des conditions internationales et internes - à la fois politiques, économiques et
sociologiques - qui les ont constitués tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Et surtout, les approches
économiques éprouvent quelque difficulté à analyser l’État comme institution, comportant des rapports
particuliers, “sociologiques” ou “culturels”, à l’intérieur de l’État et entre l’État et les autres groupes sociaux,
commerçants, paysannerie par exemple. On peut certes mentionner le courant actuel dit “new institutional
economics” (North, 1990 ; Lafay, 1992, et, exemple appliqué à la “faisabilité” de l’ajustement, Frey et
Eichenberger, 1992 ; Rama, 1992). Celui-ci demeure cependant situé à l’intérieur des hypothèses
néoclassiques, même s’il a le mérite d’intégrer les notions d’institution et d’organisation. Or les échecs des
politiques économiques et des PAS ne peuvent être conçus comme de simples “ratés”, détournements, ou
maximisations des institutions par les individus. Ils requièrent une compréhension de la logique qui gouverne
ces relations, de la nature de cette “governance”, des enjeux que représente un État africain pour ses agents et
pour ceux qui sont situés à l’extérieur de lui.
Les analyses issues de l’économie politique
Les travaux sur l’économie politique de l’État en Afrique sont très nombreux. On rappellera donc
seulement quelques points critiques relatifs aux rôles respectifs des États et des variables économiques dans
l’explication de la récession actuelle des pays d’Afrique subsaharienne
Tout d’abord, on sait que dans de nombreuses économies non occidentales, c’est l’État qui a mis en
place les conditions de la croissance et du développement industriel, dans le cadre d’alliances entre la classe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%