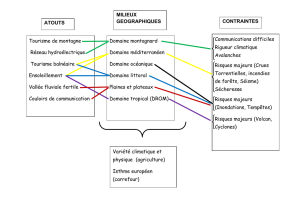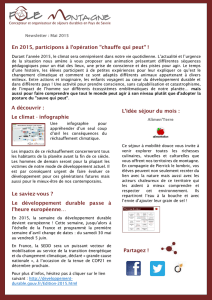Rapport général colloque _Oumar_ vf

v
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But – Une Foi
Colloque Scientifique des « Plus Belles Baies du Monde »
Rapport Général
T h è
T h èT h è
T h è m e
m em e
m e : Les baies fac e aux d éfis d u c hangement c limatiq ue:
qu elles str até gies d’a dapt ation de s act eurs l ocaux ?
T o u b a c o u t a ( S é n é g a l ) , d u 2 3 a u 2 5 m a i 2 0 1 1

H ô t e l d e R é g i o n - Q u a r t i e r D a r o u S a l a m - B P 9 4 F a t i c k T é l / F a x : 3 3 9 4 9 1 1 2 9 ; S t a n d a r d : 3 3 9 4 9 1 1 2 8
E - m a i l : i n f o @ r e g i o n f a t i c k . o r g S i t e w e b : h t t p : / / w w w . r e g i o n f a t i c k . o r g
2
C o l l o q u e s c i e n t i f i q u e d e s « P l u s B e l l e s B a i e s d u M o n d e »
Sommaire
I -Introduction.............................. …........................................................................................3
II -Cérémonie d’ouverture…………………………………………………………………………………………………….3
III -Présentation des résultats du colloque……………………………………………………………………….……5
1-Synthèse des résultats des travaux en panels…………………………………………………………6
2- Synthèse des résultats des travaux en ateliers………………………………………………….…15
IV- Cérémonie de clôture…………………………………………………………………………………………………….18
V- Annexes………………………………….………………………………………………………………………………………20

H ô t e l d e R é g i o n - Q u a r t i e r D a r o u S a l a m - B P 9 4 F a t i c k T é l / F a x : 3 3 9 4 9 1 1 2 9 ; S t a n d a r d : 3 3 9 4 9 1 1 2 8
E - m a i l : i n f o @ r e g i o n f a t i c k . o r g S i t e w e b : h t t p : / / w w w . r e g i o n f a t i c k . o r g
3
C o l l o q u e s c i e n t i f i q u e d e s « P l u s B e l l e s B a i e s d u M o n d e »
I- Introduction
A l’initiative du Conseil régional de Fatick, s’est tenu du 23 au 25 mai 2011 à
Toubacouta (Sénégal), un colloque scientifique en marge du 7
ème
Congrès des « Plus Belles
Baies du Monde ». Appuyé par les partenaires techniques et financiers de la région, cette
rencontre avait réuni environ deux cent cinquante participants de diverses nationalités pour
réfléchir et partager leurs expériences autour du thème général: « les baies face aux défis du
changement climatique: quelles stratégies d’adaptation des acteurs locaux ? ».
Il s’agit des ministères techniques, des organismes internationaux, des
représentations diplomatiques accréditées au Sénégal, des autorités locales et
administratives, des membres des baies, des parlementaires, des directions nationales, des
universités et instituts de recherche, du secteur privé, des projets et programmes, des
services techniques régionaux, des ONG, des élus locaux, des populations etc.
Au titre des délégations étrangères, environ cent participants venant de vingt trois
pays ont participé à cette manifestation, première du genre en Afrique : Portugal, Brésil,
Cambodge, Canada, Cap vert, Corée, Espagne, France, Grèce, Guadeloupe, Liban, Maroc,
Martinique, Monténégro, Philippines, Turkie, Vietnam, Mozambique, Açores, Guinée,
Guinée Bissau, Sierra Léone, Mauritanie.
Le présent rapport fait la synthèse des communications, des débats et
recommandations formulées à l’occasion de cette importante rencontre.
II- Cérémonie d’ouverture
L’ouverture officielle des travaux du colloque scientifique a été présidée par
Monsieur Djibo Leity KA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et de la Protection de
la Nature devant une foule de personnes venue magnifier la tenue de la manifestation au
cœur du Delta du Saloum. La séance a démarré par une minute de silence observée à la
mémoire des victimes des catastrophes naturelles survenues en mars 2011 au japon (baie de
Matsushima) et en Haïti (baie de Jacmel) en janvier 2010.
Six allocutions ont été respectivement prononcées lors de la cérémonie solennelle
d’ouverture.
Monsieur Pape Seydou DIANKO, Président du Conseil rural de Toubacouta a souhaité
la bienvenue aux participants avant de magnifier la tenue de la rencontre dans sa
communauté rurale.

H ô t e l d e R é g i o n - Q u a r t i e r D a r o u S a l a m - B P 9 4 F a t i c k T é l / F a x : 3 3 9 4 9 1 1 2 9 ; S t a n d a r d : 3 3 9 4 9 1 1 2 8
E - m a i l : i n f o @ r e g i o n f a t i c k . o r g S i t e w e b : h t t p : / / w w w . r e g i o n f a t i c k . o r g
4
C o l l o q u e s c i e n t i f i q u e d e s « P l u s B e l l e s B a i e s d u M o n d e »
Monsieur Laurent GODEFROY, Représentant de l’Ambassade de France au Sénégal a
salué l’initiative du Conseil régional de Fatick, à travers ce colloque qui se tient juste après la
journée internationale de la biodiversité. Il a également rappelé quelques une des grandes
décisions prises lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité biologique tenue
à Nagoya au mois d’octobre 2010 : l’adoption du protocole sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage plus équitable des avantages issus de leur utilisation,
l’augmentation d’aires protégées partout dans le monde, etc.
L’Honorable député Abdoulaye SENE, Représentant du Réseau des Parlementaires
pour la Protection de l’Environnement au Sénégal (REPES) a d’abord salué les efforts
inlassables déployés pour la préservation et la promotion des espaces naturelles de la région
de Fatick. Il a rappelé la nécessité pour le Sénégal et les autres pays de la sous région, de
ratifier au plutôt, la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles, dite convention de Maputo. Les objectifs visés à travers le Réseau Régional des
parlementaires et élus locaux pour la protection de l’environnement de la région de Fatick,
mis en place en prélude au colloque scientifique ont été également déclinés.
Monsieur Coumba Ndoffène Bouna DIOUF, Président du Conseil régional de Fatick, a
souhaité la bienvenue aux participants qu’il a adressés de vifs remerciements pour l’intérêt
et l’importance accordés à la rencontre. Il a également magnifié le choix porté sur la région
de Fatick pour accueillir le 7
ème
congrès des Plus Belles Baies du Monde en marge duquel, est
organisé ce colloque international devant permettre de débattre d’un thème d’actualité : le
changement climatique.
Parlant de ce phénomène, le Président du Conseil régional de Fatick a rappelé ses
quelques effets négatifs sur le vécu quotidien des populations du monde entier :
réchauffement global de la planète, inondations à répétitions, déforestation, sécheresse,
salinisation des terres et des eaux, avancée de la mer, érosion côtière, etc. C’est dans ce
contexte que s’inscrivent les multiples initiatives qui sont entrain d’être développées par la
région de Fatick pour apporter une réponse endogène face aux changements climatiques.
Des remerciements ont été également adressés aux partenaires techniques ou financiers qui
ont soutenu l’organisation avec succès de cette manifestation.
Monsieur Jérôme BIGNON, Président des Plus Belles Baies du Monde a décliné dans
son adresse au public, les ambitions de l’association qui cherche à imaginer un autre
développement par les Baies, car la protection et la conservation de la nature est la

H ô t e l d e R é g i o n - Q u a r t i e r D a r o u S a l a m - B P 9 4 F a t i c k T é l / F a x : 3 3 9 4 9 1 1 2 9 ; S t a n d a r d : 3 3 9 4 9 1 1 2 8
E - m a i l : i n f o @ r e g i o n f a t i c k . o r g S i t e w e b : h t t p : / / w w w . r e g i o n f a t i c k . o r g
5
C o l l o q u e s c i e n t i f i q u e d e s « P l u s B e l l e s B a i e s d u M o n d e »
condition de développement. Il a également pointé du doigt, les changements climatiques
avec leurs corollaires de dégâts.
Dans son allocution, Monsieur Djibo Leity KA, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Environnement et de la Protection de la Nature a salué l’engagement de la région de Fatick
qui a pris l’initiative d’organiser cet important évènement dédié au changement climatique.
Il a rappelé les efforts du Gouvernement du Sénégal en matière notamment de lutte contre
le changement climatique et qui se traduisent en particulier par : la ratification des accords
multilatéraux dont la convention cadre des Nationaux Unies sur le changement climatique et
le protocole de Kyoto, l’élaboration d’une stratégie nationale de mise en œuvre de la
convention sur le climat et la définition d’une politique nationale d’adaptation au
changement climatique.
Le Ministre d’Etat a aussi informé de la préparation d’une loi sur le littoral qui devrait
permettre de mieux gérer l’espace maritime et de lutter avec plus d’efficacité, contre les
effets néfastes du changement climatique constatés le long du littoral sénégalais.
Dans ce contexte de décentralisation et de transfert de compétences, il a salué
l’engagement des collectivités locales, qui doivent développer aux côtés de l’Etat, des
initiatives coordonnées à même de renforcer les efforts de lutte contre le changement
climatique.
III- Présentation des résultats du colloque
Les travaux du colloque scientifique ont été organisés en sessions parallèles sous
forme de panels suivis d’ateliers. Vingt communications reparties en quatre panels et deux
ateliers ont été présentées.
Les principaux thèmes ayant fait l’objet d’exposés et de discussions au cours des panels sont:
1- Vulnérabilité du littoral face aux changements climatiques (concepts,
manifestations et impacts globaux) : exemple du delta du Saloum notamment ;
2- Ressources halieutiques et changements climatiques ;
3- Ressources forestières et changements climatiques ;
4- Ressources Hydro agricoles et changements climatiques.
Quant aux ateliers, les communications ont été axées sur les deux thèmes suivants :
1-Changement climatique et système d’information : esquisse d’une démarche de
conception d’une base de données pour la planification et le suivi du delta du Saloum
2- Stratégies d’adaptation aux changements climatiques et financement de projets.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%