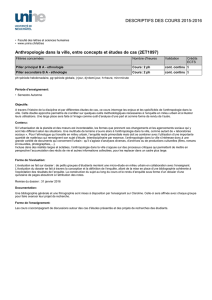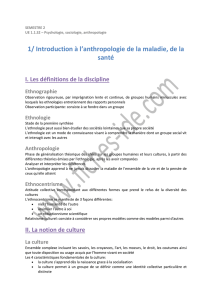Fine Description

1
mercredi 18 novembre 2009 35534 signes
L’anthropologie sociale en France dans quel état?1
Charles Macdonald, CNRS,
President, APRAS
Introduction
Au cours de l’été 2006, l’Association pour la Recherche en Anthropologie Sociale (APRAS)
lançait une invitation aux anthropologues et ethnologues français et aux autres associations
françaises, à commencer par l’Association des Anthropologues Français (AFA), dans le but
de mettre en place un comité chargé de la préparation et de l’organisation d’un grand congrès
réunissant tous les ethnologues et anthropologues français afin de dresser un état des lieux au
plan national. Une telle conférence n’avait pas eu lieu depuis 1977. Trente années s’étaient
écoulées sans que les anthropologues français se soient réunis pour débattre publiquement de
la situation, de la place et des problèmes de leur profession et de leur discipline. Il était clair
cependant que des changements importants étaient intervenus durant les trente dernières
années et beaucoup souhaitaient avoir ce débat et cette discussion, tant sur le plan
épistémologique et scientifique que professionnel, notamment dans les domaines de
l’enseignement, de la recherche et des usages appliqués de la discipline. Cette conférence fut
baptisée « Assises de l’ethnologie et de l’anthropologie en France » et sa date de réunion fixée
aux 12-15 décembre 2007. Dans cette communication je fournirai quelques informations sur
la préparation des « Assises » puis je m’interrogerai sur l’état de santé de la discipline en
France : est-elle malade ou bien portante ?
Etudes et travaux sur l’anthropologie sociale en France
Après le colloque de 1977, le débat se poursuivit sous forme de publications diverses. Les
actes du colloque de 1977 parurent sous le titre de l’Anthropologie en France: situation
actuelle et avenir (Paris, CNRS, 1979), puis divers rapports et volumes collectifs furent
publiés dans les années qui suivirent, notamment Les Sciences de l’Homme et de la Société en
1 Cet article est la traduction libre et passablement remaniée d’une communication faite au séminaire
de la Fondation Wenner-Gren sur « l’Anthropologie en Europe» à l’Université de Paris X Nanterre,
les 25-27 octobre 2007. Destinée à informer des collègues étrangers sur la situation au plan local et sur
la préparation des « Assises de l’ethnologie et de l’anthropologie en France », cette communication a
un contenu très différent de celui qu’elle aurait eu, eût-elle été destinée à des collègues français.

2
France de Maurice Godelier (Paris, la Documentation Française, 1982), un numéro spécial de
l’Homme réédité sous la forme d’un livre de poche, L’anthropologie, état des lieux (Paris,
Navarin/Le Livre de Poche, 1986), un rapport coordonné par M. Izard et G. Lenclud, intitulé
Les régimes de scientificité de l’anthropologie en France (Paris, APRAS, 1995), ainsi qu’un
volume édité par M. Guillaume sous le titre L’état des sciences sociales en France avec un
article de J. Coppans sur « Le regard ethnologique » (Paris, La Découverte, [date ?]).
Nombre de nos collègues étrangers se sont intéressés à la situation française, par exemple
dans un numéro spécial de Anthropology Today (Vol. 14, No.3, Aug. 1999) où l’on trouve des
articles de S. Rogers et G. Marcus, à côté de contributions signées par M. Abélès, et F.
Langlois2. On pourra ajouter également un numéro spécial de Anthropologie et Sociétés (Vol.
24, 1, 2000) qui discute des traditions nationales de la discipline, en particulier en France.
De son côté, la section 38 du CNRS a produit tous les quatre ans un rapport de conjoncture et
un rapport de prospective qui font le point sur la situation de la discipline, en l’occurrence
l’ethnologie et la sociologie des religions.
L’anthropologie en Europe ou l’anthropologie européenne a suscité un nombre grandissant
d’études ces dernières années avec, par exemple, un numéro de Social Anthropology (Vol. 13,
No. 1, 2005) contenant des articles signés de A. Kuper, P. Descola et M. Strathern. Plusieurs
ouvrages traitent de l’anthropologie en Europe3 et font référence à la situation en France.
Des ouvrages individuels ou collectifs récents parus en France sur les nouveaux
développements méthodologiques et théoriques de l’anthropologie4 ne s’intéressent pas
principalement à la situation locale mais reflètent des préoccupations qui agitent le milieu de
l’anthropologie en France.
Cette brève et incomplète revue des publications qui traitent de la situation de l’anthropologie
en France montre bien qu’une réflexion a constamment été menée. La production d’œuvres
ethnologiques sur des sujets de plus en plus divers et une préoccupation de « réflexivité » ont
2 J. Bowen et M. Bentaboulet ont publié un intéressant article intitulé « Institutionalization of the
‘Human and Social Sciences’ in France » qui concerne en partie l’ethnologie, dans Anthropological
Quarterly (75, 3, 2002).
3 Comme ceux de D. Dracklé et al. (2003, Educational Histories of European Social Anthropology,
Oxford : Berghahn Books - 2004, Current Policies and Practices in European Social Anthropology
Education, Oxford : Berghahn Books) ou P. Skalnik (2004, Anthroplogy of Europe : Teaching and
Research, , Studies in Sociocultural Anthropology 3, Prague : Set Out-Roman Misek,).
4 M. Segalen, 1989, L’autre et le semblable. Regards sur l’ethnologie des sociétés contemporaines.
Paris : Editions du CNRS1989, L. Berger, 2005, Les Nouvelles Ethnologies, Paris : Armand Colin, C.
Ghassarian, 2004, De l’ethnographie à l’anthropologie réflexive, Paris : Armand Colin, un numéro
spécial de Critiques, « Frontières de l’Anthropologie », cordonné par de B. l’Estoile et M. Naepels
(Critiques, janv-févr.2004, 680-681).

3
incité les anthropologues français à des débats sur l’objet et sur les méthodes ainsi que
l’atteste un colloque tenu à Marseille en 20075.
La préparation des Assises
Malgré son intérêt et sa relative abondance l’écrit ne pouvait remplacer un débat oral, vivant
et public que beaucoup souhaitaient. Les raisons pour lesquelles ce débat n’eut pas lieu
pendant si longtemps tiennent en partie à des caractéristiques propres au milieu national de la
profession. Celle-ci est représentée par plusieurs associations qui ne s’entendent pas très bien,
à commencer par les deux principales, l’APRAS et l’AFA. Cette dernière fut créée juste après
le grand colloque de 1977. Dix ans plus tard une autre association vit le jour, l’APRAS.
Ces deux associations obéissent à des principes de fonctionnement différents. L’AFA, plus
ouverte, notamment aux jeunes chercheurs et aux professionnels débutants et sans emploi
fixe, publie une revue, le Journal des Anthropologues, qui reflète en grande partie des
préoccupations professionnelles et sociales, tandis que l’APRAS, née d’un mouvement réactif
à la fin des années 80 –dans un contexte de refonte des sections du comité national du
CNRS—était portée par des professionnels statutaires, en majorité des chercheurs du CNRS,
qui préféraient un mode de cooptation pour constituer une association représentative au plan
des compétences scientifiques. On avait donc les « populistes » d’un côté et les « élitistes » de
l’autre (si on m’autorise cette caricature). Cette dispersion était accentuée par l’existence
d’autres associations comme la Société d’Ethnologie Française. Cet éparpillement des forces,
voire ce factionnalisme, ne favorisait pas un effort commun.
Or fin 2005 et début 2006 il y eut un remue-ménage causé par l’annonce d’une modification
de l’organigramme du département des Sciences Humaines du CNRS. On crut comprendre
que la section 38 (dont le rôle dans le dispositif professionnel et scientifique de
l’anthropologie en France est crucial) serait désormais contrôlée ou pilotée par les historiens.
Cette perspective qui apparaissait comme devant rétrograder l’anthropologie et la soumettre à
une autre discipline émut fortement le milieu des anthropologues qui se mit à vociférer et
s’agiter en tout sens. Des pétitions circulèrent. Une grande réunion à laquelle tout le milieu fut
convoqué par l’APRAS eut lieu en février 2006, en présence de responsables de la direction
scientifique du CNRS. Ainsi se trouvèrent réunis une foule de collègues qui purent goûter aux
joies retrouvées d’une convivialité disciplinaire. Cela contribua sans doute à raviver le projet
d’un grand congrès de l’anthropologie française qui mijotait depuis longtemps dans les
5 O. Leservoisier & L. Vidal éd., 2007, L'anthropologie face à ses objets. Nouveaux contextes
ethnographiques, Paris, Editions des Archives Contemporaines

4
cuisines des associations. Pour ce qui est des craintes suscitées par les réformes annoncées,
elles disparurent, comme d’ailleurs ces réformes et les réformateurs eux-mêmes, par suite de
remaniements au sein de la haute direction.
Dans le calme revenu, se mit en place le « Comité de préparation des Assises » en juillet
2006. Des représentants des deux principales associations, APRAS et AFA, y participèrent
dès le début, sur une base volontariste et bénévole. D’autres personnes, notamment un
représentant du groupe «Passerelles»6, se joignirent à ce comité assez mélangé (parmi la
douzaine de membres on y trouvait des hommes et des femmes, des plus et des moins jeunes,
des chercheurs et des enseignants-chercheurs, d’autres catégories de personnel et des hors-
statuts). Ce petit groupe reflétait des opinions et tendances idéologiques assez différentes les
unes des autres mais dans l’ensemble il fonctionna avec efficacité, avec quelques heurts au
début, qu’il sut dépasser.
Format des Assises
Les travaux du comité commencèrent donc et à l’automne 2006 les grandes lignes de
l’organisation de ce colloque étaient arrêtées. On tiendrait un grand forum, et non un
colloque, au sens classique, avec des interventions programmées et des orateurs patentés.
Les Assises devaient durer plusieurs jours et être organisées sur la base de quelques grandes
questions ou pistes de réflexion. Celles-ci seraient préparées tout au long de l’année dans des
groupes de travail et des séminaires et les conclusions seraient présentées par deux
rapporteurs au début de chaque session. Deux « discutants » étaient prévus, l’un non Français
qui nous ferait part d’un regard extérieur sur notre situation locale, l’autre Français mais non
ethnologue, un sociologue ou historien par exemple. Chaque session constituerait une session
plénière et durerait de deux à trois heures, en laissant le public intervenir à son gré7.
Les questions ou thématiques qui se dégagèrent après d’assez longues discussion au sein du
comité de préparation furent : 1°) les structures actuelles de la recherche et de l’enseignement
en France et les impacts des changement institutionnels sur la discipline, 2°) la place de la
discipline au sein des sciences humaines et des autres sciences, ainsi que les liens
interdisciplinaires, 3°) le rôle et l’engagement de l’anthropologue dans la société, 4°) la
question de l’altérité (sa « construction »). On avait aussi prévu une 5e session pour discuter
des associations et de leur refonte éventuelle en une seule grande association. En dernier lieu,
6 Voir J. Descelliers, F. Martin et A. soucaille, « Un ethnologue dans la classe», Ethnologie Française,
XXXVII, 2007, 4, pp. 681-687.
7 C’est bien ainsi que les choses se sont déroulées, à l’exception du discutant français dont on se passa
en fin de compte.

5
une session commune fut organisée de concert avec l’Association Européenne (EASA) pour
discuter de l’Europe.
Le comité de préparation mit en place également un site coopératif sur la Toile
(assisesethno.org) qui joua un rôle capital dans la préparation de l’événement. Dans
l’ensemble, tant sur le site des Assises que dans les séminaires et groupes de travail
préparatoires, le débat se fit plus vif sur des questions d’ordre professionnel et corporatiste,
sur des revendications présentées par des jeunes chercheurs, voire des étudiants. Ce sont eux
finalement qui ont porté le débat tandis que les chercheurs et enseignant statutaires « seniors »
regardaient plutôt les choses de loin.
Malgré ses lacunes et ses dérapages, le site Web fut un lieu de débat, de discussions, et on
sentait un intérêt. Si la population des anthropologues qui font de cette activité un métier et en
vivent ne dépasse guère en France 400 personnes, il y eut au final au moins 500 participants
(beaucoup non statutaires) aux Assises elles-mêmes et cela montre bien quel décalage il y a
entre une image institutionnelle de la profession (supposée être menacée d’extinction) et sa
réalité vivante qui attire un public jeune, enthousiaste, mais incroyablement frustré par le
manque de perspectives d’emploi.
« Anthropologie » et « ethnologie »
Je vais maintenant porter mon attention sur ce qui forme le sujet de notre présente réunion à
savoir de « dégager une image la plus complète possible » de la discipline. En d’autres termes
sur ce qu’est l’anthropologie en France aujourd’hui. En ce qui me concerne, il serait utopique
de prétendre accomplir ce programme tant je suis dépassé par le nombre et la variété des
productions anthropologiques et des opinions émises par les uns et les autres sur leur nature et
leur direction. Je me contenterai donc de quelques remarques sur des points non dénués
d’importance.
Je commencerai par l’appellation de notre discipline : « anthropologie » ou « ethnologie » ?
Ces deux termes ont entre eux un rapport différent de celui qu’entretiennent leurs homologues
dans la langue anglaise « anthropology » et « ethnology ». Jusqu’en 1960 on utilisait de
préférence le terme « ethnologie ». Avant1960, date de création du Laboratoire
d’Anthropologie Sociale sous la direction de Claude Lévi-Strauss qui imposa l’usage du
terme « anthropologie » ou, pour être plus exact, « anthropologie sociale », l’institution
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%