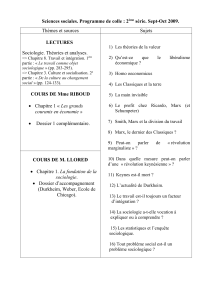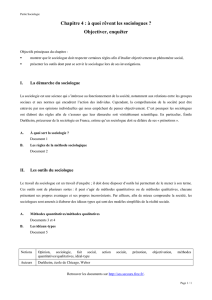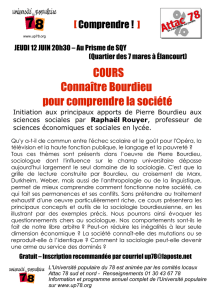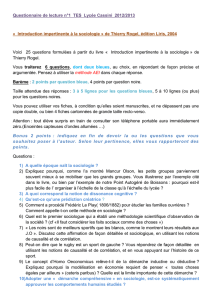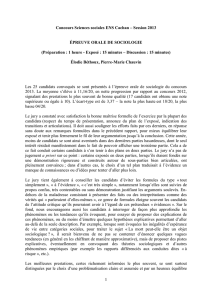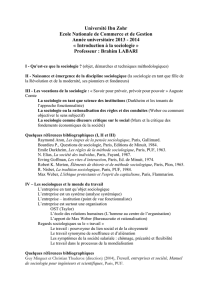Les 100 mots de la sociologie


QUE SAIS-JE ?
Les 100 mots de la sociologie
SERGE PAUGAM

Avant-propos
’objet de la sociologie renvoie à l’homme social ou à l’homme socialisé. Les sociologues peuvent
facilement s’accorder, à un niveau général, sur le fait que leur discipline est la science des relations
sociales telles qu’elles sont imposées et transmises par le milieu – les cadres de socialisation – et
telles qu’elles sont également vécues et entretenues par les individus. Mais, au-delà de cette
définition générale, avec quelles méthodes le sociologue travaille-t-il ? Quels sont les concepts
majeurs de la sociologie ? À partir de quelles appartenances sociales peut-on définir les liens de
l’individu à la société ? Telles sont les principales questions auxquelles ce livre entend répondre. Il
est peu probable que tous les sociologues, pris isolément, y répondraient de façon identique tant sont
présentes dans ce champ disciplinaire des approches, des sensibilités, voire des écoles différentes.
C’est la raison pour laquelle la concertation est nécessaire.
Pour choisir et rédiger les entrées de ce guide, vingt et un sociologues appartenant au comité de
rédaction de la revue Sociologie se sont réunis plusieurs fois. Ils ont préparé cet ouvrage en même
temps qu’ils définissaient les orientations de cette revue généraliste. Ainsi, ces 100 mots ont
bénéficié de la dynamique de ce comité composé d’une majorité de jeunes sociologues soucieux de
dépasser les oppositions d’écoles et de méthodes nées dans le courant des années 1960 et 1970 et de
privilégier une approche pluraliste et exigeante de la discipline.
Les auteurs ont tenu à travailler dans la plus grande transparence en exprimant leurs choix respectifs
et parfois leurs désaccords. Ce livre est né de cette confrontation de plusieurs points de vue. Il traduit
ainsi une volonté de définir, de façon consensuelle et dans un souci pédagogique permanent, ce qui
constitue le cœur d’une discipline et d’un métier. Si chaque notice a bien un auteur, l’ensemble a été
relu plusieurs fois et soumis à l’approbation du groupe.
L’esprit d’ouverture, de discussion et de synthèse qui a accompagné cette écriture à plusieurs mains
constitue incontestablement une garantie pour le lecteur. Ce dernier y trouvera des définitions
rigoureuses et documentées qui ont été validées par un groupe représentatif de sociologues reconnus.
Il pourra être également sensible à la volonté partagée des auteurs de promouvoir leur discipline en
la rendant accessible au plus grand nombre.
L

Liste des contributeurs
éline Béraud, maître de conférences à l’Université de Caen
Michel Castra, maître de conférences à l’Université de Lille I
Isabelle Clair, chargée de recherche au cnrs
Philippe Coulangeon, directeur de recherche au cnrs
Baptiste Coulmont, maître de conférences à l’Université de Paris 8
Nicolas Duvoux, maître de conférences à l’Université Paris Descartes.
Pierre Fournier, maître de conférences à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1)
Florence Maillochon, chargée de recherche au cnrs
Claude Martin, directeur de recherche au cnrs
Olivier Martin, professeur à l’Université Paris-Descartes
Pierre Mercklé, ens Lettres & Sciences Humaines
Sylvie Mesure, directrice de recherche au cnrs
Laurent Mucchielli, directeur de recherche au cnrs
Serge Paugam, directeur de recherche au cnrs – directeur d’études à l’ehess
Geneviève Pruvost, chargée de recherche au cnrs
Corinne Rostaing, maître de conférences à l’Université de Lyon 2
Sandrine Rui, maître de conférences à l’Université de Bordeaux 2, directrice du département de
sociologie.
Vincent Tiberj, chargé de recherche à la fnsp
Cécile Van de Velde, maître de conférence à l’ehess
Anne-Catherine Wagner, professeur de sociologie à l’Université de Paris 1
Agnès van Zanten, directrice de recherche au cnrs
C

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
79
100%