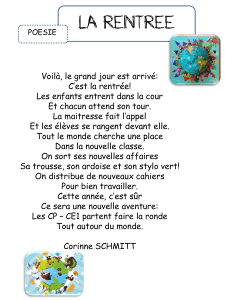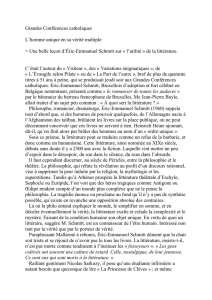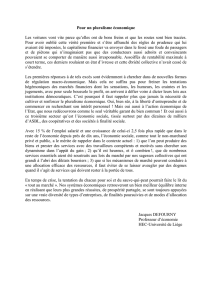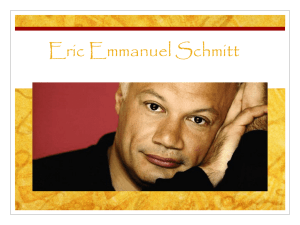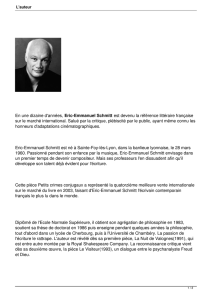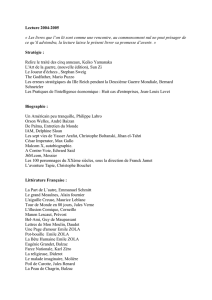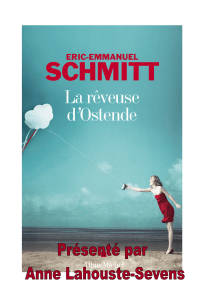une critique antilibérale du pluralisme

Carl Schmitt, critique ultra-conservateur du pluralisme : une critique antilibérale du
pluralisme ?
La critique du libéralisme développée dès le tout début des années 20 par le juriste
conservateur ultra-catholique Carl Schmitt est désormais bien connue. Elle se développe dans
un contexte historique marqué par la forte instabilité politique la République de Weimar, qui,
sous la pression de crises politiques, institutionnelles et économiques répétées, demeure
presque continument menacée par la guerre civile. C’est pourquoi c’est presque toujours sous
le prisme de la mise en péril de l’unité étatique que le juriste, qui ne cache guère une certaine
nostalgie à l’égard de l’Empire, analyse les limites de la pensée libérale.
Bien qu’elle lui soit articulée, la question du pluralisme ne s’installe quant à elle
véritablement au cœur de la théorie schmittienne qu’à partir de la fin des années 20, en
particulier après la chute de la grande coalition du gouvernement Müller, qui marque la fin
des gouvernements majoritaires de coalition. Dans ce cadre, le juriste dénonce le fait que
divers groupements sociaux aient investi l’Etat dans l’objectif d’utiliser les instruments offerts
par la puissance publique pour atteindre leurs finalités économiques et sociales particulières
ou privées, au mépris de toute finalité collective. Une exploitation que Schmitt caractérise de
pluralisme : « Le pluralisme, en revanche, signifie une variété de complexes sociaux de
pouvoir, fermement organisés, qui s’étendent au domaine entier de l’Etat, c’est-à-dire aussi
bien aux divers secteurs de la vie politique qu’à l’ensemble des Länder et aux municipalités et
entités locales supérieures, complexes qui, en tant que tels prennent appui sur les organismes
représentatifs de l’Etat, sans cesser pour cela de demeurer des structures purement sociales
(c’est-à-dire non politiques) » 1.
Le pluralisme qui est en jeu ici est donc un pluralisme politique, souvent désigné par la notion
d’Etat pluraliste, qu’il est nécessaire de distinguer du simple fait de la multiplicité sociale.
Car, non sans habilité, le juriste souligne bien que l’« unité de l’Etat a toujours été une unité
faite de multiplicité sociale » : « pluralisme des races et des peuples, des religions et des
cultures, des langues et des systèmes juridiques »2. En revanche, le pluralisme politique
engage un certain rapport de la multiplicité sociale à l’Etat, qui se définit comme une forme
d’investissement ou d’exploitation de l’Etat par la multiplicité des groupes sociaux organisés
qui visent à peser sur la volonté étatique – au détriment des fins communes et de l’« éthique
de l’Etat »3.
Bien loin de n’être qu’une notion descriptive ou un concept épistémologique, la notion de
pluralisme engage donc au contraire un point de vue normatif intrinsèquement critique. Mais
une telle définition du pluralisme suppose évidemment d’accepter «que ce n’est pas le peuple
qui s’est emparé de l’Etat par le biais du Parlement, mais des groupes d’intérêts dont
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Carl Schmitt, (1931), 2009, El defensor de la Constitution, in Carl Schmitt, Hans Kelsen, La polémica
Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitutional : El defensor de la Constitutión versus ¿Quién debe ser el
defensor de la Constitutión?, trad. esp. Manuel Sánchez Sarto et Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, p. 128.
2 Schmitt (1930), 1988, p.144. Cf. également Carl Schmitt, Parlementarisme et démocratie, 1988, p. 141.
3 Carl Schmitt, « Ethique de l’Etat et Etat pluraliste », in Carl Schmitt, Parlementarisme et démocratie, trad. fr.
Jean-Louis Schlegel, Paris, Seuil, pp. 129-150.

l’illégitimité est perpétuellement rappelée »4. Et Schmitt perçoit clairement en quel sens le
pluralisme pourrait être précisément identifié avec la démocratie elle-même, ainsi que nous
allons le voir plus loin. Mais l’investissement de l’Etat par les divers groupes sociaux se
réalise à des fins privées, où chaque groupe organisé prétend exploiter les moyens de l’Etat
pour atteindre ses propres finalités, lesquelles sont non seulement indifférentes aux finalités
étatiques mais parfois même contraires. Et c’est précisément de ce point de vue que Schmitt
fait du pluralisme politique le fruit d’une stratégie libérale, généralement conçue comme un
effort de dépolitisation ou de relativisation de la puissance de l’Etat.
Le libéralisme n’est effectivement pas d’abord, pour le juriste, une théorie politique ou
économique déterminée. Il est bien plutôt une forme générale de pensée qui nait au cours du
XVIIIe et qui se construit intégralement autour d’un individualisme bourgeois. En vertu de cet
individualisme, la préservation de l’individu et de l’activité individuelle à l’encontre des
atteintes de l’Etat constituent le socle commun de toute politique libérale5, qui se réalise
ensuite au moyen des grandes réalisations institutionnelles et juridiques du libéralisme que
sont l’Etat de droit et le Parlementarisme.
En laissant de côté tout examen approfondi de l’Etat de droit et du Parlementarisme dans le
cadre de cette intervention, notons seulement que l’un et l’autre se structurent selon le juriste
autour du principe de « domination de la loi »6, où la loi doit nécessairement posséder
certaines qualités, notamment la généralité7, ainsi qu’un certain contenu de justice sans lequel
une loi votée par la majorité pourrait aller à l’encontre des droits individuels8. Ce qui implique
d’abord que la loi au sens libéral, tout comme l’Etat de droit, reçoivent une définition
matérielle, c’est-à-dire un certain contenu substantiel, ou un contenu en valeur9. C’est
pourquoi, souligne le juriste, en vertu de ses principes mêmes le libéralisme ne peut demeurer
neutre à l’égard des diverses opinons et valeurs qui prétendent à la représentation
parlementaire. Mais cela suppose ensuite de dégager un principe d’organisation susceptible
de garantir une telle domination de la loi (libérale), que l’on peut résumer, sans beaucoup
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Renaud Baumert, 2009,!La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique. Les controverses
doctrinales sur le contrôle de la constitutionnalité des lois dans les Républiques française et allemande de
l’entre-deux-guerres, Paris, Collection des Thèses, n°33, L.G.D.J. p. 490.
5 Cf. Carl Schmitt (1932), 1992, « La Notion de politique », in La Notion de politique. La Théorie du partisan,
trad. fr. Marie-Louise Steinhauser, Paris, Flammarion, pp. 114 et 115.
6 Carl Schmitt (1928), 1993, Théorie de la constitution, trad. fr. Lilyane Deroche, Paris, Quadrige/PUF, p. 276.
7 Carl Schmitt (1923), 1988, « Parlementarisme et démocratie », in Carl Schmitt, Parlementarisme et
démocratie, trad. fr. Jean-Louis Schlegel, Paris, Seuil, p. 53.
8 Carl Schmitt (1928), 1993, op. cit., p. 278.
9 Une telle définition matérielle de l’Etat de droit est parfaitement exposée par J. Chevallier : « La construction
de la théorie de l’Etat de droit n’est pas le fait du hasard ou le produit d’une logique purement interne au champ
juridique : la théorie s’est épanouie sur un terreau idéologique, enracinée dans une certaine réalité sociale et
politique ; privée de ce substrat, elle n’apparaît plus que comme une coquille vide, un cadre formel, et devient au
sens premier du terme « insignifiante ». (…) Le thème est lié à un ensemble de représentations et de valeurs qui,
lentement forgées au fil de l’histoire des pays européens, constituent ses conditions de possibilité : l’Etat de droit
présuppose une vision de l’Etat, entité abstraite et collective distincte de la “société civile”, et du droit, perçu
comme exprimant l’idéal de “justice” ». Jacques Chevallier, 2003, L’Etat de droit, Paris, Editions Montchrétien,
p. 52.

forcer le trait, au principe de libre concurrence10. Ce principe, qui constitue l’un des piliers de
la « métaphysique libérale »11, repose sur la croyance d’après laquelle une unité et un ordre
harmonieux sont susceptibles de naître de la libre concurrence. Il anime aussi bien le principe
de la séparation des pouvoirs que la structure du parlementarisme libéral, qui consiste en son
essence, selon Schmitt, en un système de modération du pouvoir et de pacification des
tensions sociales grâce à l’intégration raisonnable de la pluralité des opinions au moyen de la
discussion. Par sa structure même, le parlementarisme postule donc toujours un pluralisme
politique institutionnalisé sous sa forme minimale qu’est le multipartisme. Mais plus
profondément, s’il existe un rapport absolument intrinsèque entre libéralisme et pluralisme
c’est d’abord au sens où le pluralisme politique est d’abord conçu comme un instrument
libéral de modération du pouvoir sous la forme d’une application du principe de libre-
concurrence. C’est pourquoi le pluralisme pensé comme un phénomène historique large, qui
déborde l’immédiat après-guerre et ne procède pas seulement de la fragilisation ponctuelle de
l’Etat, mais s’inscrit au contraire dans une stratégie générale de neutralisation et de
dépolitisation qui le lie intrinsèquement au libéralisme12. Et c’est précisément sous cet angle
que le juriste s’attaque violemment aux théories pluralistes, conçues dans leur essence comme
des théories libérales.
En effet, si la critique schmittienne du pluralisme porte généralement sur le phénomène
historique d’exploitation supposée de l’Etat par des groupements sociaux à des fins privées,
elle s’attaque également aux théories pluralistes, dont le modèle est notamment fourni par les
théories de George D.H. Cole et Harold Laski. Selon Schmitt ces dernières consistent
essentiellement à « nier l’unité souveraine de l’Etat, c’est-à-dire l’unité politique, et à
souligner sans relâche que l’individu vit inséré au plan social dans de nombreuses relations,
de nombreux groupes différents : il est membre d’une société religieuse, d’une nation, d’un
syndicat, d’une famille, d’un club sportif et de nombre d’autres associations qui exercent sur
lui une influence plus ou moins forte selon le cas et qui l’engagent dans une “pluralité
d’engagement et de loyalismes”, sans que l’on puisse dire de l’une de ces associations qu’elle
détient la prédominance et la souveraineté absolue » 13. Les théories pluralistes telles que
l’analyse Schmitt se situent donc à la lisière du descriptif et du normatif : d’un point de vue
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 « Mais tout cela n’est qu’une application particulière du principe libéral général. Car c’est exactement la même
chose que la vérité procède du libre conflit des opinions ou que de l’harmonie surgisse d’elle-même la
compétition économique ». Carl Schmitt (1923), 1988, op. cit., p. 45.
11 Cf. Carl Schmitt, (1922), 1988, Théologie politique, chapitre II, trad. fr. Jean-Louis Schlegel, Paris,
Gallimard.
12 Plus largement, Schmitt parle même d’un processus de neutralisation et de dépolitisation qui engage une
véritable théorie de l’histoire : il existe selon lui en Occident depuis la fin des guerres de religions, un
mouvement de neutralisation et de dépolitisation, qui s’exprime à la fois dans la survalorisation de l’économie et
de l’éthique, conçus comme domaines où l’organisation des rapports sociaux est susceptible d’être dépolitisée,
c’est-à-dire d’être soustraite à l’intervention de l’Etat, ainsi que dans la défiance qui s’est progressivement
développée à l’égard de l’Etat et plus généralement à l’égard de toute souveraineté politique, depuis le XVIIIe
siècle. Cette défiance, dont nous allons voir qu’elle fonde l’émergence du pluralisme politique, constitue le
véritable cœur du libéralisme politique dans les analyses de Schmitt. Cf. Carl Schmitt (1929), 1992 « L’ère des
neutralisations et des dépolitisations » in Carl Schmitt, La notion de politique, La théorie du partisan, trad. fr.
Marie-Louise Steinhauser, Paris, Flammarion, pp. 131-151. Voir également Jean-François Kervégan, 1992,
Hegel, Carl Schmitt, Le politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, pp. 104 et suivantes.
13 Schmitt (1932), 1992, op. cit., p. 80.

descriptif, le pluralisme consiste à relativiser le rapport de domination de l’Etat sur les
individus en insistant sur la pluralité des groupes sociaux d’appartenance de l’individu et par
suite à nier l’intérêt théorique de la notion même de souveraineté. Et sous cet angle, à l’instar
de bien d’autres critiques, Schmitt reproche à ces théories pluralistes de ne pas distinguer le
lien politique des autres formes de liens sociaux, et d’être par suite incapables de saisir le
principe de l’unité politique.
Mais cette impasse théorique évidente à ses yeux traduit précisément selon lui le point de vue
normatif de ces théories, dont l’objectif proprement libéral consiste à favoriser la pluralité des
formations et des groupes sociaux et à « jouer une association contre l’autre »14 dans l’objectif
de limiter la puissance de l’Etat en la relativisant. Un tel effort doit nécessairement avoir
d’importantes implications à la fois institutionnelles et juridiques, puisqu’il conduit à valoriser
l’activité des différents groupes sociaux dans la sphère publique, ainsi qu’à développer les
moyens d’une telle activité. La reconnaissance juridique des partis politiques et la protection
des partis minoritaires, l’extension de la participation des intérêts organisés à tous les
échelons de la création du droit, y compris dans le cadre de l’exercice de la justice, constituent
ainsi d’évidents acquis d’une conception pluraliste de l’Etat contre laquelle Schmitt veut
lutter.
Or, de ce point de vue, l’attitude du juriste est relativement complexe. Car si d’un côté
Schmitt ne cesse de souligner sans discontinuer la faiblesse des politiques libérales, consistant
seulement dans un effort de relativisation de la puissance de l’Etat, notamment grâce à
l’exploitation du pluralisme politique, d’un autre côté, il entend soulever les limites de
l’alliance ambigüe qui s’est nouée entre le libéralisme et le pluralisme.
En effet, le soutien apporté par les libéraux à la reconnaissance institutionnelle et juridique du
pluralisme politique, qui débute avec la lutte engagée par la bourgeoisie libérale contre
l’absolutisme et qui mène à la démocratie15, constitue pour le juriste l’une des principales
causes de la décadence du parlementarisme, mais surtout le plus grand péril pour le
libéralisme même.
D’une part, parce que si le parlementarisme libéral avait encore pour fonction de représenter
l’unité politique en intégrant par la discussion rationnelle la diversité des opinions portées par
la très homogène classe bourgeoise, l’élargissement de la représentation parlementaire a eu
pour conséquence de transformer la volonté générale en un simple calcul des divers intérêts
privés représentés à l’Assemblée16. Or, un tel calcul ne constitue pas une volonté générale
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Schmitt (1932), 1992, op. cit., p. 83.
15 En effet, dans leur lutte contre l’Etat, les libéraux ont développé une stratégie politique ambigüe, qui les a
conduits à participer de fait à l’émergence du pluralisme, notamment au sein du parlement. Car la bourgeoisie
libérale n’a pu imposer au XIXe siècle son idéal de l’Etat de droit ainsi que son modèle de l’Etat parlementaire
contre l’agencement institutionnel propre à l’absolutisme qu’en prenant appui sur les revendications populaires
d’un élargissement de la représentation, autrement dit en s’engageant dans la lutte pour les « droits de la
« représentation populaire » (Schmitt (1928), 1993, op. cit., p. 285). Et Schmitt de poursuivre : « En fin de
compte, le résultat politique fut la démocratie. (…) Cela répondant à la tendance naturelle d’une lutte politique
contre un gouvernement monarchique fort. Dans une telle situation politique, les deux revendications différentes
– notion libérale de la loi et participation la plus large possible de la représentation populaire – devaient se
combiner ». Carl Schmitt (1928), 1993, op. cit., p. 285).
16 Schmitt (1923), 1988, op. cit., p. 64.

selon Schmitt, et doit être incapable de représenter l’unité politique17. Cet argument suppose
évidemment d’admettre la nécessité d’une volonté générale, autrement dit d’une volonté
indivisible du peuple souverain, et par suite qu’un tel pluralisme institutionnel ne soit pas
l’instrument d’une authentique représentation du peuple ou de la population18. Et bien des
libéraux contestent précisément la notion même de volonté générale, sauf à en faire le résultat
mécanique de l’intégration des intérêts divergents19. C’est pourquoi cet argument ne doit
d’abord sa portée qu’à la situation de crise et de semi-guerre civile qui déchire alors
l’Allemagne, mais semble sans grandes conséquences sur la cohérence de la théorie libérale.
En revanche, l’ouvrage de 1932, Légalité et légitimité, développe un second argument qui
devait avoir beaucoup plus de succès dans le rang des libéraux eux-mêmes.
En effet, c’est au pluralisme politique, autrement dit à l’extension de la participation des
groupes sociaux à tous les niveaux de la formation de la volonté étatique, que le juriste
attribue une radicalisation de l’effort de neutralisation porté par le libéralisme. Et ce car
l’intégration d’intérêts toujours plus contradictoires dans les mécanismes de production de la
volonté étatique suppose que l’Etat demeure neutre à l’égard des valeurs adoptées par les
divers groupes sociaux. Or, cette conception toujours plus formelle de l’Etat et de la loi portée
par les libéraux est purement et simplement suicidaire selon Schmitt, car elle met
potentiellement les instruments de la légalité et de la puissance étatique au service de groupes
susceptibles d’en user contre les partis libéraux eux-mêmes, voire pour abolir les libertés
individuelles et renverser l’Etat de droit20.
La portée d’un tel argument lui a valu d’être largement commenté et repris, notamment pour
rediscuter les principes du libéralisme. Ainsi, pour certains auteurs, les analyses de Schmitt
montrent les dangers de la neutralité libérale à l’égard des valeurs et des différentes
conceptions du bien pour sa propre sauvegarde ; le libéralisme serait donc contraint
d’admettre un socle de valeurs incompressible, qui fonderait un juste principe de
discrimination des organisations tolérables et intolérables dans un Etat de droit21.
Schématiquement, le pluralisme devrait être relativisé pour sauver la démocratie libérale.
Pour d’autres auteurs au contraire, la sauvegarde d’une authentique démocratie libérale exige
de résister à la tentation d’imposer de telles valeurs univoques : c’est inversement l’idéal
d’une société naturellement harmonieuse qu’il faudrait écarter. De manière schématique
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Cette analyse, formulée dès 1923 dans Parlementarisme et démocratie, et qui repose sur l’opposition du
parlementarisme et de la démocratie, a alors pour objectif de montrer l’inadéquation du parlementarisme avec les
nouvelles conditions sociopolitiques de la vie allemande, en vue de défendre une définition plébiscitaire de la
démocratie.
18 Renaud Baumert, 2009, op. cit., p. 490.
19 Cf. en particulier Hans Kelsen, (1929), 2004, La démocratie. Sa nature-Sa valeur, trad. fr. Charles Eisenmann,
Paris, Dalloz.
20 En amont, l’émergence du pluralisme politique doit non seulement engendrer l’instrumentalisation la plus
égoïste de l’Etat parlementaire par des groupes organisés aux intérêts antagonistes, mais elle doit en outre donner
naissance à une politique généralisée du soupçon, où chaque parti peut craindre que l’autre n’use des moyens
offerts par la possession légale du pouvoir pour « refermer derrière lui la porte de la légalité, par laquelle il s’est
introduit, et traiter comme un vulgaire malfaiteur le parti politique adverse qui essaye peut-être, à grand coups de
bottes, de pénétrer par la même porte ». Schmitt (1932), 1990, « Légalité et légitimité », in Carl Schmitt, Du
politique. « Légalité et légitimité » et autres essais, trad.fr. William Gueydan de Roussel, Puiseaux, Pardès, p.
62).
21!Sur la question des valeurs incompressibles de la démocratie libérale posée par Carl Schmitt, cf. David
Dyzenhaus, 1998, « Why Carl Schmitt? », in D. Dyzenhaus (dir.), Law as Politics. Car Schmitt’s critique of
liberalism, Durham, Duke University Press, pp. 23-36.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%
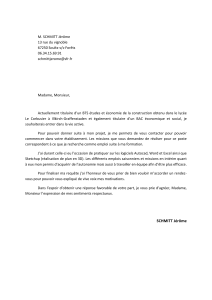
![[à supprimer] L`électronique analogique : le Trigger de Schmitt http](http://s1.studylibfr.com/store/data/005256093_1-d077aa204d9605ab9cd0c07f9fc1007a-300x300.png)