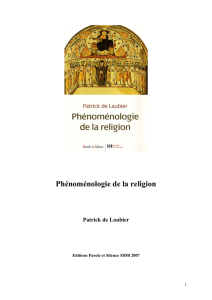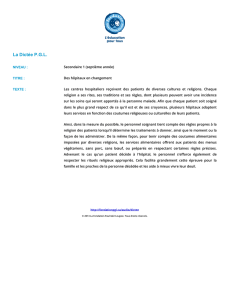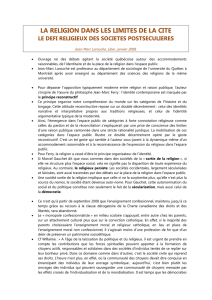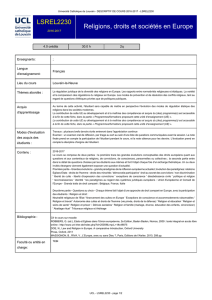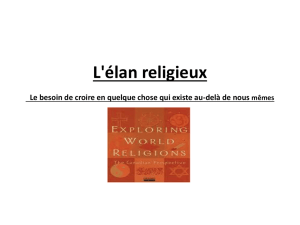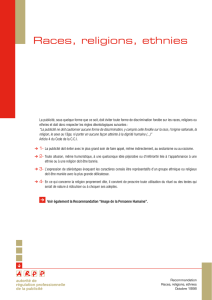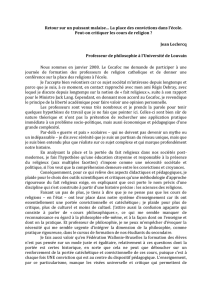Le symbolique et le sacré. Théories de la religion

camille tarot
le symbolique et le sacré
théories de la religion
ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE/M.A.U.S.S.
9 bis rue abel-hovelacque
PARIS XIIIe

Ouvrage publié avec le concours du Centre régional des lettres
de Basse-Normandie
Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffi t de vous
abonner gratuitement à notre lettre d’information bimensuelle par courriel, à partir de notre
site www.editionsladecouverte.fr, où vous retrouverez l’ensemble de notre catalogue.
ISBN 978-2-7071-5428-6
Ce logo a pour objet d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour
l’avenir du livre, tout particulièrement dans le domaine des sciences humaines
et sociales, le développement massif du photocopillage. Nous rappelons donc
qu’en application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle toute
photocopie à usage collectif, intégrale ou partielle, du présent ouvrage est interdite sans autori-
sation du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins,
75006 Paris). Toute autre forme de reproduction, intégrale ou partielle, est également interdite
sans l’autorisation de l’éditeur.
© Éditions La Découverte, Paris, 2008.

À la mémoire de ma mère,
née Suzanne Vadet (1914-2005).
À la mémoire de la jeune fi lle guayaki
sans doute morte du fait de sa tribu,
quand celle-ci mourait de notre fait.


« Or ce qu’expriment les religions, c’est l’expérience vécue
par l’humanité. »
Émile DURKHEIM, « Le dualisme de la nature humaine
et ses conditions sociales » (1914) [1987, p. 323].
« Les religions positives ont fait plus que disserter ou s’in-
terroger. Elles ont expérimenté. Peut-on ignorer ces sources
d’informations pratiques ? Pour le songe-creux qui en nous ne
dort jamais que d’un œil, attaché à ce qui se dit plutôt qu’à ce
qui arrive, le fait religieux a ceci d’instructif qu’il confronte le
songe à la réalité. Mieux que nos brèves fl ambées idéologiques,
cet analyseur, cette loupe anthropologique encore sous-utilisée
devrait nous aider à ne pas régler l’ordre du monde sur nos
désirs. »
Régis DEBRAY [2003, p. 17].
« Mon maître Henri Hubert rappelait volontiers que le man-
nequin brûlé lors de certaines cérémonies s’appelle (ou s’appe-
lait encore récemment) suivant les pays européens l’Arabe, le
Housar, le Juif, et que notamment au début du XXe siècle, dans
certains cantons fanatisés de chez nous, il portait le nom du
malheureux capitaine Dreyfus : cela n’empêchait pas le vieux
rituel de subsister, inchangé pour l’essentiel, avec ses gestes, sa
date, son intention. Il en est de même pour beaucoup de récits
traditionnels des mythologies... »
Georges DUMÉZIL [1949, p. 137-138].
« Effacer la genèse, ce serait oublier tout ce que l’acquis
doit au mode d’acquisition. »
François HÉRAN [1998, p. 5].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
1
/
62
100%