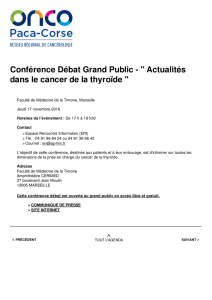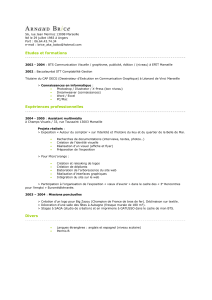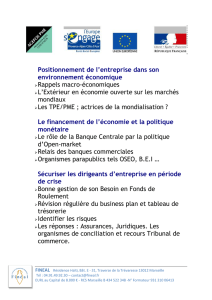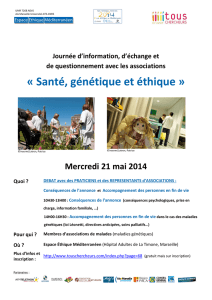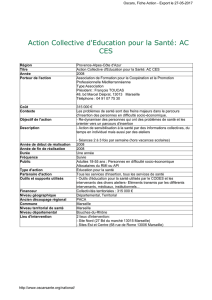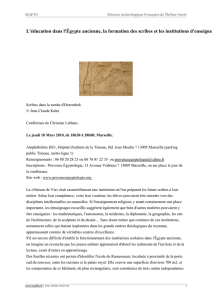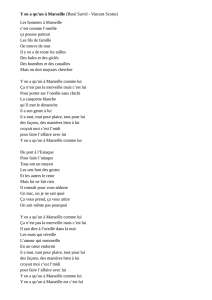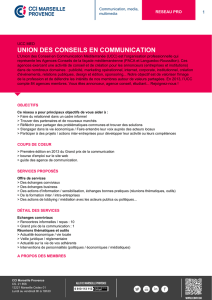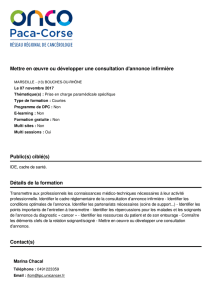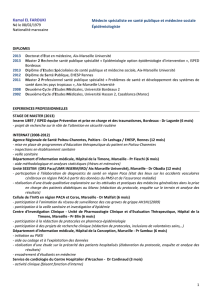Résumés des communications - AP-HM

VINGT-SEPTIEME CONGRES DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
M A R S E I L L E 17-18 J A N V I E R 2014
Sous le haut parrainage de :
Y. BERLAND.
Président d’AIX-MARSEILLE Université
G. LEONETTI. P.Y. GILLES.
Doyen de la Faculté de Médecine de MARSEILLE Doyen de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d’AIX-EN-PROVENCE
R
RE
EP
PR
RE
ES
SE
EN
NT
TA
AT
TI
IO
ON
NS
S
E
ET
T
M
MA
AL
LA
AD
DI
IE
ES
S
N
NE
EU
UR
RO
OD
DE
EG
GE
EN
NE
ER
RA
AT
TI
IV
VE
ES
S
CAMPUS SANTE TIMONE, AMPHITHEATRE MAURICE TOGA, 27 BOULEVARD JEAN MOULIN, 13005 MARSEILLE, FRANCE
Sous la présidence de :
B.F. MICHEL.
Président du Groupe de Recherche sur la maladie d’Alzheimer
Organisées par :
C. BASTIEN, M. BASTIEN, Y.E. GEDA, N. SAMBUCHI.
-

www.maladie-alzheimer-gral.com 2
Groupe de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer Campus Santé Timone, 27 boulevard Jean-MOULIN, 13005 MARSEILLE.
AVANT PROPOS
L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE
Le thème de « représentations dans les maladies neurodégénératives » a été élaboré, comme une évidence, par les organisateurs
de ce XXVIIème congrès du GRAL, Claude et Mireille BASTIEN, Yonas GEDA, Nathalie SAMBUCHI et moi-même, au fur et à mesure
que s’organisait notre réflexion sur le mode de désintégration précoce et progressive des fonctions cognitives les plus élevées, à la
phase initiale des maladies neurodégénératives, dont nous sommes amenés à faire le diagnostic, au sein de ce que le législateur a
appelé de façon extrêmement réductrice les « consultations mémoires » de nos hôpitaux. Représentation de soi, représentation de
l’autre, représentation du monde. Et c’est bien dans cet interface des confins de la Neurologie et de la Psychiatrie, autrefois appelé
Neuropsychiatrie et que l’on désigne aujourd’hui, de façon moderne par « Neurologie Comportementale » que doit se situer
l’analyse sémiologique du Neurologue, confronté à la plainte d’un patient qui ressent de façon confuse qu’il est déshabillé
intérieurement de ce qui construit son moi profond, tant au niveau de son contrôle émotionnel et cognitif que moteur. La nouveauté
et la modernité de la Neurologie dans ce domaine est constitué par l’intégration complète qui doit être réalisé au sein des équipes
hospitalière, comme Christian DEROUESNE l’a toujours appelé de ses vœux, entre les Neurologues et les Psychologues. Grace à
l’appui constant de Claude et Mireille BASTIEN, nous avons pu le réaliser au CHU de MARSEILLE, en particulier grâce au master
des perturbations cognitives, au travers duquel chaque année, un nombre important d’étudiants en Psychologie viennent en stage
dans notre service. Ce que nous ont appris de plus nos collègues américains de la MAYO-clinique, Ronald PETERSEN, Bradley
BOEVE et Yonas GEDA, c’est que, au-delà de collaboration organisée entre la Neurologie et la Psychologie, c’est l’intégration totale
dans une équipe, où chacun à sa place, bénévoles, secrétaires, infirmières, psychologues et médecins, qui doit être réalisée,
tendant à une prise en charge optimale du malade et de sa famille. C’est ce que nous avons tenté de construire, avec l’aide du chef
de pôle de Psychiatrie J-M. AZORIN, au sein du service de Neurologie Comportementale des Hôpitaux sud de MARSEILLE. Que
tous nos collaborateurs soient remerciés pour ce meilleur d’eux même, qu’ils apportent à nos malades, chaque jour. Définir le
concept de représentation sera l’objet de nos réflexions et discussions, tout au long de ce congrès, dont nous savons qu’il sera
passionnant et novateur. Mais plus que de longs commentaires, ce qu’est une représentation, saute aux yeux lorsque l’on observe
attentivement les magnifiques tableaux de Lucas CRANACH qui ont servi d’affiche à ces XXVIIèmes journées du GRAL.Puisse vous
cela vous donner envie de gouter aux fruits de l’arbre de la connaissance des neurosciences cognitivo-comportementales !.
Bernard François MICHEL
EQUIPE DU SERVICE DE NEUROLOGIE COMPORTEMENTALE DES HOPITAUX SUD DE MARSEILLE
M-M. BLANC
M. PERTUZOT
C. STISSI
B. SANNA
Z. CHECKCHOUK
E. JAUVERT
I. MURACCIOLI
J. BISOTTI
E. ALBRAND
N. SAMBUCHI
F. CHEN
C. GALLANT
A. BARTOLIN
J-C. SAINT-JEAN
C. ROUYER
P. BENSA
D. TAMMAM
B.F. MICHEL

www.maladie-alzheimer-gral.com 3
Groupe de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer Campus Santé Timone, 27 boulevard Jean-MOULIN, 13005 MARSEILLE.
ORGANISATION
Sous le haut parrainage :
DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER DE LA MAYO-CLINIC
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE NEUROLOGIE
DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LES EVALUATIONS COGNITIVES
DU COLLECTIF NATIONAL ALZHEIMER
Avec le soutien :
DE LA VILLE DE MARSEILLE
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
DE LA FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE
DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE
DU SERVICE DE NEUROLOGIE COMPORTEMENTALE DES HOPITAUX SUD DE MARSEILLE
DU SERVICE DE NEUROLOGIE DE L’HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES DE MARSEILLE
Avec la participation des CHU de :
MARSEILLE
MONTPELLIER
NICE
NIMES
PARIS
TOURS
Avec le concours des Laboratoires :
NOVARTIS
TEVA

www.maladie-alzheimer-gral.com 4
Groupe de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer Campus Santé Timone, 27 boulevard Jean-MOULIN, 13005 MARSEILLE.
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU GRAL
Y.E. GEDA
Président
B. ALESCIO-LAUTIER
P. BARRES
R. BARTOLIN
P. BONHOMME
C. DEROUESNE
B. DIADEMA
A-M. ERGIS
M-C. GELY-NARGEOT
C. HAZIF-THOMAS
B. KULLMAN
M-P. PANCRAZI
J-C. SAINT-JEAN
N. SAMBUCHI
G. SERRATRICE
L. TACONNAT
J-M. VERDIER
F. VERDUREAU

www.maladie-alzheimer-gral.com 5
Groupe de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer Campus Santé Timone, 27 boulevard Jean-MOULIN, 13005 MARSEILLE.
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
VENDREDI 17 JANVIER 2014
07H30. Accueil des participants.
08H00. Cérémonie d’ouverture : B.F. MICHEL, C. DEROUESNE, G. LEONETTI, B. GILLES.
PREMIERE SESSION : REPRESENTATIONS DONNEES DE BASE
Modérateurs : H. BECKER, M. BASTIEN.
08H30. Aux sources des représentations : C. BASTIEN (AIX-EN-PROVENCE).
09H00. Les neurones miroir : F. SARGOLINI (MARSEILLE).
09H30. Représentation et anatomie fonctionnelle des lobes frontaux : C. ASSAÏANTE (MARSEILLE).
10H00. Historique du concept de représentation en Neurologie : B. KULLMANN (NICE).
10H30. Pause café.
DEUXIEME SESSION : REPRESENTATIONS DE SOI ET COGNITION
Modérateurs : J-C. SAINT-JEAN, M-C. GELY-NARGEOT.
11H00. Représentation de soi et cognition, les modèles : L. TACONNAT (TOURS).
11H30. Représentation de soi et cognition, les méthodes d’évaluation : N. SAMBUCHI (MARSEILLE).
12H00. Valeur de l’introspection : P. LIVET (AIX-EN-PROVENCE).
12H30. Qu’est-ce que le SCI : Y.E. GEDA (SCOTTSDALLE).
13H00. Repas de travail.
TROISIEME SESSION : REPRESENTATIONS DE SOI ET EMOTIONS
Modérateurs : C. BASTIEN, F. BILLE.
14H30. Représentation de soi et émotion, modèles et méthodes d’évaluation : M-C. GELY-NARGEOT (MONTPELLIER).
15H00. Représentation théâtrale de soi et maladie d’ALZHEIMER : A-M. ERGIS (PARIS).
15H30. Modélisation de l’angoisse dans le MCI : P. BONHOMME (NICE).
16H00. Manifestations émotionnelles dans les affections neurodégénératives : J. ACOSTA (SCOTTSDALLE).
16H30. Pause café.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%