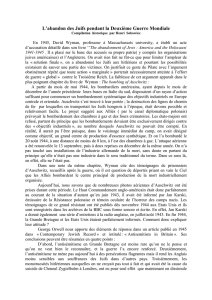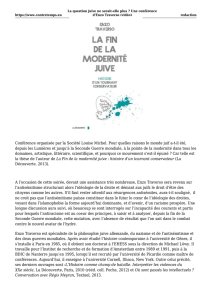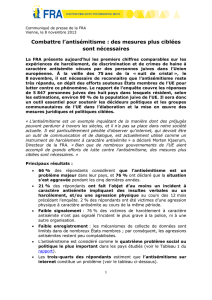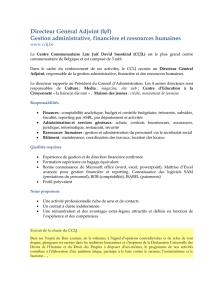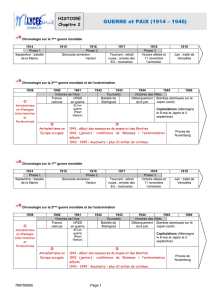L`absence d`antisémitisme ne suffit nullement. Variations 2, Jacques

Die Zukunft gehört den Phantomen (Programm 7/7 2014)
L’absence d’antisémitisme ne suffit nullement
L’œuvre de Derrida, une hantologie. Soit ! Mais qu’est-ce qu’agitent, ou qu’est-ce qui agite, les
spectres ? Une hantologie, ne serait-ce que dans sa forme, laquelle interdit la collation, la
sommation : des livres, plus d’un livre, une cinquantaine, peut-être une centaine, des articles,
des cours, des conférences, dans toutes les langues, et des inédits, un peu partout. « Tout
Derrida » : l’expression a-t-elle même un sens ? Une œuvre aux bords incertains,
indéterminables, indécidables. Derrida, peu avant sa mort, dans l’entretien accordé à Jean
Birnbaum dans le Monde, pose la question de cette indécidabilité : « j’ai simultanément, je
vous prie de me croire, le double sentiment que, d’un côté, pour le dire en souriant et
immodestement, on n’a pas commencé à me lire, que s’il y a, certes, beaucoup de très bons
lecteurs (quelques dizaines au monde, peut-être), au fond, c’est plus tard que tout cela a une
chance d’apparaître : mais aussi bien que, d’un autre côté, quinze jours ou un mois après ma
mort, il ne restera plus rien. Sauf ce qui est gardé par le dépôt légal en bibliothèque ; je vous le
jure, je crois sincèrement et simultanément à ces deux hypothèses. » L’œuvre, donc, peut-être :
sous la condition du désoeuvrement, de la disparition qui la constitue.
J’invoquerai (comme on peut invoquer les fantômes) ici, quant à ce désoeuvrement, Proust, au
seuil de la Recherche : le hasard. « Il y a beaucoup de hasard en tout ceci, et un autre hasard, celui de
notre mort, souvent ne nous permet pas d’attendre longtemps les faveurs du premier ». Le hasard de la mort,
hasard par excellence se redouble du hasard – dit Proust - de ce qui conjure la mort, les
situations romanesques (« mort à jamais, peut-être pas… »), L’œuvre, selon quoi le hasard est
converti en nécessité. Finalement cet entrelacement (Verflechtung : « la vue de la couverture
d’un livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d’une lointaine nuit
d’été ») de la mort et de la littérature. « Des livres, s’il y en a… », Dit, de manière récurrente,
Derrida. Et Levinas : « plus intime que l’intimité, c’est un livre », affirmant une intériorité,
palimpseste à l’extériorité phénoménologique du monde.
Je pose que les fantômes sont cette intrication du hasard et de la nécessité.
Intrication du hasard et de la nécessité : le spectre qui hante l’Europe, c’est-à-dire hante la
philosophie. Treibt sein Unwesen : Husserl en convient, au moment même où voulant conjurer le
spectre il pressent que l’Europe est livrée à cet Unwesen – « das Unwesen der gegenwärtigen Krise ».

Et dans un appendice de Zeitbewusstsein : « De temps à autre, après de longs efforts, la clarté
tant désirée nous fait signe, nous croyons les résultats les plus magnifiques si proches de nous
que nous n’aurions plus qu’à tendre la main. Toutes les apories semblent se résoudre, le sens
critique tranche les contradictions par le calcul, et il ne reste plus dès lors qu’un dernier pas à
accomplir. Nous faisons le total ; nous commençons avec un « donc » très conscient : et alors
nous découvrons tout à coup un point obscur, qui ne cesse de s’accroître. Il se développe en
énormité effrayante, qui engloutit tous nos arguments et anime d’une vie nouvelle les
contradictions que l’on venait de trancher. Les cadavres revivent et se dressent en ricanant. Le
travail et le combat reprennent au point de départ. »
Mitunter winkt uns nach langen Mühen die ersehnte Klarheit, wir glauben die herrlichsten Resultate uns so
nahe, dass wir nur danach zu greifen brauchten. Alle Aporien scheinen sich zu lösen, die kritische Sense mäht
die Widersprüche reihenweise nieder, und nun bleibt noch ein letzter Schritt : wir ziehen die Summe, wir
beginnen mit einem selbstbewussten « Also : und nun entdecken wir mit einemmal einen dunklen Punkt, der
sich immer vergrössert ; er wächst empor zu einem greulichen Ungeheuer, das alle unsere Argumente verschlingt
und die so eben niedergemähten Widersprüche mit neuem Leben beseelt. Die Leichname werden wieder lebendig
und grinsen uns hohnlächelnd an. Die Arbeit und der Kampf beginnt von vorn. »
Les spectres sont là, précisément, dans cet entrelacs, ils parlent, nous ne les entendons qu’à
peine ; ils parlent de cette voix qui se confond avec le bruit ambiant, voix caverneuse et
silhouettes improbables défilant sur le mur, au fond de la caverne ; bruissement du silence, qui
déchire l’horizon : hören Sie denn nicht diese entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit, und
die man gewöhnlich die Stille heisst ? » (Büchner, Lenz) ; silence, voix, « le silence fuyant du cri
innombrable » (Blanchot, L’Ecriture du désastre) ; spectres et voix, dès le début, chez Derrida :
La voix et le phénomène, la citation de Poe en exergue : « et maintenant – maintenant – je suis mort »,
avec l’entrelacs, la Verflechtung, relevé dès le coup d’envoi de la phénoménologie, de l’indice et
de l’expression (Anzeichen, Ausdruck). C’est tout, mais ce n’est pas tout, ce n’est jamais tout,
justement : au-delà d’une œuvre océanique, quarante ans plus tard, quand se referme la
dernière page, quand « l’air immense ouvre et referme le livre », ces paroles de la fin, d’après la
fin, au cimetière :
« Mes amis ! Je vous remercie d’être venus. Je vous remercie pour la chance de votre amitié. Ne pleurez pas.
Souriez comme je vous aurais souri. Je vous bénis. Je vous souris, où que je sois. »
Sont-ce les paroles qui ont été prononcées sur la tombe ? Présent, je les ai peut-être entendues,
ou à peine, murmurées devant la foule des amis venus de partout, par l’un des fils de Derrida,
puis reçues, le lendemain de la cérémonie, dans un mail. Sont-elles de lui, de Derrida ?

Et si elles ont vraiment été retranscrites, l’ont-elles été correctement ? Quoi qu’il en soit, elles
sont vraisemblables, ressemblantes : ne ressemblent-elles pas à Derrida ? Néanmoins, quelle
serait cette semblance, que voudrait dire « ressembler à Derrida » ?
La question se pose d’autant plus qu’un second texte se superpose à celui-là, à son tour lui
ressemblant. En effet, au début de l’hommage publié dans la revue du Collège international de
philosophie – institution, ou insolite instance, voulue par Derrida – on trouve, attestée par la
photocopie d’un autographe, les lignes suivantes :
« Jacques n’a voulu ni rituel ni oraison. Il sait par expérience quelle épreuve c’est pour l’ami qui s’en charge. Il
me demande de vous remercier d’être venus, de vous bénir, il vous supplie de ne pas être tristes, de ne penser
qu’aux nombreux moments heureux que vous lui avez donné la chance de partager avec lui.
Souriez-moi, dit-il, comme je vous aurai souri jusqu’à la fin.
Préférez toujours la vie et affirmez sans cesse la survie. »
Faudrait-il estimer que ce second texte est le vrai, l’original, dont le premier ne serait qu’une
approximation mal entendue et retranscrite de façon incertaine ? Je ne le crois pas. Je ne le
crois pas car le second texte, qui dit presque la même chose que le premier, remplit cependant
une autre fonction. Parlant de Derrida (« Jacques ») à la troisième personne, comme d’un
absent dont on rapporterait les paroles ou les intentions, avant de se clore par une citation
directe, il réserve la place du sujet de l’énonciation, confié à lui mais de façon indécidable se
confondant avec le sujet de l’énoncé. Jacques parlerait alors de Jacques, ou, plus précisément,
Jacques vivant parlerait depuis sa mort anticipée, absent lui-même – c’est-à-dire mort – dans
cette anticipation, du Jacques mort, présent-absent dans l’énoncé qu’il aurait anticipé :
dispositif complexe de la survie et improbable chassé-croisé, crossing over, des sujets au cours
duquel la présence attestée de l’énonciation rend indécidable l’énoncé même qu’elle profère.
Ou encore, c’est le témoignage du disparu qui témoigne pour le témoin disparu, de ce fait
laissant disparaître jusqu’à la disparition du témoin. L’indécidabilité, au contraire, dans le
premier texte, porte sur la réalité de l’énonciation elle-même. Les deux versions se complètent
ou se superposent, incertaines comme le vent dans un cimetière, se ressemblent si la
semblance est celle, comme le dit Blanchot, de la semblance cadavérique - improbable et
inaudible parole d’un mort.
C’est justement avec Blanchot que je voudrais à présent enchaîner : Blanchot qui joue un rôle
très singulier dans le tryptique revendiqué par Derrida en 1980 lorsqu’à la Sorbonne, devant
Pierre Aubenque, Jean-Toussaint Desanti, Henri Joly, Gilbert Lascault et Emmanuel Levinas il
soutient sa thèse, « sur travaux ».

Trois noms sont invoqués, sous le patronage desquels Derrida place l’œuvre, « son » œuvre,
déconstructrice et spectrale : Heidegger, Blanchot, Levinas. Ces trois noms ne sont pas
symétriques, ils ne jouent pas l’un et l’autre le même rôle. Un seul de ces trois est présent ;
entre les trois, de l’un à l’autre, passe quelque chose dans cette étrange et paradoxale
cérémonie de la thèse, qui est comme l’indice – Anzeichen – de ce qui se soustrait au regard
acribique de l’université : mais cela de manière complexe, dans la conjonction et la disjonction
des trois. Blanchot, invoqué en second, joue, selon ce que j’en entends aujourd’hui, un rôle qui
n’est évidemment pas celui de médiation, mais qui par sa culture, par sa langue, est
effectivement au milieu, entre les deux autres, proche des questions par lesquelles Derrida se
laisse interpeller par la singularité de Heidegger et de Levinas.
Certes, Heidegger, Blanchot, Levinas, Derrida sont morts. Ce n’est pas cela qui ferait d’eux
des spectres. Il faudrait encore que ce qui fut pour eux l’avenir et qui leur appartenait
(gehören) – je rejoins donc l’intitulé de notre colloque – ne soit pas notre présent : cas où ce
présent, dans l’incertitude de la parole spectrale, resterait peu audible (kaum hörbar), peut-être
définitivement inaudible et inouï (unerhört). De cet inaudible je me propose maintenant de
retenir une expression prononcée de leur vivant – tous étaient encore en vie, et chacun, à sa
manière l’a entendue - mais une expression sans doute inaudible (unhörbar) et inappropriable
pour chacun d’entre eux, inaudible et inappropriable en des sens différents, et en un sens
encore tout autre entendue également par nous et néanmoins inaudible. Elle figure dans une
lettre envoyée par Blanchot à Levinas : « l’absence d’antisémitisme ne suffit nullement ».
Formule insolite, voire irritante et choquante : et il n’arrange rien qu’elle soit de Blanchot. Ce
dernier n’est-il pas, comme y revient un numéro récent de la revue Lignes, celui qui est le
moins bien placé pour s’avancer sur le sujet de l’antisémitisme ? N’a-t-il pas été antisémite lui-
même ? N’a-t-il pas, surtout, menti sur cet antisémitisme, tergiversé à l’infini sans s’expliquer
véritablement, sans faire l’amende honorable qu’au minimum on aurait attendu de lui ? Je ne
voudrais cependant pas me précipiter pour conclure qu’il ne s’agit avec cette formule que de la
dénégation de Blanchot quant à un passé inavouable. Regardons-la, restituons-lui déjà son
contexte et peut-être sa vérité, incertaine et indécidable pour celui qui l’a prononcée, pour
celui à qui elle fut adressée, et pour celui, absent de l’échange, mais dont il est d’une certaine
façon toujours question (ne serait-ce pas là une répétition inédite du tryptique de la question :
das Gefragte, das Befragte, das Erfragte ? Comme si, sur ce thème particulier de l’antisémitisme,
une certaine qualité de l’absence – l’absence spectrale – supplémentait le registre propre de la
question).

Voici donc la manière, embarrassée, interloquée peut-être, dont Levinas évoque la formule qui
lui est adressée par Blanchot. C’était à un colloque des Intellectuels juifs de langue française,
en 1969, colloque portant sur la Révolution :
« L’auteur de cette lettre occupe une place éminente dans le monde littéraire français d’aujourd’hui, si d’un
homme comme lui on peut dire qu’il occupe une place sans le choquer par tout ce que l’idée même de place
occupée – et serait-elle pure métaphore – évoque de bourgeoisie et de confort. Je ne vous dirai pas son nom. Aux
événements de mai il a participé d’une façon totale mais lucide. Il y fut associé dangereusement au-delà du mois
de mai. Et voici qu’il se retire brusquement. »
Remarquables précautions oratoires : comme si les circonstances particulières, pittoresques
même, de mai 68 dans lesquelles Blanchot fut engagé, représentaient une explication ou une
introduction à l’extravagance de la proposition qui va suivre ; comme si Levinas lui-même ne
venait pas à bout de cette extravagance, et comme si cette extravagance trouvait sa place à cet
endroit précis d’une leçon talmudique dans laquelle, réfléchissant à ce qui mérite de s’appeler
révolution, il en arrivait à la conclusion que la lutte des classes était elle-même précédée par
une exigence plus élevée, contenue dans le judaïsme (plus tard, dans un texte de 1975 il notera
« le racisme n’est pas un concept biologique ; l’antisémitisme est l’archétype de tout
enfermement ; l’oppression sociale elle-même ne fait qu’imiter ce modèle »). Mais, objectera-t-
on encore, n’est-on pas simplement en présence d’un penseur juif qui revendique, en
s’appuyant sur le témoignage d’un ami prestigieux, lequel lui-même cherche à compenser le
souvenir d’un passé douteux, son enracinement dans une culture particulière ? Ce serait
méconnaître le prestige que conserve la révolution dans l’imaginaire personnel de Levinas. Il
lui arrive ainsi de mentionner Lénine, voire de faire appel à Trotsky pour définir la tâche de la
philosophie, c’est-à-dire la tâche de la phénoménologie. « Et c’est la révolution de la réduction
transcendantale : révolution permanente », écrit-il dans l’article « La philosophie et l’éveil ».
Voilà donc la quatrième internationale propulsée, au prix d’un rapprochement acrobatique, au
plus près de ce qu’il y a aux yeux de Levinas d’incandescent dans la pensée, l’énigme de la
réduction, énigme assimilée donc ainsi au judaïsme.
Après cette entrée en matière si singulière de Levinas, j’en viens à la lettre de Blanchot :
« Non, j’ai toujours dit que là était la limite que je ne franchirai pas, mais maintenant je voudrais un instant
m’interroger… Me demander pourquoi ces jeunes gens qui agissent dans la violence, mais aussi la générosité,
ont cru devoir faire un tel choix, ont joué l’irréflexion, l’usage de concepts vides (impérialisme, colonisation) et
aussi le sentiment que ce sont les Palestiniens les plus faibles et qu’il faut être du côté des faibles (comme si
Israël n’était pas extrêmement, effroyablement vulnérable) [Levinas éprouvant le besoin de préciser
alors : « les deux Israël, je pense : M. Israël, et l’Etat d’Israël, car Israël c’est la vulnérabilité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%