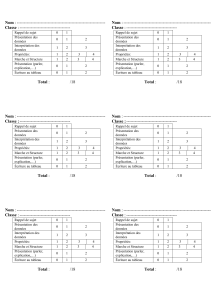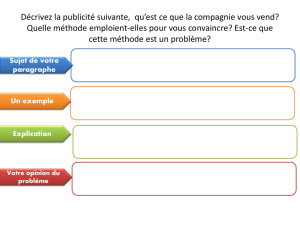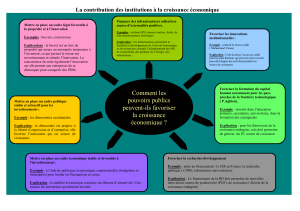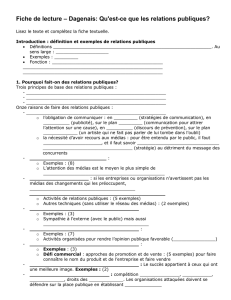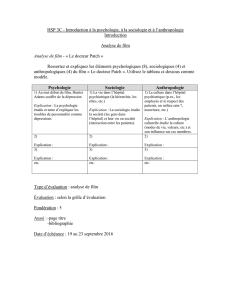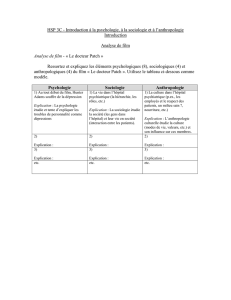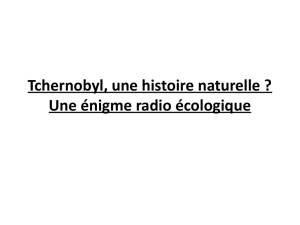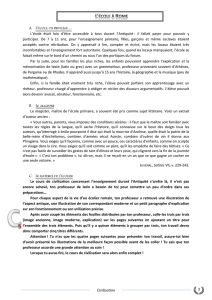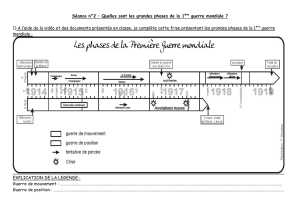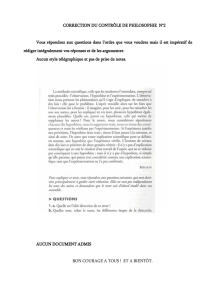Action - Pacherie

Action: délibérer, décider, accomplir
I. L'explication de l'action:
Causes et Raisons
Elisabeth Pacherie

Plan
• Introduction générale
– Les grands problèmes de la philosophie de l'action:
– Organisation des séances
– Conseils bibliographiques
• Raisons et causes
– Le volitionnisme classique et ses présupposés
– Critique du volitionnisme
– L'approche intentionnaliste ou téléologique

Les grands problèmes de la
philosophie de l'action
•La structure de l'action: identification et
description de ce qui distingue actions et non-
actions, des différents types d'actions, normales
ou déviantes, et des différents types de
déterminants de l'action.
•Explication de l'action: expliciter la structure,
les présupposés et la portée des différents types
d'explication de l'action
•Normativité de l'action: clarifier la signification
des notions normatives ou semi-normatives se
rapportant à l'action: responsabilité, rationalité,
autonomie, liberté, agentivité.

La structure de l'action

La question critique de l'action
• (Sur la question critique de l'action, voir
Descombes, 1995)
– "N'oublions pas ceci: lorsque "je lève mon bras", mon
bras se lève. Et le problème surgit: que reste-t-il si je
soustrais le fait que mon bras se lève du fait que je
lève le bras?" (Wittgenstein, IP § 621)
– Quelles sont les conditions qui doivent être données
pour que l'on puisse décrire un ensemble de
mouvements comme une action?
• Présupposé sous-jacent à la question critique:
– Les mouvements corporels, considérés en eux-
mêmes sont "incolores", au sens où les mouvements
corporels ne comportent pas de traits observables
dont la présence permettrait de dire qu'on a affaire à
une action.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%