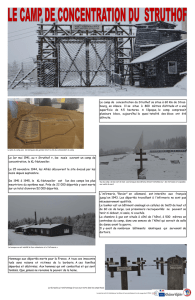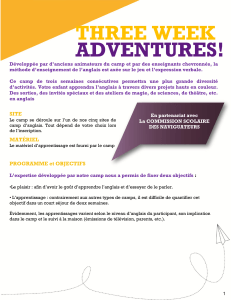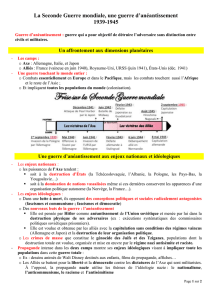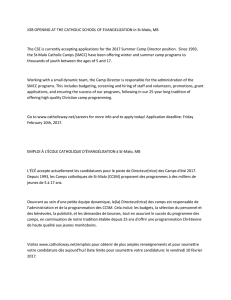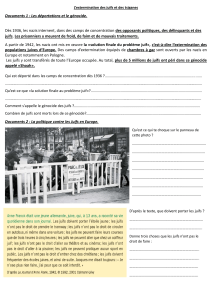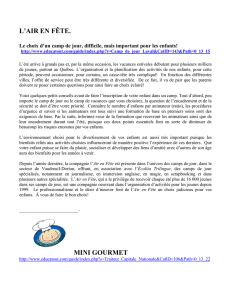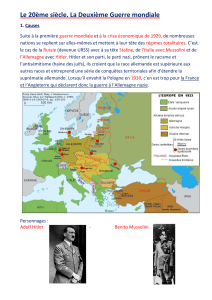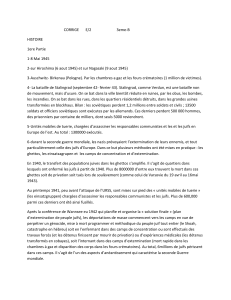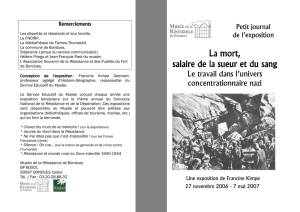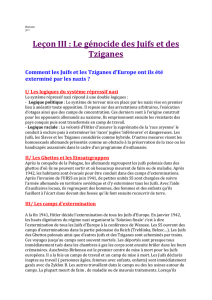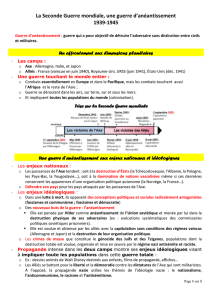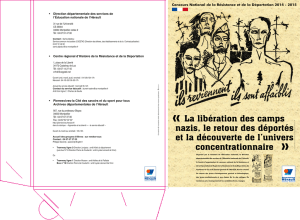Le dossier pédagogique - Pierresvives


2

Concours national de la Résistance et de la Déportation
Année scolaire 2011- 2012
Résister dans les camps nazis
Résister dans les camps nazis
Bulletin officiel n°23 du 9 juin 2011
On présentera les différentes formes qu’a pu prendre cette résistance et les
On présentera les différentes formes qu’a pu prendre cette résistance et les
valeurs qu’en transmettent les déportés par leurs témoignages.
valeurs qu’en transmettent les déportés par leurs témoignages.

4

AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS
Il y a 65 ans lors du retour des déportés dans les salons de l’Hôtel Lutecia, aucun
membre de la commission d’accueil ne leur a posé la question. « En attendant la mort
promise par vos bourreaux, qu’avez-vous fait là bas » ?
Peut être ces rescapés de l’univers concentrationnaire étaient-ils eux-mêmes incapables
de dire pourquoi et dans quelles circonstances ils avaient lutté, pour pouvoir conserver
un minimum de forces physiques et morales, pour résister. Ils l’ont fait soit par conviction
politique, religieuse, patriotique ou tout simplement par l’horreur ressentie en découvrant
la brutalité et la barbarie de leurs tortionnaires. Et pourtant les différents témoignages
recueillis nous prouvent que pour beaucoup, la flamme ne s’est pas éteinte et, qu’avec
des moyens souvent dérisoires, prenant le risque de la condamnation à mort sans appel,
ils ont osé résister.
Vous allez découvrir en écoutant ces témoignages que la moindre attitude contraire à
l’ordre établi, qui nous paraît aujourd’hui anodine, était une victoire pour celui ou celle qui
l’accomplissait mais aussi une victoire sur la machine de guerre nazie.
Leur engagement et leur courage ont permis à ces hommes et à ces femmes, dont
beaucoup ne survivront pas à leur libération, de résister et de prouver que dans les pires
conditions tout individu peut dire non et rester debout.
Ils ont lutté en espérant retrouver un jour leur dignité et leur liberté.
Cette liberté c’est la vôtre.
Ne l’oubliez pas et ne les oubliez pas.
Le Président du Comité d’Organisation du Concours
Jean-Pierre HUGON
Jean-Pierre HUGON
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
1
/
58
100%