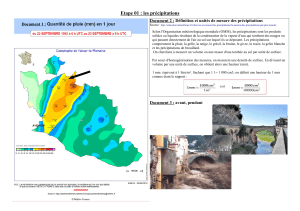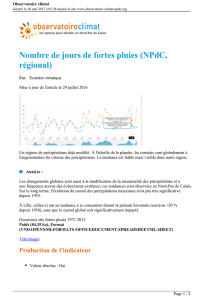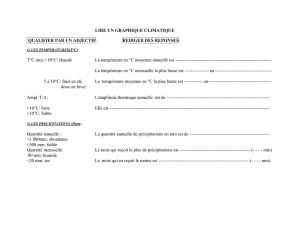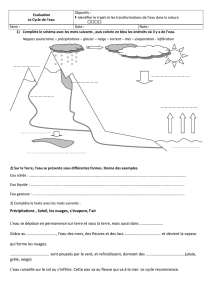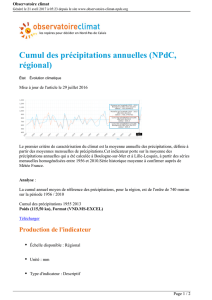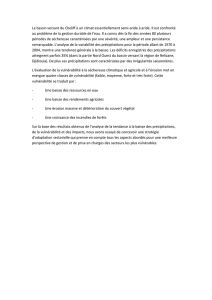situation active de précipitations

Diese Seite ist momentan in keiner Sprache verfügbar!
Actualités météorologiques
11 avril 2006, Christophe Salamin
1. Contexte météorologique et situation synoptique
1.1 La dynamique d'altitude
La situation météorologique telle qu'elle se présenta durant le week-end du 9 au 10 avril 06 offrit de nombreuses
similitudes avec la situation de fortes chutes de neige de début mars qui avaient affecté le nord du Plateau Suisse.
D'un point de vue synoptique, elle se caractérisa dimanche à 12Z par la présence d'une dépression relativement
peu creusée (1005 hPa) mais de grande ampleur au large de l'Espagne ainsi que par un profond talweg, avec une
courbure très marquée, s'étirant de la Bretagne au centre de la Norvège. Un courant jet de 100 à 120 kt environ
se trouvait sur le flanc sud de la dépression Atlantique, s'étendant du sud du Portugal aux Pyrénnées, alors que le
talweg était encadré - au niveau 300 hPa - par des vents compris entre 120 et 140 kt. Le déplacement progressif
vers l'est de la pointe de ce talweg et la conjonction - entre dimanche 9 avril à 12Z et lundi 10 avril à 12Z - des
deux coeurs de jet susmentionnés au voisinage des Alpes furent à l'origine d'une frontogenèse très dynamique.
L'ascendance de grande échelle provoquée par la dynamique d'altitude se matérialisa sous la forme d'une
dépression de basse couche, invisible encore au niveau de pression 500 hPa, mais clairement distincte au niveau
850 hPa (environ 1500 m), comme l'illustrent les cartes ci-dessous :
Inondations des 9/10 avril 2006
Carte du niveau 300 hPa du 9 avril à 12Z (analyse)
agrandir.jpeg, 319 KB Carte du niveau 300 hPa du 10 avril à 12Z (
a
agrandir.jpeg, 359 KB
Seite 1 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006
18.04.2006htt
p
://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite
_
meteo/inondation
_
des
_
9
_
10.html

Au niveau 500 hPa, le fait que les isobars soient parallèles à la ligne de front eut pour résultat un déplacement
très lent de la perturbation - s'étendant des Pyrénnées à l'Allemagne - vers l'est, déplacement également
contrarié par une situation de foehn dans les Alpes. La formation d'une dépression de basse couche au niveau 850
hPa accentua encore cette stationnarité du front.
1.2 Conflit de masses d'air et apport d'humidité
Les ascendances dynamiques seules ne suffisant pas pour générer de fortes précipitations, il faut rechercher dans
un conflit de masse d'air très marqué une des principales causes des récentes intempéries. Un gradient de
températures nord sud au-dessus de la France et des Alpes était présent depuis plusieurs jours déjà, l'air chaud
étant entraîné de la Méditerranée vers le nord par la dépression Atlantique, l'air froid s'écoulant dans un courant
de nord-ouest des îles britanniques aux Alpes. Entre samedi 8 et dimanche 9 avril, ce gradient de température
s'accentua et l'apport d'humidité en provenance de la Méditerranée se fit plus marqué sous l'effet d'un
renforcement généralisé des vents de sud-ouest. C'est au niveau 850 hPa également que se distingue le mieux ce
conflit de masses d'air, comme en témoigne l'image ci-dessous. L'apport d'humidité nécessaire aux fortes
précipitations est également très net sur la carte du vent au niveau 850 hPa (environ 1500m). La confrontation
entre l'air chaud et humide au sud, et l'air froid et sec au nord est illustrée sur l'image de droite représentant le
taux d'humidité au niveau 700 hPa (env. 3000 m.).
Carte du niveau 500 hPa le 10 avril à 00Z (analyse). La
dépression fermée n'est pas visible à ce niveau.
agrandir.jpeg, 335 KB
Carte du niveau 850 hPa du 10 avril à 00Z (
a
dépression fermée au-dessus des Alpes est
c
agrandir.jpeg, 307 KB
Cette carte permet de
distinguer la masse d'air
chaud (en bleu) de la masse
d'air froid en provenance du
nord (en vert). Comme on le
Cette carte des vents au
niveau 850 hPa montre bien
la provenance
Méditerranéenne de la masse
d'air dirigée vers la Suisse
romande. La grandeur des
Cette carte illustre la
différence de taux d'humidité
entre les deux masse d'air au
niveau 700 hPa (env. 3000
m). L'échelle (en %
Seite 2 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006
18.04.2006htt
p
://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite
_
meteo/inondation
_
des
_
9
_
10.html

2. Observations et relevés
2.1 Evolution de la pression au sol et déplacement du front
Entre le samedi 8 et le lundi 10 avril 06, on assiste progressivement à la rencontre des deux masses d'air
originaires respectivement de Méditerranée et des îles britanniques, puis à la frontogenèse au-dessus de la France
et enfin au lent déplacement de l'ensemble du système vers l'est, accompagné de la formation de la petite
dépression secondaire au-dessus des Alpes entre le dimanche 9 et le lundi 10.
2.2 Relevés des stations ANETZ et répartition des précipitations
2.2.1 Relevés du réseau d'obervation
En Suisse romande, l'essentiel des précipitations se produisit entre le dimanche 9 avril à 11h00 et le lundi 10 avril
à 20h00. En Suisse alémanique, ces précipitations se poursuivirent durant une partie de la journée de mardi en
raison d'une situation de barrage de secteur nord assez dynamique.
La première carte ci-dessous donne l'évolution des précipitations durant la période susmentionnée pour certaines
stations du Plateau. Les précipitations furent en moyenne de l'ordre de 1 à 3 mm/h, avec des pointes entre 4 et 8
mm/h. C'est durant la nuit de dimanche à lundi que se produisirent les précipitations les plus abondantes en
Suisse romande. Cette période correspond au passage de la zone d'ascendance maximale liée à la dynamique
d'altitude. Lundi, les précipitations se poursuivirent durant toute la journée, mais avec une intensité moindre.
La carte de droite montre la somme de précipitations enregistrées aux différentes stations du réseau ANETZ.. On
constate des cumuls de 50 à 80 mm en 36 heures environ sur l'ensemble du Plateau, avec une pointe à 85 mm
dans la région Lausannoise. On constate d'une part que les régions intra-alpines (Valais central et Grisons) ont été
épargnées par ces intempéries, d'autre part que le sud des Alpes a également été copieusement arrosé. Cette
région, pour des raisons climatologiques, est cependant nettement moins sensible aux fortes précipitations que le
nord des Alpes et possède un seuil de tolérance particulièrement élevé.
constate, le gradient de forte
température est très marqué
et passe juste au-dessus des
Alpes le dimanche 9 avril à
12Z
agrandir.jpeg, 358 KB
flèches, proportionnelle à la
vitesse du vent, donne
également un aperçu de
l'intensité de cet apport
d'humidité.
agrandir.jpeg, 463 KB
d'humidité) est indiquée au
bas de l'image.
agrandir.jpeg, 240 KB
Carte au sol du 8 avril à 12Z
agrandir.jpeg, 161 KB
Carte au sol du 9 avril à 12Z
agrandir.jpeg, 157 KB
Carte au sol du 10 avril à 12Z
agrandir.jpeg, 156 KB
Evolution des précipitations pour certaines stations du Plateau
entre le 10 avril à 11h00 locale et le lundi 10 avril à 23h00
locale.
agrandir.jpg, 156 KB
Seite 3 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006
18.04.2006htt
p
://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite
_
meteo/inondation
_
des
_
9
_
10.html

2.2.2 Cumuls de précipitations calculés à partir des images radar
Les deux cartes ci-dessous sont issues des images radar et représentent les cumuls de précipitations en 24
heures. Pour des raisons techniques, les cumuls indiqués sur ces cartes pourraient différer légèrement des valeurs
mesurées aux stations ANETS. En l'occurrence, ces valeurs sont difficilement comparables puisqu'elles ne
couvrent pas une période identique. L'intérêt de ces images réside surtout dans la visualisation spatiale des
précipitations les plus intenses.
Remarque : dans la région des Franches-Montagnes ainsi qu'en Ajoie, les précipitations sont sous-évaluées en
raison d'un cône d'ombre de l'image radar de La Dôle.
2.3 évolution des températures et limite des chutes de neige
2.3.1 Radiosondages des 9 et 10 avril
Relevés des stations ANETZ pour la même p
é
agrandir.jpg, 281 KB
Cumuls du dimanche 9 avril 06
agrandir.jpeg, 355 KB
Cumuls du lundi 10 avril 06
agrandir.jpeg, 349 KB
Seite 4 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006
18.04.2006htt
p
://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite
_
meteo/inondation
_
des
_
9
_
10.html

Les radiosondages de Payerne indiquent l'évolution des températures (courbe de droite) et du point de rosée
(courbe de gauche) avec l'altitude. Plus les deux courbes sont éloignées l'une de l'autre, plus l'air est sec;
lorsqu'elles sont presque superposées, l'air est saturé et des précipitations se produisent.
La courbe blanche correspond au radiosondage du matin à 00h00, la courbe rouge à celui de midi, et la courbe
bleu à celui de minuit. Quelles constatations peuvent-elles être tirées de ces sondages ?
2.3.2 Evolution des températures
D'une
manière générale, on constate que les températures furent en baisse très progressive, et ce d'une manière
constante sur le nord du Plateau (Fahy, Payerne, Zurich), mais avec tout d'abord un redoux assez marqué durant
Radiosondages du 9 avril 06
agrandir.jpeg, 244 KB
Radiosondages du 10 avril 06
agrandir.jpeg, 245 KB
Radiosondages du 9 avril :
le sondage de 00h00 (en blanc) montre un encore air non saturé, instable et relativement sec dans les basse
couches. Un vent de sud-ouest supérieur à 25 kt (environ 50 km/h) souffle au-dessus de 1300 m environ. Ce
radiosondage correspond aux averses préfrontales de la nuit de samedi à dimanche dans de l'air encore
plutôt doux.
La courbe rouge (le 9 à midi) montre un refroidissement et une humidification très nette des basses couches
de l'atmosphère en dessous de 4000 m environ liés à la présence du front. A ce stade, les précipitations
n'ont plus une allure d'averses mais sont relativement continues; la limite des chutes de neige se situe vers
1300 m. On notera une diminution de la force du vent au-dessous de 2000 m environ.
La courbe bleue (le 9 à minuit) illustre de façon éclatante un phénomène appelé isothermie. Lorsque les
précipitations passent de l'état solide (neige) à l'état liquide (pluie), elle soustraient de l'énergie sous forme
de chaleur à l'atmosphère environnante, laquelle se refroidit d'autant. Ce faisant, la limite du 0 degré
s'abaisse et l'altitude à laquelle se produit le changement de phase responsable de ce transfère de chaleur
s'abaisse également. La courbe des températures adopte ainsi un profil suivant peu ou prou la limite du 0
degré (ligne blanche oblique) à partir de l'altitude initiale de la limite des chutes de neige (voir radiosondage
de midi en rouge); ce phénomène est susceptible de porter la neige jusqu'en plaine; il nécessite d'une part
d'intenses précipitations, mais également des vents faibles pour éviter que la masse d'air ainsi refroidie soit
remplacée par de l'air plus chaud. Ces deux conditions étaient réunies dans la nuit du 9 au 10 avril. A minuit
toutefois, les précipitations tombaient encore sous forme de pluie à Payerne.
Radiosondages du 10 avril :
la courbe blanche correspond à celle de 00h00 et nous n'y reviendrons pas.
la courbe rouge (midi) montre une atmosphère pratiquement inchangée au-dessus de 4000 m environ. En
revanche, un net refroidissement s'est produit dans les basses couches et la limite des chutes de neige est
maintenant vers 700 m. Les vents de basse altitude sont encore faibles.
la courbe bleu (minuit) montre un refroidissement radical de toute la colonne d'air, de 1000 à 7000 m
d'altitude. Ce radiosondage est typique d'une traîne post-frontale active et progressivement plus instable. On
notera l'orientation désormais nord-est du vent, et sa reprise à basse altitude sous forme de bise.
Seite 5 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006
18.04.2006htt
p
://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite
_
meteo/inondation
_
des
_
9
_
10.html
 6
6
 7
7
1
/
7
100%