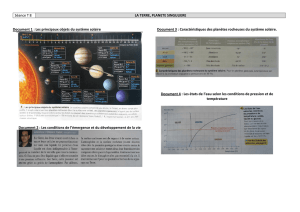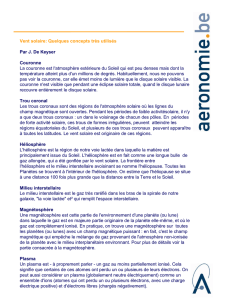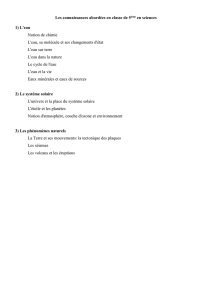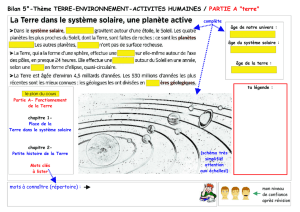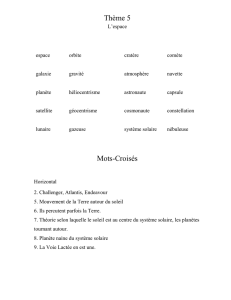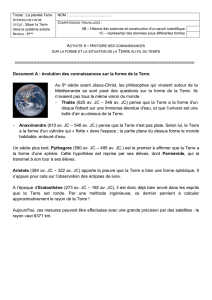Téléchargement - Destination Orbite

1

2
ULYSSES
A la Découverte du Soleil

3
SOMMAIRE
La présentation de la mission ............................................................................................................................ 4
Les découvertes d’Ulysses .................................................................................................................................. 7
La fiche technique .............................................................................................................................................. 9
L’instrumentation ................................................................................................................................................ 10
La carte d’identité du Soleil ............................................................................................................................. 12
La coupe du Soleil ............................................................................................................................................. 13
Les sources ........................................................................................................................................................... 15

4
LA PRESENTATION DE LA MISSION
es premières ébauches d’une mission conjointe Europe/Etats-Unis pour l’étude des pôles du
Soleil commencent dès 1974. Trois ans plus tard, la mission OOE (Out Of Ecliptic) est
approuvée par l’agence spatiale européenne et la Nasa qui livreront chacune une sonde. En
1979, année où les travaux débutent, la mission est rebaptisée ISPM (International Solar Polar
Mission) avec comme date butoir un lancement en février 1983. Les restrictions budgétaires dont
est victime la Nasa conduisent l’agence spatiale américaine à annuler sa sonde. Seule reste en
liste l’européenne, baptisée Ulysses, un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Son
lancement par la navette spatiale américaine est programmé pour mai 1986. Quitter le plan de
l’écliptique demande une énergie colossale. Pour l’y aider, Ulysses sera équipée d’un étage
cryogénique Centaur spécialement adapté pour la soute de la navette.
En décembre 1983, les essais sont terminés sur Ulysses qui est alors entreposée dans un bâtiment en
attendant d’être transférée deux ans plus tard au Kennedy Space Center pour son lancement.
Alors que les choses commencent à s’accélérer pour la sonde, la navette Challenger, celle-là
même qui était désignée pour transporter Ulysses 4 mois plus tard, explose en vol le 28 janvier 1986.
Les vols sont suspendus pendant un peu plus de deux ans et Ulysses est rapatriée au centre
européen de la recherche spatiale à Noordwijk, aux Pays-Bas. En même temps, il faut revoir le
plan de vol de la sonde en raison de l’abandon de l’étage Centaur jugé trop dangereux pour
voler dans la navette. En remplacement, la Nasa lui préfère le moteur à poudre IUS (Inertial Upper
Stage) à deux étages surmontés d’un moteur PAM-D également à poudre.
En janvier 1989, Ulysses subit une
seconde série de tests de
certification pour le vol et est
envoyée à Cap Canaveral en mai
1990. Après bien des péripéties, la
navette Discovery s’élance de son
pas de tir le 06 octobre 1990. Six
heures plus tard, les astronautes
largue la sonde.
Pour quitter le plan de l’écliptique,
la sonde a besoin de beaucoup
d’énergie. Quatre heures après
son largage, les moteurs de l’étage
IUS et le PAM-D s’allumeront
successivement pour imprimer à la
sonde une vitesse de 55 500 km/h
pour rejoindre Jupiter, le seul astre
proche de la Terre capable de
modifier la trajectoire d’un engin
de façon considérable. Le 08 février 1992, la planète géante incurve la trajectoire de la sonde et
l’expédie sur une orbite qui lui permettra de survoler les pôles du Soleil.
Du 26 juin 1994 au 05 novembre 1994, Ulysses survole le pôle Sud de notre étoile et révèle que le
vent solaire y est deux fois plus rapide qu'à l'équateur. La sonde découvre également que la
quantité de rayons cosmiques s’est moins importante que ce que les scientifiques n'avaient
imaginé. De plus, on découvre que le pole Sud magnétique ne peut être localisé de façon précise
en raison du champ magnétique radial qui est uniforme et turbulent. Lorsque la sonde a survolé le
pole Nord entre les 19 juin 1995 et 29 septembre 1995, les résultats sont analogues que ceux
L
La sonde Ulysses avant son largage de la soute de la
navette Discovery. Photo Nasa.

5
obtenus un an plus tôt. Le 26 février 1998, Ulysses a bouclé sa première orbite.
L’orbite accomplie ne signifiait pas la fin de la
mission. Les scientifiques ont décidé de
poursuivre la recherche. Le 17 avril 1998
débutait la seconde orbite, suivie le 30 juin 2004
par une troisième. En février 2003, le système
principal de transmission de données est tombé
en panne, suivi 5 ans plus tard par le
secondaire. La puissance électrique de la sonde est passée de 285 Watts en début de mission à
195 Watts. La sonde ayant atteint tous ses objectifs, l’Esa et la Nasa ont décidé de mettre fin à la
mission le 01 juillet 2008 après avoir passé 17 ans et 8 mois dans l’espace.
ETAPES CLES
06/10/1990 : Lancement par la navette Discovery
08/02/1992 : Survol de la planète Jupiter afin de sortir du plan de l’écliptique
20/06/1994 : Début du premier survol du pôle Sud du Soleil (jusqu’au 05/11/1994)
19/06/1995 : Début du premier survol du pôle Nord du Soleil (jusqu’au 29/09/1995)
06/09/2000 : Début du second survol du pôle Sud du Soleil (jusqu’au 16/01/2001)
31/08/2001 : Début du second survol du pôle Nord du Soleil (jusqu’au 10/12/2001)
17/11/2006 : Début du troisième survol du pôle Sud du Soleil (jusqu’au 03/04/2007)
30/11/2007 : Début du troisième survol du pôle Nord du Soleil (jusqu’au 15/03/2008)
01/07/2008 : Fin officielle de la mission Ulysses
DICO
Plan de l’écliptique : disque invisible sur lequel
tournent toutes les planètes du système solaire
avec en son centre, le Soleil.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%