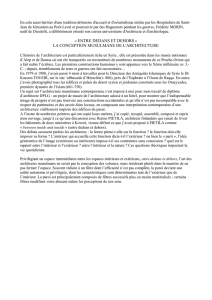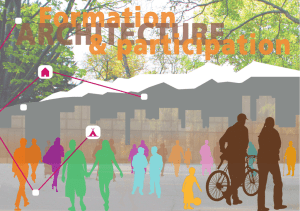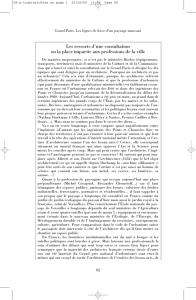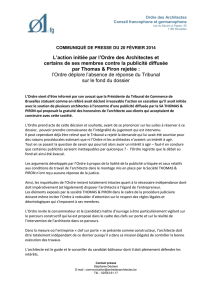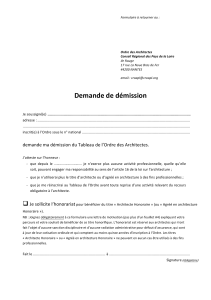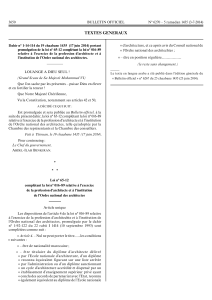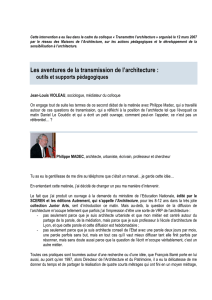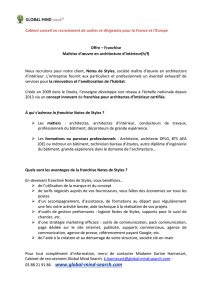Architecture globalisée - Monsieur Mouch

Architecture globalisée
Vers une altermondialisation
monsieur mouch
OTO édition n’est ni un label, ni une maison d’édition,
Juste un nom, en espérant trouver, un jour, un véritable éditeur.
Texte de recherche du DEA PAPT, de l’IEP de Bordeaux, sept.2004.
http://monsieurmouch.free.fr &[email protected]

1
Sommaire
Introduction.
I. L’architecte dans l’histoire
Un outil mondialiste.
-Le symbole des grands empires.
-Ailleurs.
-La renaissance européenne.
-Le XIXème siècle, la révolution industrielle.
-Exportation des modèles.
-Après les styles, le mouvement moderne.
-Mégapoles, la course aux skylines.
-Les post-modernismes.
II. Des architectes altermondialistes ?
Les références contemporaines, les contre-modèles.
-La production des architectes contemporains.
-Cartographie de l’exportation des Starchitectes.
-Les différents modèles de l’occident.
-Les contre-modèles existent-ils ?
-Les courants émergeants.
-La formation des étudiants.
III. Vers une altermondialisation de l’architecture
La production anonyme, l’architecture sans architecte.
-Anthropologie de l’espace.
-Un modèle occidental universel.
-La ville informelle, les exclus spatiaux.
-Villes musées.
-Penser global, agir local.
-L’Etat dans tout ça.
-La France pour exemple.
Conclusion.
Bibliographie.

2
Introduction
Depuis quelques années, on entend les producteurs français de tomates râler contre la tomate
marocaine, qui se plaint de la tomate chinoise. On entend les Fabulous Troubadors rire de la Star
Acedemy, qui adore Britney Spears. On entend le pêcheur de sardinesde Marseille qui se plaint des gros
chalutiers, qui se livrent une guerre navale à la concurrence des prix. On entend les paysans sans terre
d’Amérique du Sud protester contre les grands propriétaires terriens, les médecins qui crient la maladie
de l’Afrique, les écologistes qui s’alarment de l’état de la planète, ou encore quelques femmes et
hommes politiques qui refusent le système capitaliste mondial actuel et se posent en militants
altermondialistes. La mondialisation capitaliste est remise en cause par certains, dans tous les corps de
métier, dans chaque domaine de l’activité humaine, qui revendiquent l’élaboration d’un autre monde
avec un système plus juste, plus égalitaire.
«Le triomphe planétaire du capitalisme, bien plus affirmé aujourd’hui qu’il ne l’était au début
de ce siècle (le XXème), est en train de générer diverses manifestations d’un syndrome
idéologique pathologique face auquel tout intellectuel qui a un minimum de conscience
civique n’a d’autre choix que d’opposer la plus ferme résistance ».1
Les seuls que l’on n’entende pas sur le champ de « l’altermondialisation », ce sont les architectes.
L’architecte ne proteste pas, ne manifeste pas, il fait. Il se pose des problèmes d’architecture, et les
questions de mondialisation et d’altermondialisation lui sont quasiment étrangères. Il est alors légitime de
se demander ce qu’elles signifient pour lui, et quel peut-être son rôle pour elles.
Il va s’agir ici de poser la définition de ces réflexions dans le champ de l’architecture, ainsi que dans le
domaine de l’urbanisme, qui lui est intimement lié. Il faut tout d’abord, se rappeler la position de
l’architecte face au pouvoir, son rôle historique dans les sociétés, dans leur organisation, leurs rites. Ce
retour sur l’histoire permet de saisir comment y est lié l’histoire de l’architecture, et comment
l’architecture contemporaine est le reflet du monde contemporain globalisé.
Si dans la mondialisation, l’architecte est mondialiste, il va falloir alors identifier ce que pourrait signifier
son altermondialisation, identifier les différents modes culturels qu’il est capable de véhiculer s’il ne le fait
pas que pour le modèle occidental capitaliste, identifier les contre-modèles et les courants émergeants
de l’architecture contemporaine.
Et puis, il reste tout un pan de l’architecture, sûrement la plus grande partie de la construction mondiale,
qui se passe des architectes. Cette architecture est l’architecture dont ne parle pas l’histoire du monde,
elle a toujours été culturellement identifiable dans les mondes qui l’ont élaborée. Elle est aujourd’hui le
produit direct de la mondialisation, et reflète la position mondialiste, d’une part sur les questions de
conservation d’un patrimoine, et d’autre part sur l’humanité et ses iniquités sociales, comme le révèle la
condition de l’habitat mondial. Ces questions ont déjà leurs débats, et l’émergence du concept de
développement durable peut éclairer l’architecture,et la construction en général,sur sa relation au
monde. On verra ensuite la part des Etats dans ces volontés de régulation de l’action du secteur
économique privé, et pour finir, l’exemple le plus proche, puisqu’il va s’agir de la France, de son cadre
légal pour l’architecture, et de ses capacités de contrôle.
Cette définition de l’altermondialisation en architecture commence évidemment par une définition de
ce qu’est tout d’abord, la mondialisation, et de la place de l’architecte pour elle.
1STEVENS, Bernard, dans : COLLECTIF. Sld : BERQUE, Augustin. NYS, Philippe. « Logique du lieu
et œuvre humaine ». Ed Ousia, 1997. p.10.

3
I. L’architecte dans l’histoire
Un outil mondialiste

4
Entendons nous bien sur les mots. Mondialisation, le mot claque dans toutes les bouches comme celui
d’un monstre dévastateur, comme la cause des malheurs du monde. Avant de le juger, il faut essayer de
comprendre qui il est, comment il est arrivé là, et par qui. J’ouvre le petit Robert à la page 1660 et je lis…
Mondialisation (n.f. 1953)
« Le fait de devenir mondial, de se répandre dans le monde entier. Phénomène d’ouverture
des économies nationales sur un marché mondial, lié aux progrès des communications et
des transports, à la libéralisation des échanges, entraînant une interdépendance croissante
des pays ».
Cette ouverture des économies nationales entraînerait une interdépendance des « pays », certes, mais
où sont les nations, les Etats ? Ne serait-ce pas plutôt l’économie mondiale qui s’émancipe simplement
des Etats, qui s’en libère ? Si la mondialisation est un phénomène, elle a une raison, des initiateurs, elle
résulte d’une action, d’une volonté, sûrement du mondialisme…
Mondialisme (n.m. 1950)
« Universalisme visant à constituer l’unité politique de la communauté humaine. Perspective
mondiale en politique ».
Il s’agit donc d’une perspective mondiale, basée sur l’ouverture des économies nationales, pour créer
un universalisme marchand, supranational et global, qui serait la base politique, les fondements de
l’organisation humaine.Ce sont les entreprises multinationales et les grands groupes privés qui dominent
la planète. Sur les cent premières multinationales,en terme de capital, il y en a 54 étasuniennes, 27
européennes, 5 japonaises et 5 suisses. 1Cette suprématie économique de l’occident concerne tous les
domaines d’activité, de production, dans une perspective universaliste, qui tend donc à établir une
culture mondiale. L’industrie, l’agriculture, la culture, subissent la mondialisation. L’architecture
n’échappe pas à ce processus transformateur, avec une position particulière, qui correspond au rôle de
celle-ci dans l’organisation humaine. L’architecture est le premier outil humain, le premier instrument qui
permet à l’Homme de se détacher de la nature, de s’en protéger. Elle est porteuse d’utilité, de fonction,
mais aussi de sens, d’une valeur symbolique, représentative de ce qui constitue la culture humaine qui
l’a mise en place, des coutumes, des rites. Dans sa dimension universaliste, la mondialisation
occidentale, puisqu’on parle de celle-là, ne tient pas compte des différentes cultures qui composent le
monde, voire cherche à les anéantir comme le souligne Jean Baudrillard :
« Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que l’orthodoxie religieuse, toutes les
formes différentes et singulières sont des hérésies. A ce titre, elles sont vouées soit à rentrer de
force dans l’ordre mondial, soit à disparaître. La mission de l’occident est de soumettre par
tous les moyens les multiples cultures à la loi féroce de l’équivalence. Une culture qui a perdu
ses valeurs ne peut que se venger sur celle des autres ».2
C’est par la gestion de la distribution mondiale du travail et de la production que la « puissance
mondiale » s’affirme en maîtresse. Le système est géré depuis les nœuds du réseau mondial, depuis les
villes mondiales
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%