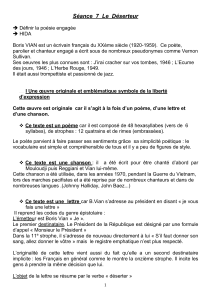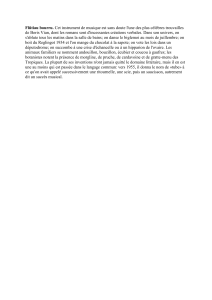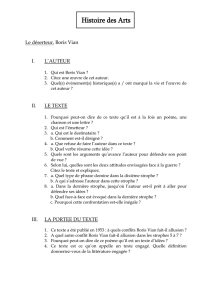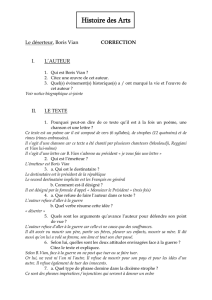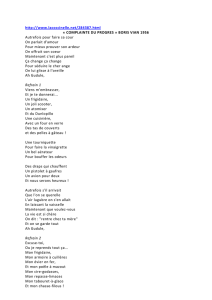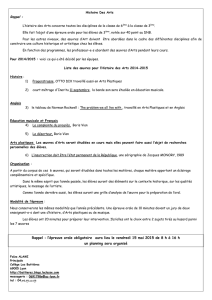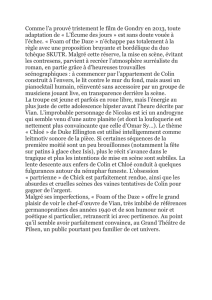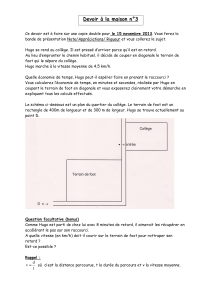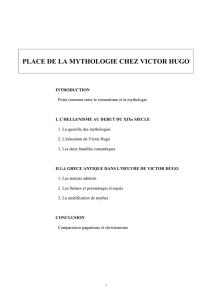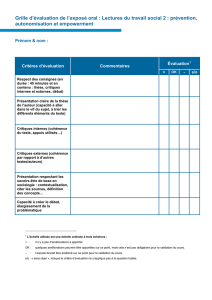les dramaturges et leurs critiques. Poétiques paratextuelles de la

Les dramaturges et leurs critiques.
Poétiques paratextuelles de la riposte
chez Victor Hugo et Boris Vian
BENOÎT BARUT
Historiquement et essentiellement, le théâtre est un genre agonistique, pour ne
pas dire polémique. D’après le mythe, le théâtre se dissocie de la déclamation
dithyrambique grâce à espis, qui place auprès du chœur un « répondant ».
Avec l’apparition de cette figure adverse naît l’agon. Le conflit engendre le
théâtre et, en retour, le théâtre provoque le conflit. Les nombreuses querelles
et batailles qui jalonnent l’histoire du théâtre – Le Cid et Hernani, pour ne
citer que les plus connues sinon les plus violentes – prouvent que le combat
est infectieux et qu’il ne reste pas enclos dans le seul espace scénique. Parmi
les confrontations que le théâtre appelle, qu’il nourrit et dont il profite, celle
qui l’oppose à la critique que l’on appellera, faute de mieux, journalistique
est haute en couleurs et en enseignements. Naguère, en effet, le théâtre vivait
et mourait par la critique que dispensaient les journaux et leurs censeurs
redoutés. Puisqu’il est un art de société¹, le théâtre s’expose plus qu’aucun
autre genre littéraire et les dramaturges sont davantage aux prises avec les
critiques que leurs (con)frères romanciers ou poètes. Plus attaqués que les
autres, ils ont dû développer davantage leurs systèmes de défense et apprendre
à répondre.
Alors que la lecture de romans ou de poèmes est, le plus souvent, individuelle et intime, le
théâtre présuppose une performance scénique, laquelle a nécessairement lieu dans un espace
public, devant une assemblée. Le théâtre est potentiellement une tribune : la forme spectaculaire
et la réception collective rendent le genre dramatique suspect car il a le pouvoir de remuer les
foules. C’est en tout cas ce que redoutent les censeurs. Cela explique la lutte que les pouvoirs
publics ont menée contre Le Mariage de Figaro. Dans ses propos, cette pièce est en effet beau-
coup moins subversive que nombre de textes (romans, pamphlets, épigrammes, etc.) de la
même époque et qui n’ont pas déclenché autant de foudres ; mais, en tant que pièce de théâtre,
la critique sociale apparaît mise en acte. Plus visibles, plus palpables, en un mot, plus vivantes,
les revendications ont davantage de poids, au grand dam des censeurs. Cet effet-tribune émeut
également les critiques et les pousse, dans leurs chroniques, à donner plus souvent dans le billet
d’humeur que dans l’analyse consciencieuse. Voir à ce sujet Ferenczi ().
TRACÉS 13 2007/2 PAGES 115-142

BENOÎT BARUT
116
La posture scientifique sinon juridique de Corneille dans ses « Examens »
et l’attitude ludique de Molière dans ses pièces-réponses (impromptus et
pièces critiques) constituent, du point de vue de la tonalité, les deux pôles
d’une vaste gamme de ripostes possibles. Mais le choix des zones pour
riposter est assez restreint. En schématisant au maximum, l’auteur n’a qu’une
alternative : soit il propose une riposte véritablement dramatique et l’inscrit
ludiquement dans le cadre même de l’œuvre (La Critique de l’École des femmes
en est l’exemple canonique) ; soit il décide de travailler le méta-texte proche
(paratexte) ou plus lointain (péritexte). La riposte se détache alors peu ou
prou de l’œuvre elle-même et devient généralement moins ludique et plus
polémique, moins littéraire et plus argumentative. La distinction entre texte
et hors-texte, entre répartie ludique et riposte sérieuse n’est bien sûr pas aussi
définitive – que l’on pense aux préfaces du Barbier de Séville et du Mariage
de Figaro où Beaumarchais se révèle tout à la fois histrion et polémiste. Il
reste que la riposte para/péritextuelle mise généralement davantage sur la
respectabilité intellectuelle et culturelle, sur l’argumentation esthétique que
ne le fait la pièce-réponse.
En dépit de leur parenté, péritexte et paratexte diffèrent profondément.
Étant accolé à la pièce, le paratexte développe davantage le syndrome de
la marge : ni central, ni extérieur, il bénéficie des avantages de cette situa-
tion intermédiaire et de la plasticité qui en découle. De fait, nous nous
proposons d’étudier deux auteurs (Hugo et Vian) venus au théâtre après
avoir été poètes puis romanciers, deux auteurs qui n’ont presque jamais
rencontré le succès dramatique qu’ils méritaient et qui se servent tous les
deux du paratexte – et avec une faconde que l’on trouve rarement parmi les
dramaturges – pour prendre leur revanche sur les critiques responsables, pour
une part, de cet échec. La question qu’ils se posent n’est pas de savoir si l’on
peut être critique de la critique – défendre ses ouvrages est, pour nos deux
auteurs, une prérogative du dramaturge – mais bien comment mettre à profit
le paratexte pour développer une méta-critique. Hugo et Vian se servent du
même outil mais chacun le façonne à sa main. Les pratiques paratextuelles
de ces deux dramaturges sont en effet si diamétralement opposées qu’elles
forment quasiment un diptyque exemplaire et s’éclairent mutuellement.
() La tactique employée par Hugo est celle du monologue. L’homme-océan
va jouer sur l’étendue, sur une parole qui coule hors de toute mesure et
emporte avec elle les fétus critiques. Il parle seul et longtemps : il étouffe et
écrase ses détracteurs en faisant varier sa voix, en prouvant qu’il est un titan
de l’écrit, un géant du livre capable d’ériger son paratexte en mur cyclopéen
infranchissable mais non immobile. () Vian, à l’inverse, invite les critiques à

LES DRAMATURGES ET LEURS CRITIQUES
117
l’intérieur du paratexte en présentant un dossier de presse. Il entend engager
un dialogue qui aura toutes les apparences d’une lutte loyale. Mais, en sous-
main, il sape l’équité du combat, truque la partie de bout en bout pour en
sortir vainqueur. La dichotomie jeu/combat que nous avons relevée resurgit
donc : Hugo et Vian se lancent à l’assaut de la critique et aspirent au combat ;
mais tandis que l’un se fait burgrave, l’autre se fait boxeur. Dans les deux cas,
la lutte est véritable ; seule la dose de ludisme varie.
Paratexte et monologue : le rempart hugolien
En tant que dramaturge², Hugo a rarement trouvé grâce aux yeux de la
critique. Contre ce théâtre trop poétique, trop épique, trop sublime et trop
grotesque – trop hugolien, en somme –, celle-ci fait rage et reproche à l’auteur
tout ce qui fait son génie (Ubersfeld, ). Chacun de ses drames a été l’oc-
casion d’un combat ; la publication en volume lui permet de se justifier et de
riposter en cuirassant ses pièces d’un paratexte abondant, varié et destiné à
anéantir les critiques qui ont été émises et prévenir celles qui viendront. La
dimension agonistique perdure donc, quelle que soit la durée écoulée depuis
le tumulte des représentations.
« Confirmer ou réfuter des critiques, c’est la besogne du temps » (ATP,
Note I, p. ). Le critique est un néfaste dévoreur de temps – homo criticus
edax – car besogner n’est pas œuvrer. Précisions, explications, corrections sont
à mettre dans le même sac : mieux vaut produire du neuf que repolir le déjà
fait³. Mais ne pas corriger ne signifie pas ne pas défendre. Fin stratège, voire
Vauban littéraire, Hugo sait en effet qu’un édifice, fût-il littéraire, n’est rien
sans remparts. Le paratexte en fera office : de nombreux avant et après-textes
lestent les éditions de ses pièces et sont autant de murs hérissés de tessons
propres à égratigner les critiques et leurs prétentions destructrices. L’un des
moyens les plus efficaces est encore de les réduire au silence, de les laisser dans
Notre corpus recouvre les drames romantiques de Hugo publiés de son vivant et donc pourvus
d’un paratexte : Cromwell (ci-après CR), Hernani (HE), Marion de Lorme (ML), Le Roi s’amuse
(RSA), Lucrèce Borgia (LB), Marie Tudor (MT ), Angelo, tyran de Padoue (ATP), Ruy Blas (RB),
Les Burgraves (BU). Les références à ces drames renvoient à Hugo (a), à l’exception de
Cromwell (Hugo, ).
« L’auteur de ce livre connaît autant que personne les nombreux et grossiers défauts de ses
ouvrages. S’il lui arrive trop rarement de les corriger, c’est qu’il répugne à revenir après coup
sur une chose faite. Il ignore cet art de souder une beauté à la place d’une tache. […] Le travail
qu’il perdrait à effacer les imperfections de ses livres, il aime mieux l’employer à dépouiller son
esprit de ses défauts. C’est sa méthode de ne corriger un ouvrage que dans un autre ouvrage »
(CR, Préface, p. ).

BENOÎT BARUT
118
l’enfer de l’anonymat. Hugo ne cite jamais les noms de ses détracteurs et ne
relaie presque jamais les propos déplaisants qu’il a dû essuyer lors de la créa-
tion des pièces : inutile d’élever la querelle en débat. Mais se taire ne suffit
pas si l’on ne précise pas que l’on va se taire, même si ce silence proclamé
est fréquemment de l’ordre de la prétérition⁴. Hugo, en effet, ne s’abstient
pas tout à fait de répondre, mais c’est souvent sous la forme du confer et de
l’argument d’autorité⁵. Il donne littéralement son congé à la critique : « Il
pourrait […] examiner une à une avec la critique toutes les pièces de la char-
pente de son ouvrage ; mais, il a plus de plaisir à remercier la critique qu’à la
contredire » (LB, Préface, p. ). Grâce à la syllepse sur « remercier », Hugo
témoigne sa gratitude à ceux qui le soutiennent et, dans le même temps,
renvoie comme des domestiques ceux qui lui cherchent chicane. De fait, les
piètres jugements de piètres jugeurs ne concernent pas le poète et argumenter
avec les tenants de « Notre Dame la Critique » (Hugo, c, p. ) est
parfaitement inutile puisque, comme Eschyle, Hugo « consacre [ses] œuvres
au temps » (BU, Préface, p. ). Le vrai jugement est celui de la postérité.
« Si son drame est mauvais, que sert de le soutenir ? S’il est bon, pourquoi
le défendre ? Le temps fera justice du livre, ou la lui rendra. Le succès du
moment n’est que l’affaire du libraire » (CR, Préface, p. ). Ce refus de
défendre Cromwell est assez plaisant, considérant qu’il vient clore soixante
pages de préface qui, même si elles parlent assez peu du drame lui-même,
ont tout de même valeur de manifeste. Quoiqu’en dise Hugo, il défend ses
pièces, en particulier grâce au paratexte. Afin de ne pas être pris en flagrant
délit de contradiction, il prend soin néanmoins de ne pas se placer dans une
position de réponse. Hugo est fréquemment accusé de produire sur la scène
des pièces immorales. Dans la préface de Lucrèce Borgia, il réplique. Mais, à
la place d’une plaidoirie où, par la force des choses, il se trouverait dans une
position inconfortable de défense, il propose ici une véritable profession de
foi esthétique d’un ministre du sacerdoce littéraire⁶. La critique est évincée
« Il ne veut pas cependant qu’on suppose que, s’il se tait, c’est qu’il n’a rien à dire ; et, pour
prouver, une fois pour toutes, que ce ne sont pas les raisons qui lui manqueraient dans une
polémique à laquelle sa dignité se refuse, il répondra ici, par exception et seulement pour donner
un exemple » (ATP, Note I, p. ).
Voir par exemple, dans Lucrèce Borgia (Préface, p. ), les renvois hautains à des ouvrages
réputés.
Voici un court extrait de ce discours qui ne se donne pas comme une réponse : « Il sait que le
drame, sans sortir des limites impartiales de l’art, a une mission nationale, une mission sociale,
une mission humaine. […] Le poète aussi a charge d’ames [sic]. Il ne faut pas que la multitude
sorte du théâtre sans emporter avec elle quelque moralité austère et profonde. Aussi espère-t-il
bien, Dieu aidant, ne développer jamais sur la scène […] que des choses pleines de leçons et
de conseils » (LB, Préface, p. ).

LES DRAMATURGES ET LEURS CRITIQUES
119
du schéma de discussion : aucun élément textuel ne vient rappeler le conten-
tieux esthétique soulevé par la pièce. Tout se passe comme si Hugo n’avait
jamais été taxé d’immoralité. L’auteur n’apparaît donc pas acculé, obligé de
se justifier. Le discours apologétique n’est pas contraint par les circonstances
mais semble au contraire volontaire, spontané, non provoqué. Ce qui est par
nature une réplique dans un dialogue tendu entre créateur et censeur devient
donc tirade, mieux : monologue. Il ne reste rien de l’accusation initiale : la
critique est dissimulée, littéralement annihilée.
Mais, même si Hugo s’arrange souvent pour ne pas apparaître en position
de combat, il doit néanmoins suggérer que la lutte est réelle et qu’il est au
fait des tactiques guerrières, même les plus hétérodoxes :
Notes et préfaces sont quelquefois un moyen commode d’augmenter le poids
d’un livre et d’accroître, en apparence du moins, l’importance d’un travail ; c’est
une tactique semblable à celle de ces généraux d’armée, qui, pour rendre plus
imposant leur front de bataille, mettent en ligne jusqu’à leurs bagages. (CR,
Préface, p. )
Fidèle à cette stratégie, Hugo aligne un paratexte dont le volume est le
premier atout. Si les dimensions du paratexte restent mesurées dans Marion
de Lorme, Marie Tudor et Hernani, presque un cinquième du total du texte
imprimé de Lucrèce Borgia et du Roi s’amuse et plus d’un quart d’Angelo
sont mobilisés pour faire face à la critique. Mais c’est surtout le bagage
culturel étayant le paratexte qui fait impression. Les cinquante-deux notes
de Cromwell, par exemple, touchent à tous les sujets et l’auteur prend encore
soin de prévenir qu’il ne s’agit que d’un condensé⁷. À l’avant et à l’arrière, les
bataillons paratextuels du général romantique, par leur richesse quantitative
et qualitative, étouffent toute critique dans l’œuf : chaque pièce est solide-
ment caparaçonnée, tel un cheval de bataille. Tandis que la fin de la préface
de Cromwell évoque la cuirasse, le début file la métaphore du bouclier. Mais
c’est un refus de la cuirasse – « l’auteur de ce drame aurait pu comme un autre
se cuirasser de noms propres » (p. ) – et le bouclier est traître :
L’auteur ne sait comment cela se fait, ses préfaces, franches et naïves, ont toujours
servi près des critiques plutôt à le compromettre qu’à le protéger. Loin de lui être
de bons et fidèles boucliers, elles lui ont joué le mauvais tour de ces costumes
étranges qui, signalant dans la bataille le soldat qui les porte, lui attirent tous les
coups et ne sont à l’épreuve d’aucun. (p. )
« Il est peu de vers de cette pièce qui ne puissent donner lieu à des extraits d’histoire, à des
étalages de science locale, quelquefois à des rectifications. Avec quelque bonne volonté, l’auteur
eût pu facilement élargir et dilater cet ouvrage jusqu’à trois tomes in-°. Mais à quoi bon faire
des quatre-vingts ou cent volumes qu’il a dû lire et pressurer dans celui-ci les caudataires de ce
livre ? » (CR, « Note sur ces notes », p. ).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%