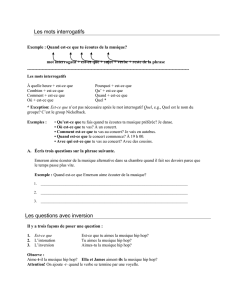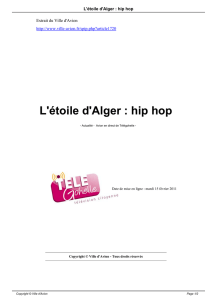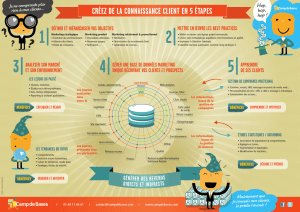Art, art populaire, cultures urbaines

Le hip hop a fleuri sur des pratiques popu-
laires existantes; il s’inscrit dans une
histoire des musiques, des danses et des
technologies, à savoir: racines africaines,
américaines, jamaïcaines et fêtes urbaines.
Pourtant, il est quasiment unanimement
confiné dans une définition «banlieue» et ses
créateurs eux-mêmes méconnaissent parfois
les formes artistiques du passé. L’intérêt
complémentaire pour le mouvement hip hop et
ses manifestations artistiques réside dans la
revendication de la rue. Cependant, le terme
«cultures urbaines » qui leur est attribué, s’il
offre l’avantage d’être commode, est peu satis-
faisant.
En effet, s’il paraît relativement simple de ratta-
cher les cultures urbaines à un ensemble de
modes de vie produits en milieu urbain et de
considérer la culture au sens de rapports
sociaux producteurs de systèmes collectifs d’in-
terprétation, l’utilisation qu’en a fait la poli-
tique de la ville depuis les années 1990 contri-
bue à la diffusion d’une ambiguïté de sens en
associant leur contenu aux «jeunesses des
banlieues» et à la résolution de «leurs problè-
mes».
Les points de vue sur lesquels je m’appuierai dans cet arti-
cle permettent (re)considérer autant la définition de l’art
que celle des cultures populaires, toutes deux inséparables
de la question des origines sociales et de l’appartenance de
classe. Je tenterai d’explorer quelques aspects de ces ques-
tions au travers d’enquêtes menées depuis plusieurs années
sur ce domaine et, plus largement, sur les danses, les
musiques et les inscriptions murales dans la ville.
ART ET VIE QUOTIDIENNE
Le philosophe américain Richard Shusterman porte un inté-
rêt particulier à la conception de la compréhension esthé-
tique de son aîné, John Dewey1. Pour l’un comme pour l’au-
tre, l’art n’est pas une expérience éthérée mais répond à
une dimension corporelle et intellectuelle «que nous avons
le malheur et le tort de trop séparer […]. Les racines de l’art
et de la beauté plongent dans les fonctions vitales élémen-
taires, dans le caractère biologique de l’homme». En ce sens,
l’art est «toujours le produit d’une interaction entre l’orga-
nisme vivant et son environnement, énergies […]. Le substrat
organique […] est la source féconde où puisent les énergies
émotionnelles de l’art2». Richard Shusterman conclut en
opposant sa conception analytique à la philo-
sophie kantienne du désintéressement de
l’art, de sa gratuité, de son autonomie, de sa
valeur intrinsèque.
❚1Paul Dewey, philosophe américain (1859-1952). Dernière traduction fran-
çaise : L’Art comme expérience, université de Pau, 2005.
❚2Richard Shusterman, L’Art à l’état vif. La pensée pragmatique et l’esthétique
populaire, Paris, Minuit, 1992, p. 23.
S’interroger sur le terme de culture pour des arts
ignorés ou pris en compte depuis peu par le répertoire
artistique conduit à s’intéresser au pouvoir légitimant
de l’institution. Ce qui induit conjointement à inter-
roger les définitions de l’acte de création et le statut de
l’artiste.
Mais il s’agit ici, plus modestement, d’explorer un cer-
tain nombre de points de vue, avec pour principal sup-
port de la réflexion le mouvement hip hop.
Art, art populaire,
cultures urbaines
❚Claire CALOGIROU
❙148-MARS 2007 diversité ville école intégration ❘43
Diversite_148_BAT 20/03/07 15:20 Page 43

Quoi de plus directement compréhensible, dans cette
conception de l’art, que l’indissociabilité de la musique et
de la danse?
Éliane Seguin décrit ce rapport intime de l’art avec la
dimension corporelle dans les cultures noires: «L’une des
composantes caractéristiques de la musique danse appe-
lée swing est d’être construite sur une pulsation de base,
le beat, régulièrement accentuée, comme une métaphore
du cœur qui bat. D’un coup, le temps musical rejoint le
temps vécu. Le temps devient sensible au corps et se traduit
par la pulsation corporelle4.»
Les critiques de Dewey sur lesquelles insiste Shusterman
portent sur l’élitisme de la définition de l’art «qui, en l’iso-
lant des autres champs sociaux, décourage beaucoup de
gens de chercher un agrément dans les beaux arts et refuse
toute légitimité artistique aux arts populaires5».
Ces citations mettent en cause une définition univoque
de l’art fondée sur la délimitation d’un cercle privilégié
de professionnels et de connaisseurs dont sont exclus
les non-initiés et les non-«labellisés ». Cet élitisme auquel
se réfèrent les auteurs cités induit simultanément pour
le plus grand nombre l’inaccessibilité des lieux de diffu-
sion de l’art, ce dont mes enquêtes rendent compte.
Jacques Soulilou ne traite pas d’autre
chose dans le catalogue du Musée interna-
tional d’art modeste : «Que le lecteur me
pardonne de lui infliger d’entrée un lieu
commun éculé: l’art, celui dont traite cette
branche de la philosophie qu’on appelle
“l’esthétisme”, est par essence immodeste6.»
Lorsque la Direction des musées de France
organisa en 1990 au musée des Monuments
français une exposition intitulée «Graffiti-art,
artistes français et américains», les commen-
taires furent extrêmes, les réactions idéolo-
giques politiques ou esthétiques virulentes, la
démarche des musées jugée démagogique.
ART POPULAIRE
Shusterman utilise la métaphore de l’art
comme «salon de beauté de notre civilisation7»
pour inciter à sa transformation en donnant
toute sa place à l’art populaire. L’art populaire
donne du plaisir, dit-il, et il ne faut pas avoir
honte de prendre du plaisir. De plus, l’art popu-
laire devrait unir dans un même plaisir esthé-
tique les différentes classes sociales, si ses
critiques cessaient de le juger vulgaire et facile
et si la contrainte de classe n’imposait une
convenance de goûts. Mais, si Shusterman
rejette la condamnation de l’art populaire, il
rejette également sa glorification, se situant
dans une situation médiane d’étude et de
discernement. Nier l’esthétique de l’art popu-
laire, le présenter comme l’envers négatif de
l’art, dénoncer le caractère d’emprunt à l’art
populaire, c’est oublier que l’art puise de tout
temps son inspiration dans la culture populaire.
Le rapport à l’art qu’entretient le peintre Hervé
Di Rosa, l’un des concepteurs du Musée inter-
national d’art modeste, contribue à l’argu-
mentation de Shusterman:
«Dans l’art modeste, il y a l’idée que l’art appar-
tient à tout le monde, qu’il doit concerner tout
le monde […]; une des forces de l’art modeste,
comme il est en marge de tout, des dogmes,
des chapelles, du marché, les gens se sentent
libres de dire: “Ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît
pas!”» ; et Di Rosa poursuit, avec comme un
❚3Les DJ’s, associés aux MC’s, composent le rap.
❚4Éliane Seguin, Histoire de la danse jazz, Paris, Chiron, 2003, p. 123.
❚5Shusterman, op. cit., p. 25.
❚6Jacques Soulilou, «De la modestie», in L’Exposition inaugurale du Musée inter-
national d’art modeste, catalogue, Sète, 2000, p. 24. (NDLR : Le musée se nomme
désormais Musée international des arts modestes.)
❚7Shusterman, op. cit., p. 41 et 121.
44 ❘ville école intégration diversité 148-MARS 2007 ❙
Le mouvement hip hop
Le terme hip hop désigne une « culture mode de vie » qui
englobe la musique des disc-jockey (DJ), sur laquelle s’expri-
ment les maîtres de cérémonie3(MC), la danse de rue, le graff,
un style vestimentaire, un langage de la rue. Le rôle des DJ’s
est essentiel dans la diffusion du mouvement. Ces animateurs
des radios nouvellement « libres » et de discothèques sont en
effet les premiers, à travers de rares émissions diffusant des
musiques noires,à faire entendre du rap. En 1982,une tournée
américaine regroupant graffeurs,danseurs, DJ’s et MC’s, présen-
tée à la radio, bouleverse tous les passionnés de musiques funk
et soul.
En 1984, le mouvement connaît un fulgurant développement
médiatique qui s’achève tout aussi brusquement. Après des
années dans l’ombre, durant lesquelles le hip hop continue à vivre
grâce aux passionnés,le mouvement prend un nouveau départ
en 1989.
Diversite_148_BAT 20/03/07 15:20 Page 44

pied de nez aux «professionnels» de l’art: « Ça
fait deux mille ans que des types avec des gros-
ses têtes se battent comme des chiffonniers
pour savoir ce que c’est que l’art, ce qui en est,
ce qui n’en est pas, et moi, Hervé Di Rosa, le
dernier des vulgaires, j’arrive et je dis: “L’art
c’est ça! Et l’art modeste, c’est ça!”8»
Comment ne pas souligner ce à quoi croit
profondément Di Rosa, à savoir la force de
communication de l’art? Si cette force est
occultée, si les sensations, les émotions sont
reléguées, à quoi servirait-il dès lors de l’expo-
ser? commente-t-il. La question immédiate
étant: avec qui communiquer? un public de
«connaisseurs»? ou celui, large, vaste et diver-
sifié, du plus grand nombre? Affirmant claire-
ment la dimension politique que doit signifier
l’art, Di Rosa ajoute: «Le musée [le Miam] a une
dimension politique parce qu’il parle de la vie
des gens, de leur vie quotidienne, de leurs
comportements, de leurs affects de base […].
Qu’en plus, on parle du peuple; dans populaire,
il y a peuple9.»
L’affirmation de la dimension politique de l’art,
exprimée ou sous-jacente chez les auteurs cités,
renvoie donc à la notion de culture populaire et
redonne sa place à l’art au cœur de la vie quoti-
dienne. Ainsi que le rappelait Paul Bourcier10,
les luttes des pouvoirs politique et religieux en
Europe contre les cultures paysannes ont
instauré la séparation entre formes populaires
et formes savantes en sonnant la disqualifica-
tion de la création et de la participation collec-
tives, de la transmission orale, pour ériger la
scène, le spectacle et la création savante. Même
si, avec l’entrée dans la modernité des années
1920, l’académisme est remis en cause, la
distinction se rejoue systématiquement dans bien des
courants artistiques. Ainsi cet exemple venus du monde
du jazz et de musiciens comme Duke Ellington, Sidney
Bechet ou Dizzie Gillepsie: « Dans la première moitié du
siècle, les musiciens de jazz avaient la danse en eux lors-
qu’ils jouaient, et les danseurs de jazz avaient la musique
en eux, ou alors il n’y avait pas de jazz […]. La musique
jazz a été inventée pour faire danser les gens.Aussi, lorsque
vous jouez du jazz et que le public ne ressent pas l’envie
de danser ou de bouger les pieds, vous vous éloignez de
l’idée de musique […]. Vous avez envie de danser lorsque
vous écoutez notre musique parce qu’elle vous transmet
la sensation du rythme […]. Les danseurs étaient d’un grand
secours pour les musiciens, parce qu’on pensait de la même
façon […]. On peut dire que nous composions pendant
qu’ils dansaient […]. C’est là que nous inventions les
nouveautés, et nous les enregistrions le jour suivant11.»
Ulf Poschardt12 rappelle la même chose en parlant du goût
perdu de la danse dans le mouvement hippie, le folk rock
et le rock, que seuls les Noirs et les artistes funk conser-
veront, avec, dans la foulée, les block parties introduites par
les DJ’s jamaïcains dans les quartiers populaires de la côte
est américaine, innovations de la piste de danse liées à des
fêtes populaires, publiques, semi-légales, et mêlant les
musiques soul, funk et latinos.
La culture populaire afro-américaine conserve l’ensemble
de ces caractéristiques, musiques et danses noires s’ap-
puient sur le quotidien et le reflètent. «La danse jazz fit
plus que n’importe quelle autre forme d’art pour faire
découvrir le Noir américain au monde d’après-guerre […].
Français et Européens découvrirent en eux la même affi-
nité avec cette musique et ces danses qui renvoyaient à ce
qui est de l’ordre de la vie, des émotions premières : un
corps dansant libératoire, jubilatoire13.»
C’est dans cette filiation que s’inscrivent la danse de rue et
le hip hop, répondant d’une part à cet ensemble de carac-
téristiques de la culture populaire, à savoir l’échange, la
réciprocité, la solidarité du groupe, mais
aussi la préservation de l’individualité; d’au-
tre part initiant un style rappelant le mode
d’être et de paraître des «zazous14» unissant
musiques, danses, costumes et coiffures.
❚8Hervé Di Rosa, L’Exposition inaugurale du Musée international d’art modeste,
catalogue, Sète, 2000, p. 15.
❚9Ibid., p. 17.
❚10 Paul Bourcier, Histoire de la danse, Paris, Le Seuil, 1994.
❚11 Éliane Seguin, Histoire de la danse jazz, op. cit., p. 123.
❚12 Ulf Poschardt, DJ culture, 1995, édition Kargo, traduction française 2002,
p. 96.
❚13 Éliane Seguin, op. cit., p. 125.
❚14 Pendant l’Occupation, les zazous exprimèrent leur non-conformisme et
leur opposition au régime en organisant des concours de danse qui les oppo-
saient parfois aux soldats allemands (source : www.wikipedia.org).
❙148-MARS 2007 diversité ville école intégration ❘45
Diversite_148_BAT 20/03/07 15:20 Page 45

ARTISTES ?
Comme l’art, le titre d’artiste est-il réservé à ceux qui répon-
dent à des critères normés détenus par les galeries, les
musées, les conservatoires de danse et de musique, les
écoles d’art? Qu’en est-il de ceux qui, passionnés de dessin,
de musique, de danse, de technologie, se forgent eux-
mêmes et produisent hors cadre?
Un détour par l’art «hors-les-normes » apportera des
éléments de réflexion. Je me référerai ici au catalogue de
La Fabuloserie, dans lequel Michel Ragon15 présente la
«fabuleuse collection» de ce musée (même s’il réfute le
terme, lui préférant celui de «cabinet de curiosités» – pour-
quoi?), collection rassemblée par Alain Bourbonnais, de
ceux qu’il appelle les artistes «hors-les-normes16 ».
Michel Ragon dit de ces artistes qu’ils sont les descendants
directs des créateurs d’une culture de la civilisation rurale,
culture populaire qui, «[…] à la fin du Moyen Âge, a été peu
à peu occultée par la culture savante citadine […]. Outre la
création nécessaire à sa survie, l’homme de la civilisation
rurale sculptait ses outils, ses ustensiles, ses meubles.
Chaque village avait ses “artistes”: poètes dialectaux, musi-
ciens, conteurs.» À propos du «musée», il poursuit ainsi:
«Nous voici bien en effet dans le domaine de la dérive et
de la subversion. Nous voici dans le domaine de l’irration-
nel, de l’imaginaire. Nous voici en pleine jubilation, libérés
des contraintes du consensus social, nous laissant aller à
la plus haute ingéniosité, à la plus absolue inventivité. Nous
voici dans le domaine du rêve. Nous voici dans le domaine
du jeu. Le jeu et l’art ont de nombreuses accointances. Le
monde du jeu, comme le monde de l’art, est nécessaire-
ment un monde d’incertitudes et de découvertes17.» Michel
Ragon affirme ainsi que ces artistes «hors-la-norme», qui
ne se départissent pas d’humour et de dérision, mettent
en cause et bouleversent les structures des définitions et
de la création artistiques. « L’art est source de perturba-
tion» conclut-il…
Comment ne pas voir les traits communs entre ces artis-
tes et ceux dont je traite ici? Mes enquêtes auprès des DJ’s,
des danseurs, des graffeurs mettent en évidence des
constantes qui convergent comme traits significatifs du
mouvement hip hop comme de la culture
populaire, constantes qui se rapportent aux
modes d’accès au savoir technique, à la
passion, à l’entraînement, aux origines
sociales en lien avec la rue.
D. Nasty, reconnu comme le «père» de tous les
DJ’s français, raconte comment il observait le
DJ jamaïcain Afrika Bambata, fondateur du
mouvement hip hop. Il rêvait des mêmes plati-
nes, qu’il mit cinq ans à pouvoir acquérir. Entre-
temps, il bricolait sur sa platine de salon, faisait
des essais, écoutait, réécoutait, s’entraînait pour
reproduire les scratchs…
DES PRATIQUES PORTÉES
PAR L’IMITATION ET L’ENTRAÎNEMENT
«Personne ne nous a appris, c’est à force
d’écouter des disques, d’observer la place-
ment de la voix. On avait nos références
[Public Enemy] et on s’inspirait de leurs
textes, transposés avec les problèmes de la
société française […].»
Éliane Seguin18 rappelle que l’expression noire
américaine est fondée sur une tradition vivante
se constituant à partir d’emprunts et d’inven-
tivité: «L’apprentissage s’effectue dans la soli-
tude du corps, à coups de répétition, de volonté
et de persévérance, dans une transmission par
imprégnation et par imitation, à l’instar du hip
hop. La culture noire américaine se transmet-
tait directement par le corps sans faire appel à
un système d’écriture. Dans la mesure où les
cuttin’contests constituaient un moyen pour les
jeunes danseurs de se frotter aux plus grands,
ils représentaient également une forme de
pédagogie initiatique, particulièrement adap-
tée au jazz. Là encore, on retrouve la rivalité, le
défi, les stratégies agonistiques, au nombre des
ressorts de l’expression noire américaine. Par
la pratique de la joute, l’individu s’affirmait et
accédait à la reconnaissance de son identité
par la communauté des pairs. Dès la naissance
du jazz, c’est par l’habilité à triompher dans
ces rencontres qu’un musicien ou qu’un
danseur asseyait sa réputation.»
❚15 Michel Ragon, La Fabuloserie-Bourbonnais, catalogue, Dicy, 1993, p. 18.
❚16 Je renvoie au texte de Michel Ragon pour le choix de ce terme plutôt que
celui d’art brut ou d’art naïf.
❚17 Ibid, p. 19.
❚18 Éliane Seguin, op. cit., p. 123.
46 ❘ville école intégration diversité 148-MARS 2007 ❙
Diversite_148_BAT 20/03/07 15:20 Page 46

Cet extrait résume l’esprit du mouvement hip
hop qui, comme Éliane Seguin le souligne, s’ins-
crit bien dans la filiation des cultures populai-
res. À l’origine sont ancrées une passion, des
dispositions déjà aiguisées, qui explosent avec
la découverte de nouvelles façons de faire. Les
images sont trop fortes pour ces protagonistes
des années 1980:
«Quand j’ai vu le break, je suis devenu fou!
Tout de suite, ça me fait ouahh! Ce qui m’a
plu, c’est que c’était au sol. Et moi qui ai
toujours aimé les choses qui se mettaient au
sol. Et mes parents disaient toujours que
c’était crade. Et quand j’ai vu les petits faire
des figures au sol, je me suis dit ouahh! C’est
une danse, tu te mets au sol, t’es crade, mais
c’est merveilleux! »
On trouve ainsi souvent, pour ces artistes, la
conscience du cheminement effectué depuis
leur jeunesse, en termes d’acquis, de revanche,
d’accès à des sphères sociales inenvisagées, de
découverte de la lecture, du verbe ou de la pein-
ture…
«Le rap a réussi ce que l’école n’a pas su
faire, me donner le goût de lire, de faire la
démarche d’aller chercher. Et c’est une bouli-
mie de connaissances, de savoirs, pour en
parler, d’écouter les infos. Finalement, via
une musique marginale, tu entres de plain-
pied dans la vie. J’ai mûri, j’ai grandi à
travers le rap, ça m’a donné le goût de plein
de choses. C’est énorme, l’école ne m’avait
pas donné ça», explique un rappeur.
DES REVENDICATIONS SOCIALES
ET IDENTITAIRES
Parmi les disciplines artistiques du mouvement hip hop,
le rap est aujourd’hui le plus attaqué voire condamné (le
graff l’est aussi, mais sur un autre plan). Il lui est reproché
les paroles de certains textes (il y a des procès…), mais
surtout les attitudes violentes de certains spectateurs lors
des concerts, ce que personne ne conteste et qui décou-
rage les programmateurs des salles. Rappeler les origines
du rap permet d’apporter un éclairage sur le sens de ces
attaques professionnelles, politiques ou médiatiques.
Les origines du hip hop se fondent à la fois dans la musique
jamaïcaine, la musique soul puis funk, la tradition afri-
caine de l’improvisation et de la joute oratoire et les reven-
dications du peuple noir américain dans les spécificités du
contexte de la société américaine. Au début des années
1970, des DJ’s jamaïcains organisent des block parties dans
les quartiers pauvres de New York, reproduisant les fêtes
jamaïcaines: les sound systems, sortes de bals populaires
de quartier. Ce sont ces DJ’s qui poseront les bases du rap
et de la break dance. Rap et reggae ont ainsi en commun
d’être issus d’un contexte d’oppression et de valoriser des
racines. Mélangeant langages argotiques et langues des
pays d’origine, ils s’enracinent dans le caractère moqueur
des chants et des danses des esclaves noirs.
Ces musiques sont diffusées à la fin des années 1970 dans
quelques discothèques (et sur quelques radios).
Le lien intime entre musiques et danses déjà ressenti mute
en une identification liée à la fois à l’origine sociale, au
sentiment de stigmatisation, à la territorialisation des inéga-
lités et aux revendications identitaires voire politiques:
«voix des sans voix», des exclus (comme dans les ghettos
noirs américains) dont le graff est d’abord la marque la
plus directement visible. En conséquence, les représenta-
tions sociales envers le mouvement hip hop sont inscrites
d’emblée dans l’équation : hip hop-jeunes-banlieue-
immigration-violence…
Cette question des classes sociales a souvent été abordée
lors des entretiens, comme d’ailleurs celles des origines
culturelles, avec des réactions diverses au sein du milieu.
L’assignation à laquelle les hip hopeurs sont renvoyés
suscite regrets et revendications vis-à-vis de cette image
sociale qui relègue au second plan les dimensions artis-
tique et esthétique.
❙148-MARS 2007 diversité ville école intégration ❘47
Diversite_148_BAT 20/03/07 15:20 Page 47
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%