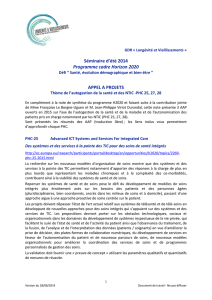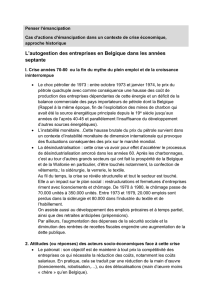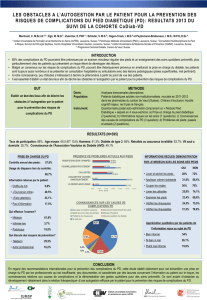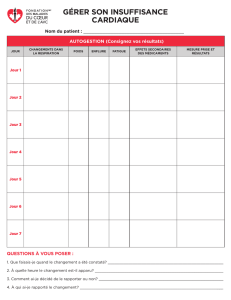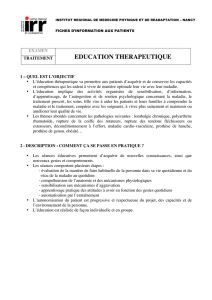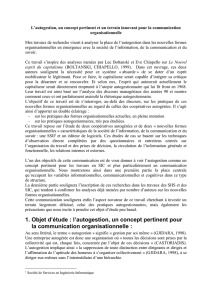L`autogestion dans la société de l`information québécoise

L’autogestion dans la société de l’information québécoise
Suzy Canivenc
Sous la Direction de Diane-Gabrielle Tremblay
Note de recherche no
2011-05
De la
Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir
(et du Centre de Recherche sur les Innovations Sociales)
Teluq-UQAM
Novembre 2011

2
Pour nous joindre :
Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir
www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir
Télé-université
Université du Québec
100 rue Sherbrooke Ouest ,
Montréal, Québec, Canada H2X 3P2
Téléphone : 514-843-2015
Fax : 514-843-2160
Courriel : [email protected]
Notes biographiques
Suzy Canivenc est post-doctorante au sein de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux
socio-organisationnels de l’économie du savoir et au Centre de Recherche sur les Innovations
Sociales. Docteure en Sciences de l’Information et de la Communication, elle est diplômée de
l’Université Européenne de Bretagne – Rennes 2 où elle est associée au laboratoire
Plurilinguismes, Représentations, Expressions Francophones - information, communication,
sociolinguistique (PREFics, EA 3207). En 2011, ses recherches doctorales sur l’autogestion et
la société de l’information lui valurent le Prix CREIS-Terminal (Centre de coordination pour
la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société, Revue Technologies de
l’information, culture et société).
Elle est qualifiée par le Conseil national des universités (CNU) de France, pour la fonction de
maître de conférences des universités en 71e section (sciences de l’information et de la
communication).
Voir : http://suzycanivenc.wordpress.com/
Courriel : suzy_canivenc@yahoo.fr
Diane-Gabrielle Tremblay est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux
socio-organisationnels de l’économie du savoir et directrice de l’ARUC-GATS (gestion des
âges et des temps sociaux). Elle est professeure à la Télé-université de l’Université du Québec
à Montréal, et elle a été professeure invitée aux universités de Paris I Sorbonne, de Lille I, de
Lyon III, d’Angers, de Toulouse, en France, de Hanoi (au Vietnam) à la European School of
Management et à l’université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Elle est présidente du
comité sur la sociologie du travail de l’Association internationale de sociologie, membre du
conseil exécutif de la Society for the Advancement of Socio-Economics et codirectrice du
comité sur les temps sociaux de l’Association internationale des sociologues de langue
française. Elle est également présidente de l’Association d’économie politique et directrice de
la revue électronique Interventions économiques. Elle a en outre écrit plusieurs ouvrages et
rédigé de nombreux articles parus dans des revues scientifiques avec comité, dont New
Technology, Work and Employment, Applied Research on Quality of Life, Social Indicators
Research, the Journal of E-working, the Canadian Journal of Urban Research, International
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, the Canadian Journal of
Communication, the Canadian Journal of Regional Science, Leisure and Society, Women in
Management, Géographie, économie et société, Carriérologie, Revue de gestion des
resources humaines.
Voir : www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir; www.teluq.uqam.ca/aruc-gats
Courriel : [email protected]

3
Sommaire
Résumé ..................................................................................................................................... 5
1. Introduction : .................................................................................................................. 6
1.1. Présentation du programme de recherche : une problématique au
croisement de l’innovation organisationnelle et technologique ........................... 6
1.2. L’autogestion .......................................................................................................... 7
1.2.1. Généalogie de l’utopie autogestionnaire .................................................... 7
1.2.2. Définition de l’utopie autogestionnaire ...................................................... 8
1.2.3. Les difficultés de l’autogestion .................................................................. 11
1.3. La société de l’information ............................................................................... 13
1.3.1. Généalogie et présentation de l’idéologie de la société de
l’information .................................................................................................................. 13
1.3.2. Les ambivalences de la société de l’information .................................... 24
1.4. Présentation de la recherche menée au Québec ........................................ 28
1.4.1. Problématique et hypothèses ...................................................................... 28
1.4.2. Corpus et méthodologie :............................................................................. 32
2. Principes organisationnels ......................................................................................... 39
2.1. L’autogestion ........................................................................................................ 39
2.2. Les liens entre l’utopie autogestionnaire et les idéologies technicistes :
42
2.2.1. Le Libre : ......................................................................................................... 42
2.2.2. L’Agilité : ........................................................................................................ 43
3. Pratiques organisationnelles : .................................................................................. 49
3.1. Gouvernance et structure organisationnelle : ............................................. 49
3.2. Organisation du travail : ..................................................................................... 68
3.3. Gestion des ressources humaines : ................................................................. 72
3.3.1. Embauche : ..................................................................................................... 72
3.3.2. Intégration ...................................................................................................... 76
3.3.3. Formation ........................................................................................................ 80
3.3.4. Evaluation ....................................................................................................... 84
3.3.5. Rémunération ................................................................................................. 86
3.4. Les TIC .................................................................................................................... 89
3.5. Les relations externes : ...................................................................................... 93
4. Evolution et limites organisationnelles .................................................................. 97
4.1. Les limites organisationnelles : ........................................................................ 97
4.2. Les limites humaines : ...................................................................................... 100

4
4.2.1. Le pouvoir : .................................................................................................. 100
4.2.2. L’auto-exploitation ..................................................................................... 107
4.2.3. La difficile inclusion du pluralisme .......................................................... 118
4.2.4. Les conflits .................................................................................................... 122
4.3. Les limites contextuelles ................................................................................. 124
4.4. L’évolution dégénérative en question : ....................................................... 126
5. Conclusion .................................................................................................................... 133
5.1. L’autogestion et la société de l’information ............................................... 133
5.1.1. Les TIC et l’utopie autogestionnaire........................................................ 133
5.1.2. Les TIC et la praxis autogestionnaire : .................................................... 134
5.2. L’autogestion dans le contexte québécois .................................................. 135
5.2.1. Les ambivalences symboliques du contexte québécois ........................ 136
5.2.2. Forces et faiblesses des pratiques autogestionnaires québécoises .... 137
6. Annexe : l’Agilité et la méthode Scrum ............................................................... 142
7. Bibliographie : ............................................................................................................. 153

5
Résumé
Cette note de recherche s’inscrit dans le prolongement d’une thèse en Sciences de
l’Information et de la Communication intitulée « Autogestion et nouvelles formes
organisationnelles dans la société de l'information, de la communication et du savoir ».
Ce programme de recherche s’intéresse à la possible réactualisation de l’utopie
autogestionnaire dans le contexte de la société de l’information et s’interroge sur la portée
idéologique et pratique des recompositions organisationnelles actuellement à l’œuvre.
La problématique de l’impact socio-organisationnel des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions. Cette question, déjà
largement alimentée, est ici abordée d’un point de vue inédit et atypique qui confère toute son
originalité à ce programme de recherche : celui de l’autogestion.
Ces recherches se situent ainsi à la croisée de l’innovation socio-organisationnelle et de
l’innovation technologique.
Le travail mené ici cherche à approfondir et mettre à l’épreuve les conclusions issues de
notre thèse en transposant notre problématique d’origine au contexte québécois, qui nous
semble à certains égards plus favorable au développement des nouvelles technologies et des
innovations sociales.
Il s’appuie sur les monographies de trois structures dont nous avons interrogé les principes,
les pratiques et les trajectoires organisationnelles pour ensuite les comparer : une
coopérative de travail autogérée, une entreprise Agile de développement logiciel et une
OBNL autogérée du secteur des TIC.
Tout en donnant à voir l’originalité de ces trois structures, nous avons cherché à apprécier
leurs différences et leurs similitudes ainsi que leurs apports et limites en termes d’innovation
sociale.
Par ce travail, nous tenterons d’éclairer concrètement les opportunités et limites que
l’autogestion rencontre dans le contexte de la société de l’information québécoise au regard
du contexte français. Plus globalement, il s’agira de tirer tous les enseignements possibles
dont sont porteuses ces pratiques alternatives pour la compréhension des phénomènes
organisationnels et des processus d’innovation sociale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
1
/
162
100%