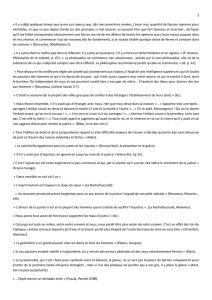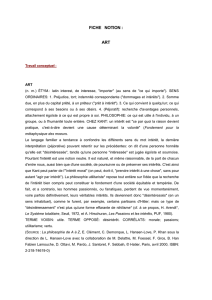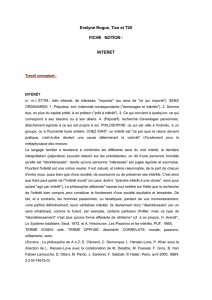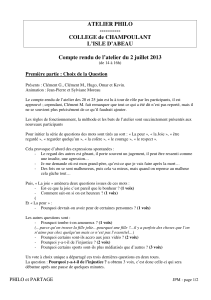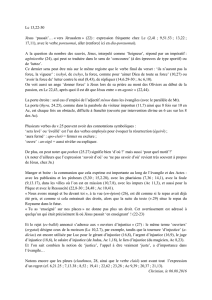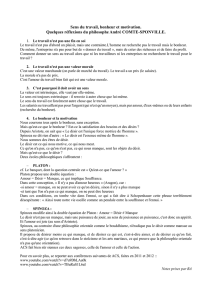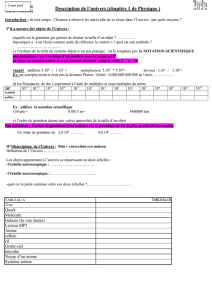1 JUSTICE ET EXCES D`INJUSTICE

1
JUSTICE ET EXCES D’INJUSTICE - QUELQUES REMARQUES SOUS
PERSPECTIVES CROISEES : ARISTOTE, PASCAL, KANT
Colloque Toulouse 16-17 juin 2011
Arnaud Berthoud, Clersé, Lille 1 ([email protected] )
Il est facile de dire qu’il n’y a pas d’hommes justes sans institutions justes et pas
d’institutions justes sans hommes justes. Cela vaut dans toutes les sphères de la vie politique
et sociale – à commencer par l’économie. Mais quel est l’ordre de priorité lorsqu’il s’agit
d’établir une société meilleure ? Faut-il privilégier d’abord les institutions et les règles :
favoriser l’intelligence juridique, inventer des dispositifs, adapter les règles aux circonstances
et aux mœurs, devenir toujours plus rationnel dans la lutte contre les écarts et les indocilités
de toute sorte ? Ou d’abord les vertus, l’éducation par chacun de ses propres passions,
l’exemple des bonnes conduites et le respect des autorités morales ? L’alternative se présente
au début des temps modernes dans les Etats européens sous une forme particulièrement vive.
Quentin Skinner en étudie les différents partis dans le domaine politique chez les derniers
scolastiques et les réformateurs – plutôt pragmatiques et institutionnalistes - et chez les
humanistes sous l’inspiration de Cicéron et du stoïcisme ancien – plutôt éthiques et tantôt
optimistes – Erasme - tantôt pessimistes – Machiavel, Thomas More. Son étude s’arrête avant
l’utilitarisme de Hume – côté institutionnaliste – et avant le jansénisme de Pascal – côté
éthique - et, dans les deux cas, avant l’invasion des problèmes économiques posés par le
nouveau régime économique du capitalisme. Existe-t-il pareil ouvrage magistral poursuivant
les traces d’une même opposition dans le domaine de la philosophie économique et jusqu’à
notre époque ? Il ne me semble pas. Faut-il penser que le parti de l’utilitarisme et de la science
économique néo-classique ou institutionnaliste ont définitivement refoulé le parti contraire de
l’éthique et des vertus en matière de justice économique, au point d’enlever tout sens à l’idée
même d’une alternative possible ? Je prends ici la position la plus ancienne : partir du plus
bas, traiter d’abord la justice comme mesure à même l’exercice le plus simple de l’échange ou
du partage, affirmer qu’au cœur de tout agent économique la réalité la plus profonde n’est pas
le cynisme de l’intérêt mais le désir du meilleur ou du bien, montrer alors par contraste que
l’excès du malheur de n’avoir pas son dû fait monter la plainte d’étage en étage jusqu’à
l’attente d’une autre justice que la justice des hommes et suggérer enfin que la science
économique est ainsi engagée dans une proximité avec la religion. Cette position ne serait pas
seulement la suite directe de la position que Skinner prête à l’humanisme et la tradition
grecque. Elle indiquerait aussi quelque chose qui fait la spécificité de l’économie par rapport à
la politique : le fond de la politique est grecque, elle ignore la perspective des pauvres,
l’économie y est au contraire attachée, elle place la justice de la propriété sous la perspective
des pauvres, en ce sens elle comporte quelque chose de plus universel que la politique.
Je distingue deux moments dans mon étude. Un premier moment dit « Aristote », pour
réinscrire l’économie dans l’éthique de la justice, contre la science économique actuelle ; un
second moment dit « Pascal, Kant », pour rattacher l’éthique de la justice à une sphère
transcendante ou la sphère des dieux, contre le courant pragmatique de la philosophie actuelle.
Où cela me conduit-il ? Non pas absorber l’économie dans l’éthique et l’éthique dans la
religion et la théologie – mais marquer seulement des proximités et des articulations.
« Aristote », « Pascal », « Kant » n’indiquent pas ici des auteurs dont je suivrais précisément
la pensée, mais des balises pour marquer des orientations.

2
1- Le premier moment enchaîne des notions et des définitions. On se trouve alors sous
la seule modalité de ce qui est possible de porter dans la pensée de manière cohérente. On ne
pose pas encore la question de la réalité. On répond à la question : qu’est-ce que la justice ou
qu’est-ce qu’un homme juste lorsqu’il s’agit d’économie ? On ne pose pas la question :
comment passe-t-on de l’injustice à la justice ou les agents économiques peuvent-ils devenir
justes ? Il s’agit en fait ici de situer les notions relatives à l’économie de la justice par
opposition aux notions relatives à la science économique orthodoxe.
Sur cet enchaînement de notions, on fera quatre remarques.
1.1 On pose d’abord qu’il n’y a pas de justice qui ne soit un bien et à ce titre un
bonheur. L’injustice commise ou l’injustice subie est au contraire un malheur. Or le bonheur
que chacun désire et dont il peut jouir comme être singulier ne s’éprouve pas comme une
somme de parties disjointes et une quantité, mais comme une totalité. Le bonheur est en ce
sens plus qu’un plaisir ou une somme d’instants de plaisir. Celui qui le goûte se réjouit de sa
vie dans sa durée. Il peut devenir un ami de lui-même (Aristote, Ethique à Nicomaque, 1097 b
20, 1168 b10).
On peut assurément se dire à soi-même et indiquer aux autres dans le langage de la
conversation qu’on a été ou qu’on est plus ou moins heureux et faire des comparaisons entre
quelques uns de ses états passés ou présents, comme si le bonheur était une grandeur ou une
quantité mesurable. Chacun sait cependant en son for intérieur que les mesures personnelles
de bonheur restent irrémédiablement subjectives et flottantes et que leurs usages dans des
indicateurs de comparaisons – quelque soit leur succès d’opinion - ne traduisent pas eux-
mêmes un état heureux. A l’inverse du bien-être utilitariste individuel et collectif, la notion
aristotélicienne de bonheur n’en fait pas un produit susceptible d’un calcul et d’une évaluation
objective.
1.2 Cela veut-il dire que la justice - puisqu’elle est, comme bien, un bonheur – serait
elle aussi hors grandeur et calcul ? C’est ici la seconde remarque. Il faut en fait distinguer la
justice comme qualité sociale dans une opération collective de distribution, d’une part, et,
d’autre part, la justice comme vertu et bonheur. Celle-ci n’est pas une grandeur, mais un état
invisible de l’âme ou du cœur faisant d’un acteur un homme juste ; celle-là est une grandeur
objective dont l’expression est un nombre – les parts dans un partage, le prix juste dans un
échange, qui sont des données visibles et communicables.
La distinction se présente ainsi. Pour qu’il y ait justice ou injustice dans un acte de
distribution ou pour qu’on puisse valablement parler de justice dans un partage ou dans un
échange – justice distributive, justice commutative – il faut qu’il y ait à la fois trois choses.
Des personnes, des choses possédées et des relations entre ces personnes et ces choses
possédées. En ce sens, la justice ne qualifie l’état des personnes dans une distribution –
comme vertu ou qualité de l’âme – qu’en déterminant en même temps l’état d’une opération
de distribution entre ce qu’on appelle des propriétés, des richesses ou des biens et services.
C’est ce double caractère qui distingue la justice de toute autre vertu en en faisant une sorte de
vertu sociale ou de bien commun – un état de bonheur pour chacun inscrit dans la durée de sa
vie comme une totalité indivisible et toujours actuelle, d’une part, et, d’autre part, un état

3
collectif qui s’exprime comme une grandeur objective valable pour plusieurs personnes dans
le même moment du temps. Elle n’est pas une grandeur parce qu’elle une vertu, un bien ou un
bonheur. Elle est une grandeur, d’abord, parce qu’elle se rapporte à des choses qui
s’apprécient elles-mêmes en quantités physiques ou naturelles et en utilité sociale ou
culturelle ; ensuite, parce qu’elle est, comme rapport entre ces grandeurs, une grandeur elle-
même – avec sa mesure propre qui se forme et ne vaut que pour le temps de la distribution et
entre les personnes concernées. Lorsqu’il s’agit d’un partage, il y a justice ou injustice s’il y a
égalité ou inégalité « proportionnelle » entre les quantités physiques distribuées et les qualités
ou « mérites » des personnes concernées (Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 1131 a 25).
Lorsqu’il y a échange, il y a justice ou injustice s’il y a égalité ou inégalité « arithmétique »
entre les quantités physiques échangées mutuellement et l’utilité que chacun en tire (id. 1132
a 1132 b 15). La justice est toujours un bien commun parce qu’on est jamais juste tout seul.
Elle entraîne du bonheur, qui reste toujours un bonheur singulier, parce que le bonheur ou le
malheur s’éprouve toujours en définitive au singulier. Mais elle a son espace propre
d’appréciation, de calcul et de détermination - une détermination qui ne se forme pas au-
dessus des personnes mais relève de leur discussion et de leur accord. C’est cet accord dans
un partage qui établit l’égalité proportionnelle entre les parts distribuées. C’est encore cet
accord dans un échange qui constitue l’égalité arithmétique des parties prenantes et se traduit
dans le prix juste. Le prix dans un échange est le chiffre de la justice.
1.3 On voit bien, à la suite de ces deux premières remarques, la différence avec la
science économique et son socle utilitariste. Dans la science économique, chaque agent est
isolé de tout autre ; tous abandonnent les passions mutuelles qui les lient naturellement les uns
aux autres et les entrainent dans un débat deux à deux sur la justice ; il n’y a plus que l’intérêt
de chacun ou le désir individuel de s’enrichir pour augmenter son bien-être. Le partage et
l’échange ne donnent plus lieu à discussion. Le partage n’est plus qu’une allocation
primitive ou une redistribution collective sous la règle d’une institution sociale ou politique ;
l’échange n’est plus qu’une opération à nombre indéfini d’agents dont le processus se passe
par-dessus la tête ou la volonté de chacun à la manière d’une mécanique sociale. Or on sait
que toute analyse du fonctionnement d’une mécanique relève naturellement d’une physique
mathématique pour laquelle les mouvements se traduisent par des grandeurs déterminées les
unes par rapport aux autres. La science de l’échange n’est donc plus une éthique de la justice ;
elle devient une science positive pour laquelle le terme final de l’échange s’établit au point
d’équilibre où les trois grandeurs engagées dans l’échange atteignent leur valeur optimum.
Dans cette conception mécanique ou positive de l’échange, les trois grandeurs sont les
suivantes – la grandeur utilité ou valeur d’usage, la grandeur physique des biens et services et
une troisième grandeur inconnue de la tradition aristotélicienne : la grandeur sociale du prix
réel ou « la valeur d’échange ». Quand chaque agent obtient la plus grande utilité possible de
chaque bien et service échangé - ou le plus grand bien-être total - les valeurs optima des
grandeurs physiques désignent à leur tour une valeur sociale ou un prix d’équilibre. Ce prix
d’équilibre est donc inversement la condition du bien-être maximum.
La question de la justice n’est posée qu’après coup, sans qu’on sache d’ailleurs qui la
pose ou au nom de qui l’économiste la pose - pourquoi et comment la rattacher précisément
au désir et au choix individuel de bien-être. Elle ne relève que de critères extérieurs aux
impératifs premiers de l’échange. Il n’y a plus de justice dans l’échange ou de justice
commutative comme telle, puisqu’il n’y a plus matière à débat entre agents soucieux de

4
devenir justes ensemble. Comme le disent Turgot ou Montesquieu, il suffit que « la
concurrence fasse le prix juste ».
Dans la tradition aristotélicienne, au contraire, il n’y a pas économie puis justice, mais
économie comme justice. La justice mesure le partage et l’échange pour ceux qui agissent et il
n’y a pas d’autres mesures pour eux en dehors de la justice. On discute en termes de justice et,
dans l’échange, par commodité en termes de prix monétaires plus ou moins justes - la
monnaie n’étant alors qu’une expression conventionnelle de cette mesure. La justice est la
véritable grandeur de l’échange. C’est cette grandeur que la science économique orthodoxe
écarte en posant à sa place la grandeur sociale du prix réel ou de la valeur d’échange.
1.4 Pour résumer dans une dernière remarque et pour faire aussi transition – ou en
dépassant déjà la seule modalité du possible et en abordant la question de la réalité - on peut
dire ceci. Il y a deux manières d’échapper à l’invention du prix réel ou de contourner le
régime illusoire de la valeur d’échange – dont la science économique se fait un titre de gloire :
ou par l’affirmation néo-mercantiliste et institutionnaliste de l’exclusivité du prix monétaire
ou par le retour à la tradition aristotélicienne du prix juste. Dans les deux cas, on récuse le
modèle physico-mathématique d’une science de l’échange en récusant l’idée d’une réduction
possible du prix monétaire à une grandeur dont la substance ressemblerait à la grandeur
physique d’une masse ou d’une longueur. Mais dans le premier cas, on s’en tient au minimum
nominaliste d’une économie monétaire pour laquelle le langage de la monnaie vaut comme
institution d’une mesure et de sa règle. Dans le second cas, on fait le choix d’un réalisme
éthique pour lequel la monnaie n’est pas une mesure véritable mais seulement une manière
conventionnelle de se communiquer les uns aux autres la mesure véritable de la grandeur
réelle de la justice en tout échange. De l’un à l’autre, du nominalisme monétaire au réalisme
éthique, ce qui change, ce n’est pas seulement la perspective sur l’échange – pas de grandeur
réelle pour le nominalisme monétaire, une grandeur réelle pour le réalisme éthique - c’est la
définition de l’agent.
L’agent de l’institutionnalisme monétaire reste l’agent isolé et ramassé sur son seul
intérêt - l’agent même que la science économique des temps modernes a recueilli de Hobbes
et de Hume. Cet agent est sans langage ou sans parole. Il n’y a langage qu’à l’étage des
institutions et de l’économiste. Ce qui veut dire que dans l’échange, seul l’économiste use des
noms et parle en prix par-dessus les agents. L’agent de l’économie de la justice de tradition
aristotélicienne est au contraire un sujet moral dont les passions relatives à la propriété
l’entraînent en chaque échange dans le heurt et le débat avec un partenaire privilégié.
L’institutionnalisme monétaire conserve l’illusion du « marché foule » avec agents multiples,
dispersés et muets qui sied à l’approche physico-mathématique de la science économique
orthodoxe. La science économique de la justice s’en tient à la réalité du « marché rencontre »
dans lequel chacun parle en prix et discute du niveau qui lui convient en face à face avec
autrui. Pour elle, quelque soit le nombre de concurrents possibles de chaque côté de
l’échange, la transaction est toujours en définitive un lieu de parole à deux et la concurrence,
rien d’autre que des arguments dans leur discussion.
2. Comment corrige-t-on alors dans le cours d’une rencontre et d’une discussion à
deux le malheur de l’injustice subie ou de l’injustice commise ? Comment, plus largement,
passe-t-on d’un état de partage ou d’échange vécu comme un malheur à un état meilleur ?

5
L’acteur a-t-il la maîtrise de ses passions et de ses sentiments ? La raison gouverne-t-elle les
passions ? Comment concevoir plus largement encore une éducation morale ? C’est ici le
deuxième moment dans le traitement du thème. On passe de la définition des notions de
justice et d’injustice à la question de savoir comment l’agent économique peut se transformer
et devenir meilleur ou plus juste. Ici se pose la question de savoir ce qui se passe dans la
réalité.
La thèse qu’on veut défendre est la suivante : il y a plus d’injustices dans le monde
que nous n’en pourrons jamais réparer ou plus de malheur dans l’injustice subie ou dans
l’injustice commise que n’en pourront jamais surmonter la volonté et la correction des
passions. Sous cette perspective d’un excès du mal sur le désir de justice, le problème de la
réparation de l’injustice dans les actes de distribution ne nous fait pas seulement courir dans
l’histoire après un idéal inaccessible. Il nous fait aussi monter dans la sphère des dieux en
élevant la science de l’échange et l’éthique de la justice au-delà de la justice des hommes. On
peut dire alors que l’excès de l’injustice sur la justice traduit une notion de justice à la fois
indivisible et duelle, en définitive énigmatique : à la fois justice rétributive lorsqu’il s’agit de
nos biens, de nos avoirs ou de nos propriétés – répondant à la question « pourquoi ai-je moins
qu’un autre ou ai-je bien ce qui m’est dû » - et justice comme destin ou fortune – répondant à
la question « pourquoi suis-je ce que je suis, pourquoi suis-je frappé par le sort ou pourquoi
suis-je né pour souffrir ». On verra que c’est la présence des pauvres qui porte ces deux
aspects de la justice.
2.1 Il faut d’abord préciser ce dont il est question lorsqu’on parle de passions. Il y a
deux grandes directions.
Selon la première direction, la vie affective, les passions et leurs vertus, les bons et les
mauvais sentiments sont des qualités quasi-physiques assurant l’adaptation des êtres humains
aux choses et au monde social – orientation de type Hume ou A. Smith. Alors toute la vie
affective se ramène au désir de vivre ou à l’effort d’un vivant pour conserver sa vie et tous les
affects d’un agent peuvent s’observer de l’extérieur comme autant de variations sur le thème
de l’intérêt vital. L’intérêt économique comme désir de posséder au moindre coût – produire,
distribuer et consommer - n’est à son tour qu’une expression de cet intérêt vital. Il n’y a pas
de sujet moral distinct de l’acteur social. L’agent parle des modifications de son intérêt en
termes de causalité ou dans le langage en troisième personne qui est le langage de toute
institution et de tout spectateur dans une institution. C’est la direction suivie par l’ouvrage
connu d’A. Hirschman et c’est l’orientation générale du pragmatisme philosophique. La
justice n’est alors qu’un ajustement d’intérêt et son expression est une règle dont chacun
apprend qu’il est de son intérêt vital de la suivre.
Selon la seconde direction, les affects ou tout ce qui concerne la vie des sentiments
échappent par leur nature même à l’observation et l’explication de la vue théorique, de
l’entendement extérieur ou du langage en troisième personne. Ils ne sont saisis et compris
qu’à même l’action, la vie et le sentiment lui-même, selon une intelligence pratique ou un
langage en première personne – le « je » ou le « nous ». Qui pourrait savoir ce que veulent
dire l’envie, la peur de l’autre, la haine, la tristesse, la souffrance et toutes les joies de l’amour
de soi dans l’attachement à une propriété sinon le sujet qui en éprouve les excès ou les
apaisements, comme autant de voies vers le malheur ou le bonheur ? Et qui pourrait
comprendre, plus précisément, comment le malheur s’attache à l’injustice subie ou l’injustice
commise si ce n’est d’abord celui ou ceux que le désir d’être heureux entraîne à vouloir
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%