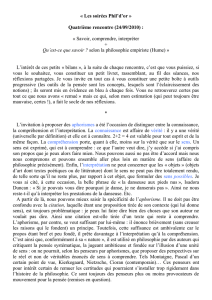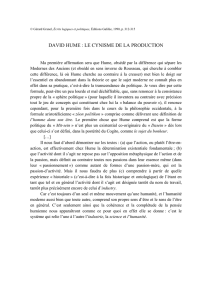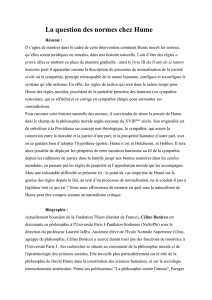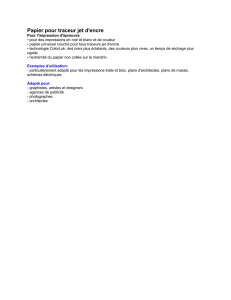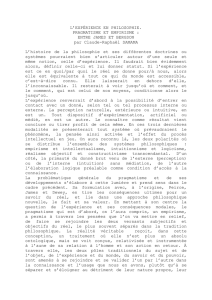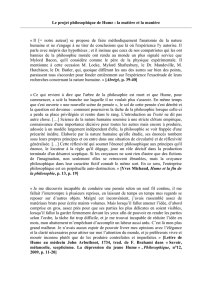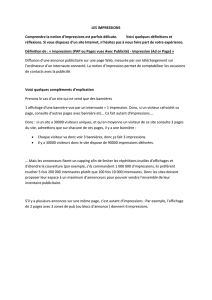L`empirisme: Locke et Hume

Accueil
Actualité
Pamphlet F. Hollande
Cours de philosophie
Introduction
Livre I : L’idéologie philosophique
Livre II : Conscience et individualité
livre III: le rapport au monde
livre IV: la raison et le réel
livre V: la morale
Livre VI: le politique
Livre VII: de l'anthropologie à l'histoire
Livre VIII: qu'est ce que l'art?
Culture philosophique
Philosophes
Notions
Lectures
Dissertations
Culture générale
Histoire
La réforme
Société
Culture littéraire
cours synthétiques
théâtre
auteurs
oeuvres
poésie
antiquité
Culture politique
La Question du communisme Lucien Sève
Introduction au marxisme I II III
La pensée politique au XVIIIème
Poèmes
Présentation
Poème du partage
Poèmes du ravage
Poèmes politiques
Poèmes du voyage
Poèmes de l'alliage
Poèmes du village
Poèmes de l'échange
Dernière balade Galerie de peinture
L'EMPIRISME: LOCKE ET HUME
Menu
DESCARTES
DIDEROT
EXISTENTIALISME ET
MARXISME
FOUCAULT
HEIDEGGER
LE BERGSONISME
L'EMPIRISME: LOCKE ET
HUME
LES PENSEURS DE LA
PREMIÈRE MOITIÉ DU XX
LES PHILOSOPHES DE LA
TROISIÈME VOIE
NIETZSCHE
ROUSSEAU
SAINT AUGUSTIN
SIMONE WEIL
SPINOZA
ACCUEIL ACTUALIT
ÉCOURS DE
PHILOSOPHIE CULTURE
PHILOSOPHIQUE
CULTURE
GÉNÉRALE CULTURE
LITTÉRAIRE CULTURE
POLITIQUE POÈMES GALERIE
DE
PEINTURE

La philosophie anglaise du XVIII°siècle :
L’empirisme
Introduction :
Le XVIII°siècle représente une rupture dans la réflexion philosophique : le progrès de la science : la physique expérimentale, aussi bien que les
transformations sociales, imposent l’idée de l’origine sensible de nos connaissances.
1) La physique expérimentale et la pensée de Newton
La mécanique céleste de Newton est caractérisée par deux traits qui diffèrent radicalement des principes de l’explication de la nature, réduite à la
mécanique galiléenne.
D’une part c’est bien l’application des mathématiques aux phénomènes naturels, qui permet de calculer rigoureusement les grands phénomènes
cosmiques (mouvement des planètes, pesanteur, marées) : l’invention du calcul des fluxions, seul langage adéquat de la nouvelle mécanique, permet
d’exprimer non seulement, comme la géométrie analytique, quel est l’état d’une grandeur à un instant donné, mais encore comment elle varie à cet instant
en intensité et en direction. Mais, d’un autre côté, et c’est là le second trait de la mécanique newtonienne, les conditions qui rendent possible l’application
de ce calcul à la réalité physique ne sont pas contenues dans le calcul lui-même : ces conditions initiales ne sauraient être mathématiquement déduites, mais
seulement données par l’expérience. On peut facilement imaginer telles conditions qui, si elles eussent été réalisées, auraient rendu complètement
impossibles l’emploi de ce calcul et la découverte de la loi de l’attraction : dans les circonstances actuelles en effet, la position d’une planète par rapport au
soleil est telle que l’attraction des autres corps de l’univers sur elle est négligeable par rapport à l’attraction du soleil, si bien que le calcul n’a à considérer
que l’attraction réciproque de deux masses ; mais supposons que les causes perturbatrices aient été du même ordre de grandeur que l’attraction solaire,
dans ce chaos d’actions réciproques, le calcul eût été sans application.
Il n’y a pas d’autre explication des phénomènes que le calcul mis en œuvre, qui seul rend compte de leur intelligibilité.
Tout se passe comme si, quand il s’agit de la connaissance de la nature, l’intelligibilité des phénomènes laissait place vide à l’intelligence des
causes.
Newton a déclaré, de façon répétée, que toutes les « hypothèses » c’est-à-dire les structures mécaniques imaginées pour rendre raison des phénomènes,
devaient être évitées dans la philosophie expérimentale. Non fingo hypotheses, c’est-à-dire je n’invente aucune de ces causes qui sans doute peuvent
rendre raison des phénomènes, mais qui sont seulement vraisemblables. Newton n’admet d’autre cause que celle qui peut être « déduite des phénomènes
eux-mêmes ».
Enonçant la loi de la gravitation universelle, Newton ne pensait pas du tout être arrivé à la cause dernière des phénomènes qu’elle explique : il
montrait seulement que c’est selon une même loi que les corps pesants sont attirés vers le centre de la terre, que les masses liquides des mers sont attirées
vers la lune dans les marées, que la lune est attirée vers la terre et les planètes vers le soleil : la preuve de cette identité de loi repose uniquement sur des
mesures expérimentales En d’autres termes, pour Newton, la physique expérimentale en quoi consiste notre connaissance rationnelle de la nature,
ne saurait permettre de parvenir jusqu’aux principes capables d’expliquer les phénomènes dont elle énonce les lois, – d’en déterminer les causes.

Il n’y a pas d’explication scientifique de l’origine des rapports actuels de position et de vitesse des corps célestes.
Comment interpréter cette limite de l’explication scientifique ?
L’empirisme est la réponse à cette question
2) L’empirisme et la philosophie anglaise
L’empirisme apparaîtpour la première fois au XVIII°siècle avec la philosophie anglaise,
La démarche empiriste de la philosophie anglaise est liée à la montée de la bourgeoisie qui doit obtenir de la royauté et de la féodalité anglaises la
reconnaissance des libertés nécessaires à son développement : Le but avoué de ses enquêtes sur « l’entendement », quand elle dénonce la confiance
en la raison comme saisie intuitive des essences, est de combattre l’innéisme des idées qui lui paraît fonder l’absolutisme du pouvoir et
l’immutabilité des privilèges. A travers la réflexion sur la connaissance, qui met en cause la représentativité des idées qu’on prétend fonder sur une
réalité permanente, indépendante du psychisme humain : passions et volontés des individus, ce qui est affirmé c’est le lien entre les idées et l’expérience
des hommes qui seule peut fonder les rapports qu’ils instituent entre eux sur la base de leur activité pratique. Quand Locke publie dans les années 1690
ses « Lettres sur la tolérance », ses « Traités sur le gouvernement civil » et son « Essai sur l’entendement humain » , il est revenu de son exil en Hollande
pour occuper la place de conseiller politique auprès de Guillaume d’Orange ; La « glorieuse révolution » a eu lieu en Angleterre, par laquelle la
bourgeoisie a obtenu du nouveau pouvoir la garantie des libertés nécessaires à son développement. Le compromis politique confirme par les faits la
démarche empiriste qui dénonçait comme une illusion de la raison le dualisme des idées et des choses, en montrant que l’expérience, inséparable de
l’activité pratique, est en fin de compte le seul et véritable terrain où se constituent les liens entre les idées, comme s’y instituent les rapports entre les
hommes.
La problématique empiriste
La réflexion « empiriste » sur la connaissance, persuadée d’un lien naturel de l’homme au monde qui dément le dualisme mis à jour par la réflexion de
Descartes, exclut toute spéculation qui doit faire appel à l’existence d’un dieu pour réconcilier la pensée avec la nature ; mais n’est-elle pas amenée
en même temps à « découvrir » que l’on n’a jamais affaire dans la connaissance à cette réalité indépendante de la pensée qu ‘on appelle matière ?
La question posée par la réflexion empiriste, - aujourd’hui comme hier -, peut être formulée ainsi : - Sachant que nous n’avons jamais affaire qu’à des
idées, ne peut-on rendre compte de l’objectivité de nos connaissances, en expliquant la formation de ces idées à partir des données des sens, sans poser le
problème insoluble du rapport des idées et des choses, de la pensée et du réel ?
La réflexion sur l’expérience ne permet-elle pas de comprendre l’objectivité de la connaissance sans faire de l’objet une chose – une réalité –
indépendante de la connaissance?
Et, à la fin du compte, le problème insoluble du rapport des idées et des choses, qui est à l’origine de tous les systèmes philosophiques, ne prend-il pas sa
source dans la simple croyance en une réalité, dont nos idées seraient la représentation, la reproduction ?
La démarche de Locke
C’est Locke (1632-1704)qui, le premier, met en cause le rationalisme de Descartes, fondé sur l’innéité des idées.
Il a lutté toute sa vie contre la théocratie anglicane, c’est-à-dire contre ces deux thèses solidaires : le pouvoir du roi est un pouvoir absolu et de droit divin ;
le pouvoir du roi est un pouvoir spirituel non moins que temporel, et il a le droit d’imposer à la nation une croyance et une forme de culte.
L’Essai sur l’entendement humain, en montrant la nature et les limites de l’entendement humain, doit fonder la tolérance religieuse et philosophique. ll
voit dans l’innéisme, partant d’une prétendue connaissance immédiate et interne, une sorte de dogmatique qui laisse place à tous les préjugés individuels.
- Il part d’une réflexion sur la doctrine cartésienne : il est, comme le lui reprochent ses adversaires, un « idéisme » : nous n’avons jamais affaire aux
choses elles-mêmes mais toujours à des idées. Et, puisque nous n’avons jamais affaire qu’à des idées, la connaissance objective ne saurait résider
dans la correspondance des idées et des choses ; elle ne peut consister que dans la perception d’une convenance ou d’une disconvenance entre des
idées, comme : le jaune n’est pas le rouge, deux triangles qui ont leurs trois côtés égaux sont égaux etc. Pour expliquer la connaissance, il faut chercher
d’abord ce que sont les idées simples, puis comment elles se combinent pour former les idées complexes (livre II), enfin comment on perçoit la convenance
ou la disconvenance entre les idées (livre IV).
- Parmi les idées simples, seules les idées de sensation ( chaud, solide, poli, dur, amer, étendue, figure mouvement, etc. ) peuvent être considérées comme
représentatives d’une réalité extérieure ; mais, suivant ici Descartes, il faut distinguer :

1) les qualités premières : l’étendue, la figure, la solidité et le mouvement, avec les idées d’existence, de durée et de nombre, qui nous représentent les
choses telles qu’elles sont.
2) Quant aux couleurs, aux sons ou aux saveurs, ce sont des « qualités secondes » qui sont produites en nous par l’impression que font, sur nos sens,
divers mouvements de corps si petits que nous ne pouvons les apercevoir.
Doit-on pour autant, comme Descartes, prendre les qualités premières pour les éléments réels des choses, constituant la substance des choses ?
En fait il en va de même de toutes les idées aussi bien « d’étendue, de figure, de couleur, que de toutes les autres qualités sensibles, à quoi se réduit toute
notre connaissance des corps : D’un côté, il est impossible à l’esprit d’imaginer ces idées simples existant par elles-mêmes, sans une substance à laquelle
elles sont inhérentes ; mais, d’un autre côté, « nous sommes aussi éloignés d’avoir quelque idée de la substance des corps que si nous ne la connaissions
point du tout. » Nous n’avons, de cette substance, nulle idée : expliquer la cause de la liaison des idées simples, cela est au-dessus de notre entendement :
La substance, pour Locke, sans doute existe, mais nous ne savons ce qu’elle est, et la seule recherche possible pour nous est la recherche
expérimentale des qualités coexistantes.
La porte est ouverte par la réflexion empiriste de Locke à l’idéalisme de l’évêque Berkeley (1685-1753) : Si nous n’avons jamais affaire qu’à des
idées qui sont des perceptions, pourquoi, distinguant des qualités premières (grandeur, étendue etc.) et des qualités secondes ( telles les couleurs, les
saveurs etc.) voudrait-on que les premières nous renvoient à l’existence d’une réalité indépendante de nos sensations ? quelle différence y a-t-il entre le
blanc et la perception du blanc, sinon le nom qui est un signe que nous avons institué pour communiquer entre personnes auxquelles Dieu a donné la
faculté de voir un monde ? Pour un esprit doué de cette vision, être, ce n’est rien d’autre qu’être perçu.
Comment expliquer la connaissance sans référence à quelconque caractère représentatif de l’idée qui renverrait à l’existence d’une substance
indépendante de la connaissance, en évitant le piège de l’idéalisme de Berkeley, telle est la tâche qui s’impose à Hume, dans la seconde moitié du siècle.
La réflexion de Hume
Hume (1711-1776) publie en 1737 le Traité de la Nature humaine qu’il transforme en Essai neuf ans plus tard.
a) la distinction des impressions et des idées
Hume, restant dans la ligne de l’idéisme, fait une distinction entre les impressions et les idées , qui, selon lui, lève la difficulté : les impressions, ce sont les
originaux ou modèles, dont les idées sont les copies ; elles sont fortes et vives, tandis que les idées sont faibles ; dès lors, il est vrai que toute idée est
représentative, mais elle est représentative d’une impression, qui est de même nature qu’elle, supérieure seulement en intensité ; aucune idée n’est
valable, aucune idée n’a même d’existence, si on ne sait assigner le ou les impressions dont elle est la copie.
L’objet propre de la réflexion n’est pas l’étude de l’impression, étude qui, selon lui, ressortit à l’anatomie et à la physiologie et non à la philosophie : ce
sont uniquement les idées, ces copies des impressions, dont les relations diverses entre elles et avec les impressions, forment le tissu de l’esprit.
b) les lois de fonctionnement de l’esprit
Il s’agit donc de rechercher quelles sont les formes qui entrent naturellement et spontanément en jeu pour lier les idées entre elles. Or, l’expérience montre
que deux idées entrent en connexion soit à cause de leur ressemblance, soit parce que les impressions dont elles sont les copies ont été contiguës, soit enfin
parce que l’une représente une cause dont l’autre représente l’effet.
Ces lois ( de fonctionnement de l’esprit) sont, à nos idées, ce que la loi newtonienne d’attraction est aux corps : elles maintiennent l’ordre dans l’esprit,
comme la loi de l’attraction maintient l’ordre de l’univers, en formant toutes les idées complexes.
c) Le problème de la relation de causalité
Parmi ces connexions, seule pose problème celle que nous percevons comme une relation de cause à effet, qui semble supposer une liaison
nécessaire, indépendante de l’esprit.
A consulter et à retourner en tout sens l’idée de la chose qui est cause, nous n’y trouvons aucun efficace pour produire l’effet. S’il est vrai que nous
n’avons l’expérience d’aucune force ni d’aucune efficacité dans un fait, pourquoi et comment croyons-nous que ce fait sera suivi inévitablement d’un
autre que nous attendons avec la plus grande confiance ?

Rien n’autorise, selon Hume, à passer du constat de cette impuissance de la réflexion à expliquer la relation de causalité à une critique de la connaissance
sensible qui nous contraindrait, par une dialectique quelconque, à faire appel à un pouvoir propre de l’esprit. Ce n’est pas le fait d’une « relation
mystérieuse » de causalité qu’il faut expliquer, mais, restant sur le plan du fonctionnement de la pensée, c’est la « croyance » qu’il faut comprendre.
En effet, c’est seulement lorsque la croyance s’ajoute à l’idée, que l’idée devient la connaissance de quelque chose de réel. Or, cette nuance particulière de
l’idée, qui fait qu’on y croit, dérive de ses liaisons associatives avec les impressions présentes, car l’impression qui est plus vive que toute idée, a cette
propriété singulière de transmettre quelque chose de sa vivacité et de sa forme aux idées qui sont en connexion avec elles.
Nous tenons là tous les éléments d’explication de cette confiance que nous avons en l’apparition de l’effet, lorsque la cause est présente, confiance qui
aboutit au jugement que leur connexion est nécessaire.
On observera d’abord que nous n’admettons aucune connexion nécessaire qu’entre des faits successifs et contigus, dont la succession a été observée
plusieurs fois ; cette répétition n’affecte en rien le couple même des faits ; mais elle engendre dans notre esprit une habitude (custom) ; l’habitude fortifie la
connexion imaginative qui fait passer l’esprit de l’idée de l’un à l’idée de l’autre ; renforçant la connexion, elle produira une croyance irrésistible.
La connexion nécessaire n’est donc que la transition de plus en plus facile d’une idée à une autre, « le penchant, que l’habitude engendre, à passer d’un
objet à l’idée de son compagnon ordinaire ». L’idée de cause est donc, comme toute idée, la copie d’une impression, non pas la copie d’un pouvoir que
nous saisirions dans les choses, mais celle de cette impression interne ou impression de réflexion, qui est le sentiment d’habitude.
L’explication de la connaissance :
En posant au point de départ que la connaissance prend sa source dans les impressions des sens, la démarche consiste à montrer que les idées
n’ont pas d’autre réalité que psychologique : ce sont des images mentales qui renvoient aux impressions vives des sens sans lesquelles elles ne
seraient que de purs et simples phantasmes : l’imagination est précisément ce qui permet de croire aux idées comme si elles représentaient des
choses : une réalité indépendante comprise comme la cause des impressions. L’expérience n’est rien d’autre que l’ensemble des connexions entre
les idées à partir desquels se constitue l’image d’un monde.
Hume s’emploie à montrer que la connaissance que nous avons du réel n’est pas l’œuvre de la raison mais le produit de l’expérience, même si le
raisonnement semble jouer un rôle comme dans la science : Les prévisions scientifiques, loin d’être le résultat d’un raisonnement, sont des prédictions
fondées sur la répétition des phénomènes.
La raison n’est rien d’autre que ce penchant de l’esprit lié à la vivacité des impressions qui nous fait croire que la connexion des idées renvoie à
une réalité indépendante des images mentales.
C’est le penchant universel de l’esprit à se répandre sur les objets extérieurs qui nous fait supposer que cette nécessité est dans les objets que nous
considérons et non dans l’esprit qui les considère.
La portée de la démarche :
Si l’on cherche à comprendre la portée de la réflexion de Hume et, plus généralement, de la démarche empiriste, on est conduit à s’interroger sur le
scepticisme de Hume, qu’il définit lui-même dans le dernier chapitre de L’enquête sur l’entendement humain comme un scepticisme mitigé, pour le
distinguer du pyrrhonisme.
En posant au point de départ que la connaissance prend sa source dans les impressions des sens, la démarche consiste à montrer que les idées n’ont pas
d’autre réalité que psychologique : ce sont des images mentales qui renvoient aux impressions vives des sens sans lesquelles elles ne seraient que de purs et
simples phantasmes : l’imagination est précisément ce qui permet de croire aux idées comme si elles représentaient des choses : une réalité indépendante
comprise comme la cause des impressions. L’expérience n’est rien d’autre que l’ensemble des connexions entre les idées à partir desquels se constitue
l’image d’un monde.
La connaissance n’est pas un « logos » - une logique- : une raison qu’on peut aussi bien comprendre comme une activité de l’esprit ou comme un sens
immanent aux choses ; c’est un processus psychologique qui est propre à la « nature humaine » : un fonctionnement qui permet aux hommes de
réguler leur vie par l’habitude, on dirait aujourd’hui : un « habitus » autrement dit des dispositions acquises qui permettent l’adaptation des
individus à leur existence parce qu’elles constituent le monde auquel ils ont affaire.
La réponse aux questions insolubles soulevées par la philosophie est à chercher dans la nature humaine et son fonctionnement.
Nota :
 6
6
 7
7
1
/
7
100%