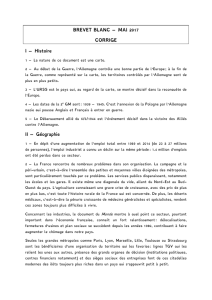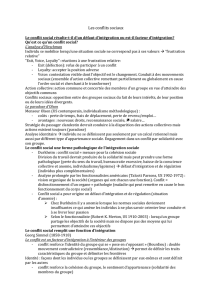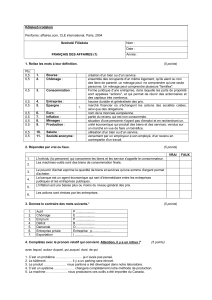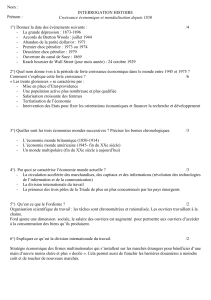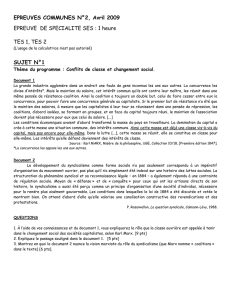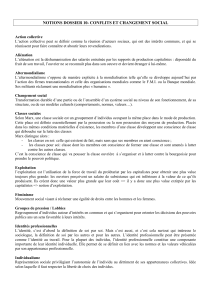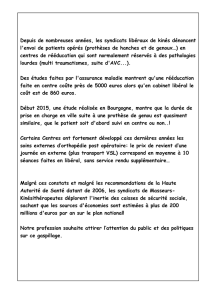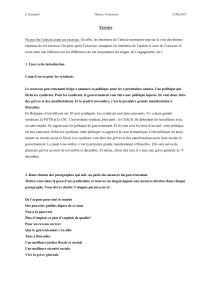1. L`effet des mutations du travail sur les conflits sociaux

CONFLITS ET MOBILISATION SOCIALE
1. L'effet des mutations du travail sur les conflits sociaux...................................................................................................................1
1.1. Des conflits du travail aux conflits sociaux.............................................................................................................................................................2
1.1.1. Les inégalités du monde du travail peuvent déboucher sur des conflits..................................................................................................................................2
1.1.2. Mais le conflit ne naît qu'avec la « conscience collective », s'il émerge une « identité professionnelle » qui crée un groupe par l'opposition
aux autres groupes.............................................................................................................................................................................................................................................2
1.1.3. Dans l'optique marxiste, les conflits du travail finissent par déborder de ce cadre pour concerner l'ensemble de la société...................................2
1.1.4.L'analyse du conflit social peut alors être menée en termes de lutte des classes....................................................................................................................2
1.2. De la « fin de la classe ouvrière » à la fin des conflits du travail ?...................................................................................................................3
1.2.1. Les mutations du travail ont réduit le poids des ouvriers, brouillé leur identité professionnelle et diminué leur capacité de mobilisation : les
théories de « la fin de la classe ouvrière »...................................................................................................................................................................................................3
1.2.2. Cependant, si l'influence politique et sociale des ouvriers est moins nette, les raisons du conflit avec les classes supérieures restent fortes......3
1.3. Le rôle des syndicats dans les conflits sociaux........................................................................................................................................................3
1.3.1. Le développement historique des syndicats....................................................................................................................................................................................3
1.3.2. Si les syndicats ont favorisé l'émergence de conflits sociaux par leur capacité d'organisation, ils ont également permis de les régler plus
facilement par l'institutionnalisation (des conflits et des organisations)............................................................................................................................................4
1.3.3. Mais, d'une part, les mutations du travail affaiblissent dans une certaine mesure les syndicats.......................................................................................5
1.3.4. Et, d'autre part, la montée de l'individualisme, par certains aspects, remet en cause l'action collective.........................................................................5
1.3.5. Cet affaiblissement des syndicats n'est cependant pas sans risque et il n'est peut-être que transitoire..........................................................................6
2. La diversification des objets et des formes de l'action collective.....................................................................................................6
2.1. Les Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS)..........................................................................................................................................................6
2.1.1. Les « Nouveaux » Mouvements Sociaux : nouveau contexte, nouveaux acteurs, nouveaux thèmes, nouvelles formes d'action............................6
2.1.2. Un exemple de NMS : le féminisme..................................................................................................................................................................................................6
2.2. Est-ce la fin des conflits du travail ?..........................................................................................................................................................................7
2.2.1. Les NMS sont plus adaptés à nos sociétés individualistes et mondialisées, où la place du travail se réduit..................................................................7
2.2.2. Mais les NMS ne sont pas si « nouveaux » que ça, et ils se mêlent en fait aux conflits traditionnels..............................................................................7
2.2.3. L'altermondialisme : nouveau mouvement social ou conflit du travail ?.................................................................................................................................8
2.3. Nouveaux Mouvements Sociaux et changement social.......................................................................................................................................8
2.3.1. Les NMS font apparaître de nouveaux conflits en remettant en cause la légitimité d’inégalités qui étaient jusque-là socialement acceptées....8
2.3.2. Les NMS font émerger de nouvelles valeurs et de nouvelles normes, voire des modèles culturels alternatifs.............................................................8
2.3.3. Les NMS essaient de déboucher sur une transformation de la société en influençant les politiques publiques..........................................................8
Nous venons de voir à quel point les sociétés démocratiques sont traversées par la tension entre les inégalités et l’idéal égalitaire
(chapitre 3). Inutile de dire que ces tensions se traduisent bien souvent dans la réalité par des conflits. Les conflits vont donc être notre
objet d’étude dans ce chapitre.
Pourquoi nous intéresser au conflit, alors que c'est a priori une mauvaise chose, qu'on nous pousse à éviter ? Justement, parce que
cette mauvaise chose n'est simplement mauvaise que parce qu'elle remet en cause l'ordre établi, autrement dit parce qu'elle engendre
du changement social, ce qui dérange ceux qui voudraient les choses restent comme elles sont. La première chose à faire, pour parvenir
à étudier sérieusement cette notion de « conflit social » est donc de se débarrasser de nos « prénotions », c'est-à-dire de nos
connaissances de sens commun sur le conflit : il faut tenter de les observer d'un regard neutre. Cela nous permettra d'observer que les
frontières mêmes de ce que l'on nomme « conflit » sont mouvantes, car cette délimitation est elle-même un enjeu de luttes sociales :
« l'absence de définition fait partie de sa définition. [...] Si les frontières, les limites du mouvement social sont mal définies, c'est parce
qu'elles sont un enjeu de luttes » (Gérard Mauger, 2002).
Essayons d'illustrer cette idée par un exemple. Lorsque les syndicats ouvriers descendent dans la rue pour revendiquer une hausse
du « pouvoir d'achat », nous avons affaire à un conflit social, nul doute à ce sujet. Mais lorsque ces mêmes syndicats sont présents dans
des institutions comme la Sécurité sociale, qu'ils gèrent en partenariat avec les autres « partenaires sociaux » comme le Medef,
sommes-nous toujours dans une situation de conflit ? Non, car les discussions sont calmes et feutrées, elles restent dans le cadre très
défini dans lequel elles doivent prendre place. Oui, car il y a bien lutte pour faire triompher sa propre volonté contre celle des autres.
Lorsque des lycéens se rassemblent devant leur établissement scolaire pour réclamer quelque chose, est-on face à un conflit
social ? Non, une simple crise d'adolescence, il faut que jeunesse se passe. Vous le voyez dans cet exemple, le fait de nier l'existence
même du conflit est une façon de le gagner ; alors que si les lycées parviennent à faire admettre qu'il s'agit bien là d'un conflit (en
obtenant un article dans le journal local par exemple), ils ont déjà gagné la première bataille. La définition du conflit est elle-même un
conflit. En jargon sociologique, on dit que le conflit est un « opérateur systémique », c'est-à-dire qu'il nous en apprend autant sur le
conflit lui-même que la société dans son ensemble.
Tout ceci est bien ennuyeux pour un sociologue : comment étudier le conflit si je ne sais pas de quoi il s'agit ? Le sociologue,
homme très intelligent s'il en est, a bien sûr trouvé une solution : on adopte une définition large, qui englobe tous les conflits
imaginables, de la dispute entre la mère et sa fille au conflit entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Nous pouvons ainsi retenir la
définition de Max Weber : le conflit est « une relation sociale pour autant que l’activité est orientée d’après l’intention de faire
triompher sa volonté contre la résistance du ou des partenaires ». Pour simplifier, un conflit est une relation sociale qui met en
opposition des acteurs aux intérêts incompatibles.
Mais, tout comme les acteurs usent de la définition du conflit comme une des armes de ce conflit, les sociologues aussi jouent
avec la définition du conflit en fonction de ce qui les arrange. Ainsi, pour Karl Marx, le conflit a lieu entre deux grands groupes
d'individus appelés « classes sociales » dont l'un domine l'autre, et il vise au renversement de la domination. Pour certains sociologues
de la fin du XXè siècle par contre, le conflit s'est mué en conflit « post-moderne » : il a lieu entre des petits groupes plus ou moins
éphémères, qui cherchent à modifier les valeurs de la société ; le travail et la domination ne seraient plus au centre des luttes sociales.
Ainsi, la définition que donnent ces sociologues du conflit trahit leur point de vue général sur la société : en jargon sociologique, on dit
que le conflit est un « opérateur épistémique » (l'épistémologie est la partie de la philosophie qui s'intéresse aux conditions dans
lesquelles la science est produite), dans la mesure où « en simplifiant à peine, on pourrait avancer l’idée selon laquelle, à travers le
concept de conflit, c’est aussi bien la question de la nature du système social qui se trouve posée que celle de la sociologie elle-même »
(Pierre Birnbaum, 1991).
Cette notion de conflit est ainsi passionnante : son étude nous permet à la fois de décrire la société dans laquelle ils prennent
place (opérateur systémique) et la sociologie qui l'étudie (opérateur épistémique) ! Bon, je sens que vous n'avez rien compris à ce
charabia jargonnant, alors je passe à des choses plus simples. Nous nous demanderons dans ce chapitre comment ont évolué les
conflits sociaux au cours du siècle passé. Dans une première partie, nous nous intéresserons aux conflits du travail, et nous nous
demanderons dans quelle mesure les mutations du travail ont entraîné la fin des « conflits de classe ». Puis, dans une seconde partie,
nous nous intéresserons aux nouvelles formes de conflits nées dans les années 1970, et nous nous demanderons dans quelle mesure ces
« nouveaux mouvements sociaux » (NMS) sont bien « nouveaux ».
1. L'effet des mutations du travail sur les conflits sociaux
Depuis que les sociétés sont entrées dans la « modernité », c'est-à-dire depuis que « l'individu » existe face au groupe, soit depuis
le XVIIIè siècle environ, l’essentiel des conflits sociaux s'est déroulé sur le terrain du travail et de l’emploi. On peut essayer de
comprendre pourquoi : le travail occupe, directement ou indirectement, l’essentiel de la vie des individus, en temps d’abord (et bien
plus au XIXè siècle qu’aujourd’hui) et aussi parce qu’il est à l’origine de certaines des inégalités dont nous avons parlé précédemment
(revenus en particulier). C’est aussi dans le travail que se noue une bonne partie des relations sociales qui entourent (et intègrent, cf.
chapitre suivant) l’individu. Pour toutes ces raisons, auxquelles il faut ajouter la valeur hautement symbolique du travail, les conflits
sociaux sont bien souvent nés dans le monde du travail depuis la naissance du capitalisme.
Nous allons d’abord nous demander comment, concrètement, les conflits sociaux se développent à partir de la question du travail
(1.1.). À travers l’étude de la classe ouvrière, nous verrons comment les conflits engendrent des classes sociales, c’est-à-dire comment
le conflit agit sur la structure de la société. Nous nous demanderons ensuite quel a été l'effet des transformations du monde du travail
(et notamment de la disparition de la classe ouvrière) sur les conflits (1.2.). Enfin, nous aborderons l'exemple des syndicats et nous
verrons le rôle complexe qu’ils jouent dans la gestion des conflits sociaux (1.3.).
1.1. Des conflits du travail aux conflits sociaux
C’est la première question qu’il faut se poser : pourquoi le travail est-il une source de conflit social ? En premier lieu, bien
évidemment, parce qu'il est source d'inégalités (1.1.1.) ; mais également parce qu'il est source d'une « identité professionnelle » (1.1.2.) ;
et enfin parce qu'il entraîne une « capacité de mobilisation » (1.1.3.).
1.1.1. Les inégalités du monde du travail peuvent déboucher sur des conflits
Les sociétés modernes, et a fortiori les entreprises, sont traversées par des inégalités nombreuses qui, même si elles tendent à se
réduire sur le long terme, restent encore très importantes. Il y a là un premier motif de conflit dans le monde du travail.

Page 2 / 9
Les inégalités suscitent le conflit quand elles ne sont pas acceptées, et donc lorsqu'elles sont considérées comme injustes. Elles
sont alors souvent l’enjeu des conflits sociaux : on se bat pour accroître la part des salaires dans la valeur ajoutée au détriment des
profits, ou pour améliorer sa rémunération par rapport aux autres métiers de l’entreprise.
Mais les inégalités ne suffisent pas à engendrer un conflit social, parce qu’elles peuvent susciter une compétition entre les
individus plutôt qu’entre les groupes. C’est une analyse somme toute assez classique et assez simple. Pour améliorer sa situation, un
individu a plusieurs solutions, que le sociologue américain Albert Hirschman (1970) a appelées « exit », « voice » et « loyalty ». Il peut
tout d'abord être loyal, et attendre en retour une amélioration de ses conditions (notamment une promotion au sein de l'entreprise) : il
va alors jouer le jeu de l'entreprise, et cherchera à être meilleur que ses collègues pour monter dans la hiérarchie (concurrence entre
individus). Il peut également partir (solution exit, ou « défection »), c'est-à-dire chercher un emploi ailleurs. Lorsque ces deux
solutions ne fonctionnent pas, parce que l'entreprise ne permet pas la mobilité interne, et/ou que la situation de chômage empêche de
chercher un autre emploi, l'individu utilisera la « prise de parole » (voice) et entrera donc dans une situation de conflit.
La plus ou moins grande mobilité sociale entre les métiers joue donc sur la capacité de mobilisation. S’il existe une grande fluidité
entre les positions dans l’entreprise, si l’on peut facilement obtenir une promotion individuelle, alors un individu peut espérer
améliorer sa situation personnelle par son seul mérite, sans agir au profit de l’ensemble de son groupe social. Mais si la mobilité sociale
est faible, si les métiers restent fermés les uns aux autres, alors les revendications personnelles passeront d’autant plus par une
revendication collective. C’est en substance ce que l’on a vu sur la crise du système fordiste : les OS, de plus en plus qualifiés, se sont
révoltés collectivement contre une organisation du travail qui ne leur laissait entrevoir aucune possibilité de promotion, qui ne
témoignait guère de considération pour leurs mérites professionnels.
Vous voyez donc pourquoi les inégalités ne sont pas à elles seules la cause des conflits sociaux. Ce point-là est important, parce
qu’il permet de dissiper un préjugé un peu simpliste qui associe les gros conflits aux grosses injustices. Or, ce n’est pas toujours là où il
y a les plus fortes inégalités qu’il y a les conflits les plus durs. Par exemple, il y a plusieurs millions de mal logés en France mais on ne les
voit jamais protester.
1.1.2. Mais le conflit ne naît qu'avec la « conscience collective », s'il émerge une « identité professionnelle »
qui crée un groupe par l'opposition aux autres groupes
Ce sont les sociologues de la tradition marxiste qui ont le plus travaillé sur cette question : comment naît un groupe capable de
mener un conflit social ? En effet, il ne suffit d'avoir la même « position » au sein de la société pour former un groupe capable de mener
une lutte sociale. Karl Marx (Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, 1852) montrait déjà que l'organisation matérielle de la
production avait une grande importance : si les individus sont dispersés et travaillent séparément, sans se rencontrer, il leur sera très
difficile de se coordonner pour agir. Les paysans français du XIXè étaient ainsi trop dispersés géographiquement pour agir, bien qu’ils
aient eu matière à se révolter. Karl Marx les compare à un sac de pommes de terre : « ainsi, la grande masse de la nation française [les
paysans] est constituée par une simple addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes
de terres forme un sac de pommes de terres ». Inversement, le regroupement des ouvriers dans les ateliers puis dans les grandes
usines, où l’on travaille ensemble, fait la pause ensemble, mange ensemble, où l’on se rencontre en allant au travail et en repartant chez
soi, a incontestablement favorisé l’organisation de la classe ouvrière. Pour Alain Touraine (La Conscience ouvrière, 1966), trois
principes sont nécessaires pour que se forme un groupe capable de conflit social : le principe d'identité, le principe d'opposition et le
principe de totalité.
La spécialisation des travailleurs dans la réalisation d'une tâche particulière (maçons, boulangers, etc.) entraîne leur
différenciation et donc l’émergence « d’identités professionnelles » distinctes. Construire son identité professionnelle, c’est
revendiquer certaines appartenances, se reconnaître une certaine position dans le groupe et dans sa hiérarchie, se sentir différent
d’autres individus (n’appartenant pas au groupe, en général). L’identité professionnelle, c’est aussi les valeurs partagées au sein du
collectif de travail, au sein d’un métier. Ces valeurs peuvent changer en fonction de ce que l’on fait dans l’entreprise (on peut penser à
la solidarité des mineurs face à la pénibilité et la dangerosité de leur métier), mais aussi en fonction de ce que l’on est (la féminisation
d’un métier peut en changer les valeurs). Ainsi, pour Touraine, le « principe d'identité » correspond au fait d'avoir conscience
d'appartenir à un groupe particulier.
Les identités professionnelles deviennent facilement concurrentes dans l’entreprise et dans la société. On veut dire par là que les
valeurs des groupes sociaux s’opposent sur toutes les questions qui concernent l’entreprise, et au-delà la société. Le premier point
d’opposition est bien sûr les inégalités de rémunérations. Chaque groupe a une idée différente de la valeur des métiers, et donc des
inégalités « justes » ou « injustes » – faut-il par exemple payer plus ceux qui fabriquent le produit ou ceux qui le commercialisent ?
Mais l’opposition s’étend aussi à la façon de gérer l’entreprise : on l’a vu dans le cas de la fermeture des usines « LU » dans le nord de la
France, où la logique entrepreneuriale de l’encadrement (recentrer l’activité du groupe sur les productions les plus rentables)
s’opposait à la logique des salariés (maintenir les sites aussi longtemps que possible pour sauvegarder les emplois). L’affirmation d’une
identité professionnelle fait donc non seulement apparaître un groupe social, mais elle lui donne aussi un adversaire. C'est ce qu'Alain
Touraine nomme le « principe d'opposition ».
Pour beaucoup de sociologues, identité et opposition suffisent à expliquer le conflit. Cependant, dans l'optique marxiste, le conflit
prend une dimension supérieure dans la mesure où il vise à la transformation complète de la société : identité et opposition ne suffisent
pas à ce qu'existe une « classe sociale ». Alain Touraine mentionne en effet ici le « principe de totalité », c'est-à-dire le fait pour le
groupe de considérer que son opposition concerne la société dans son ensemble ; le fait donc, de lutter non pour quelques menus
avantages, mais pour le contrôle de « l'historicité », c'est-à-dire de l'évolution historique de la société. C'est à ce prix qu'une « classe en
soi » (les pommes de terre) deviennent une « classe pour soi », par l'acquisition d'une « conscience de classe ».
1.1.3. Dans l'optique marxiste, les conflits du travail finissent par déborder de ce cadre pour concerner
l'ensemble de la société
L’opposition entre ouvriers et bourgeois a pris une valeur politique. Au début du XXè siècle, le clivage entre la gauche et la
droite s’est progressivement confondu avec le clivage entre travailleurs et capitalistes. Au fur et à mesure que les ouvriers devenaient
numériquement plus importants (au détriment notamment des agriculteurs, qui avaient une toute autre vision du monde), le conflit
politique s’est cristallisé sur la question de la propriété : la gauche représentait les salariés et voulait « nationaliser » le capital, c’est-à-
dire exproprier les capitalistes pour qu’ils ne contrôlent plus les entreprises, et donc pour résoudre le conflit social par la disparition
d’un des adversaires. Symétriquement, la droite défendait le droit de propriété comme principe, et donc le pouvoir des actionnaires
dans l’entreprise. Moins radicalement, l’enjeu politique entre la droite et la gauche était aussi l’adoption de lois et de règlements qui
limitaient le pouvoir des employeurs sur les salariés (Semaine de 40h, Congés payés, Droit du travail, protection contre les
licenciements, mais aussi indemnisation du chômage).
L’opposition entre ouvriers et bourgeois a pris une valeur culturelle. Chaque groupe a affirmé ses valeurs, et son mode de
vie. La « culture ouvrière » était nourrie de la fierté du métier : essentiellement masculin, le travail ouvrier supposait souvent la force
physique, des connaissances et astuces, essentiellement pratiques, qui se transmettaient au sein de l’atelier. La « culture bourgeoise »
était ce qu’on appellerait aujourd’hui la culture savante, celle qu’on transmet à l’école et à l’université (littérature, musique classique,
sciences, beaux-arts). Les loisirs des deux groupes n’étaient pas non plus les mêmes, d’ailleurs l’obtention d’un droit aux congés payés
en 1936 avait une valeur conflictuelle symbolique : jusque-là les vacances étaient l’apanage de la bourgeoisie.
L’opposition entre ouvriers et bourgeois a engendré une véritable ségrégation sociale. Elle était visible dans la structure des
villes, où les « quartiers ouvriers » – généralement les banlieues ou la périphérie des villes – s’opposaient aux « beaux quartiers », le
centre-ville. Mais on la retrouvait aussi à l’école, puisque les enfants des classes populaires et supérieures ne fréquentaient pas les
mêmes cursus scolaires. Il a fallu attendre 1975 et la création du collège unique pour que tous les écoliers suivent la même scolarité
obligatoire.
On voit donc que le conflit social, initialement circonscrit à l’entreprise, s’est étendu à toute la société, ce qui justifie que l’on parle
de classes sociales plutôt que de groupes sociaux, puisque les groupes ne rassemblent plus seulement, par exemple, les ouvriers d’une
entreprise, mais tous les ouvriers de la société. De même, le conflit social devient un véritable mouvement social et mérite l’appellation
de « lutte des classes » parce qu’il prend une valeur générale.
1.1.4.L'analyse du conflit social peut alors être menée en termes de lutte des classes
Pour une analyse de la pensée de Karl Marx : théorie de l'exploitation, constitution des classes sociales, rendez-vous sur
www.brises.org : Ch4, Partie 1, 1.1.4.
1.2. De la « fin de la classe ouvrière » à la fin des conflits du travail ?
Nous avons vu comment l'organisation du travail pouvait engendrer des conflits sociaux ; et comment ces conflits sociaux
pouvaient « sortir » de l'entreprise pour structurer les conflits au sein de la société : l'existence d'une classe ouvrière, définie par une
même position dans le processus de production, par la création d'une identité commune, d'une culture commune (la « culture
ouvrière ») et donc d'une « conscience de classe » (classe pour soi), a engendré une « lutte des classes ».
Cependant, nous montrerons que les mutations du travail et de la société depuis la fin des « Trente glorieuses » (selon
l'expression de Jean Fourastié) ont à la fois réduit le poids des ouvriers, limité l'identité et la culture ouvrières et réduit leur capacité de
mobilisation : certains sociologues ont ainsi parlé de « la fin de la classe ouvrières » (1.2.1.). Cependant, nous montrerons que, comme
le montrent d'autres sociologues, cela n'implique pas la fin des conflits du travail (1.2.2.).

Page 3 / 9
1.2.1. Les mutations du travail ont réduit le poids des ouvriers, brouillé leur identité professionnelle et
diminué leur capacité de mobilisation : les théories de « la fin de la classe ouvrière »
Les transformations du travail et les mutations de la classe ouvrière remettent-elles en cause la division de la société française en
classes sociales antagonistes ? C’est ce que pensent certains sociologues, et nous allons présenter leurs principaux arguments.
En premier lieu, la part des ouvriers dans la population active a diminué. Le recensement de mars 1999 en France met en
évidence la poursuite du mouvement amorcé dès le milieu des années 1970 : les ouvriers étaient encore plus de 7 millions en 1982, ils
étaient 6.5 millions environ en 1990 et 5.9 millions seulement en 1999. Cela représente une diminution de plus de 15% des effectifs
ouvriers entre 1982 et 1999, alors que, dans le même temps, la population active occupée augmentait. Résultat : la part de la PCS
« ouvriers » dans la population active occupée a encore plus nettement diminué que ses effectifs : elle est passée de 32.8% de la
population active occupée en 1982 à 25.6% en 1999 (Insee, recensements de la population), soit une diminution de 22% environ.
Aujourd’hui, la part des ouvriers dans la population active est inférieure à celle des employés.
En second lieu, c'est la nature même du travail des ouvriers qui a changé : la première grande transformation est que les
ouvriers travaillent de plus en plus souvent dans le secteur des services, comme c'est le cas des chauffeurs routiers, par exemple. Ainsi,
en 2001, il y a plus d’ouvriers travaillant dans le tertiaire que d’ouvriers travaillant dans le secondaire (attention, si ce résultat vous
étonne parce que vous pensiez que les ouvriers travaillaient forcément dans le secteur secondaire, cela signifie qu’il faut que vous
revoyiez comment on répartit les actifs occupés dans les trois secteurs d’activité). Ces ouvriers sont en particulier des ouvriers
d’entretien et de maintenance. « La classe ouvrière est désormais disséminée dans les rouages de la société de services et non plus
soudée au cœur du système industriel » (E. Maurin, Sciences humaines n°136, mars 2003). Même dans le secteur secondaire, les
ouvriers font beaucoup moins souvent qu’avant des tâches de production au sens strict car celles-ci sont de plus en plus automatisées.
On a donc un développement des tâches de tri, d’emballage et de manutention en général d’un côté, et un développement des tâches
de surveillance, contrôle et réglage des machines automatisées d’un autre côté. La deuxième transformation touche la qualification des
ouvriers : la qualification personnelle des ouvriers s’est plutôt élevée (il y a davantage de diplômes professionnels) mais ils exercent
souvent un emploi dont la qualification est inférieure à celle qu’ils possèdent (31% des salariés embauchés pour un emploi ne
nécessitant pas officiellement de qualification sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP). Le nombre des emplois d’ouvriers non qualifiés
avait beaucoup diminué entre 1982 et 1994 mais il a réaugmenté entre 1994 et 2001. Au total, la part des emplois d’ouvriers qualifiés
dans l’ensemble des emplois ouvriers progresse cependant.
En troisième lieu, la taille des entreprises et du collectif de travail a diminué : parce que la nature du travail a changé, la taille
des entreprises dans lesquelles travaillent les ouvriers a beaucoup diminué. Cela s’explique d’une part par l’automatisation des tâches
de production proprement dites (certaines usines sont aujourd’hui quasi « désertes »), d’autre part par le fait que les ouvriers
travaillent de plus en plus souvent dans des entreprises du tertiaire qui sont traditionnellement, en moyenne, de taille inférieure à celle
des entreprises industrielles. Le cadre de travail des ouvriers a donc été bouleversé : les grands rassemblements ouvriers à l’ouverture
des grilles de l’usine ne font bien souvent plus partie de l’expérience vécue par les ouvriers. Mais le fait que la taille de l’entreprise
diminue ne signifie pas que les ouvriers seront plus proches du patron : en règle générale, ces petites entreprises appartiennent à de
grands groupes industriels et financiers et le pouvoir est en général bien loin du lieu de production.
En quatrième lieu, les transformations récentes du travail et de l’emploi agissent aussi sur l’identité professionnelle
(précarisation du travail, suppression de certains emplois non qualifiés, par exemple d’ouvriers, individualisation de la carrière des
salariés) : les frontières de l’emploi sont plus floues, les métiers se transforment, les horaires sont « à la carte », l’individu semble
triompher et les collectifs de travail semblent moins englobants, moins contraignants pour les individus, mais aussi moins protecteurs.
L’identité professionnelle semble donc moins « imposée » à l’individu qui doit bien davantage trouver ses repères seul pour la
construire. Dans ces conditions, on voit bien que la mobilisation en vue d’un conflit sera sans doute plus difficile à obtenir.
Enfin, la culture ouvrière recule avec la transformation du travail ouvrier. La précarisation du travail et l’expérience du
chômage (qui touche proportionnellement plus les ouvriers que les autres PCS) dévalorisent le travail ouvrier, tandis que le
changement de la nature du travail ouvrier (moins directement en contact avec la matière et la production) attaquent directement sa
spécificité. De même, les conditions de vie des ouvriers se sont transformées, semblant rejoindre celles d’une vaste « classe moyenne » :
d’une part, les revenus, et donc la consommation, se sont élevés rapidement durant les années 1960 et 1970, permettant aux ouvriers
d’accéder aux biens de consommation durables comme la télévision, la machine à laver ou l’automobile ; d’autre part, les modes de vie
des ménages ouvriers se sont également transformés par le développement du travail des femmes d’ouvriers, l’allongement de la durée
de scolarisation des enfants d’ouvriers et le développement de l’accession à la propriété grâce au crédit. Au final, les conditions de vie
semblent s’égaliser avec celles d’autres groupes sociaux et les éléments qui contribuent à forger et à transmettre la culture ouvrière
semblent peu à peu disparaître. Nous retrouvons bien ici toutes les idées de la théorie de la moyennisation de la société française.
1.2.2. Cependant, si l'influence politique et sociale des ouvriers est moins nette, les raisons du conflit avec
les classes supérieures restent fortes
Il faut nuancer le diagnostic d’une disparition de la classe ouvrière, parce qu’il ne s’agit pas d’une disparition des ouvriers, mais de
la perte de leur statut de classe sociale, c’est-à-dire de la capacité à transposer leur conflit à l’échelle de la société tout entière. De plus,
les sources du conflit social, les inégalités, la faible mobilité sociale, perdurent toujours et même parfois s’aggravent.
Le poids numérique des ouvriers dans la population française reste important malgré leur relatif déclin. Le groupe social des
ouvriers disparaîtrait, faute de combattants en quelque sorte ? Ce n’est pas si évident que cela. En effet, aujourd’hui, près d’un tiers des
pères de famille sont ouvriers et 40% des enfants sont élevés dans un ménage où un des deux adultes au moins est ouvrier. Ce sont des
proportions élevées qui montrent que la transmission de la culture ouvrière reste toujours possible, au moins en partie. D’autre part, il
semble bien que la diminution des effectifs ouvriers soit stoppée depuis deux ou trois ans.
La faible mobilité sociale enferme encore la classe ouvrière sur elle-même et la coupe des classes supérieures. Louis Chauvel a
montré à quel point depuis vingt ans, la mobilité sociale nette est faible : les chances de monter dans la hiérarchie sociale, si l’on enlève
les effets des transformations de l’emploi, sont très faibles, et cela malgré la scolarisation allongée des enfants, ceux des ouvriers en
particulier. Aujourd’hui, on observe de plus en plus fréquemment des enfants qui ont fait des études bien plus longues que celles de
leurs parents et qui, pourtant, intègrent le marché du travail, d’une part bien plus difficilement, d’autre part à un niveau équivalent,
voire moins élevé. Résultat de cette faible mobilité ascendante : l’écart social entre les groupes sociaux a recommencé à s’accroître. Et
ce d’autant plus que, on l’a vu dans le chapitre précédent, l’accès à l’enseignement supérieur est encore très inégal selon l’origine
sociale, au détriment des enfants d’ouvriers.
Enfin, les inégalités, y compris matérielles, demeurent importantes. Certes, les ouvriers ont accédé dans leur majorité à la
consommation de masse, mais la distinction se porte sur de nouveaux biens et surtout sur les services : les taux de départ en vacances
restent très inégaux (et il ne s’agit pas des mêmes vacances quand il y a départ), l’accès à Internet reste socialement très inégalement
réparti, les cadres ont largement développé leurs consommation de services à domicile (femmes de ménage, garde d’enfants), l’habitat
reste spatialement très différencié, etc.
Conclusion : les ouvriers constituent plus certainement un groupe social qu'une classe sociale au sens marxiste du terme ; mais
cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être à l'origine de conflits sociaux. Cela ne signifie pas non plus que la situation de tous s'est
améliorée au point qu'il n'existerait plus de conflits autour du travail : c'est une problématique que nous étudierons dans la deuxième
grande partie.
1.3. Le rôle des syndicats dans les conflits sociaux
Cette dernière sous-partie vise à exemplifier cette histoire des conflits ouvriers par un de ses aspects les plus marquants : la grève
et le syndicalisme. En effet, nous verrons que, parallèlement à la « fin de la classe ouvrière », on a assisté à un large mouvement de
désyndicalisation, que d'aucuns nomment « crise du syndicalisme ». Nous commencerons cette sous-partie par un aperçu historique
du développement des syndicats (1.3.1.) ; puis nous montrerons comment ils ont participé à l'émergence puis à l'institutionnalisation
des conflits (1.3.2.) ; nous verrons en quoi les transformations du travail ont affecté les syndicats et peuvent expliquer leur crise
(1.3.3.) ; nous verrons également que la montée de l'individualisme est l'un des facteurs explicatifs (1.3.4.) ; enfin, nous discuterons des
problèmes que cela pose (1.3.5.).
1.3.1. Le développement historique des syndicats
•Les débuts de l’industrialisation
Pendant cette période, le pouvoir appartient clairement aux patrons, les travailleurs n’ont à peu près aucun droit, sauf celui de
travailler. La grève est en général interdite : en France, elle est considérée comme un délit jusqu’en 1864. Cela signifie que jusqu’à cette
date, c’est la force publique (l’armée en général) qui intervient pour empêcher les grèves et que les grévistes sont condamnés par les
tribunaux. La loi Le Chapelier (1791) que les révolutionnaires avaient votée pour interdire les « corporations », pour laisser libre accès
au marché du travail, implique que les syndicats (qui sont un regroupement d'ouvriers) sont interdits. Les conflits du travail qui
éclatent sont donc, la plupart du temps extrêmement violents et sauvagement réprimés. Ce n’est qu’à la fin du XIXè siècle, 1884 en
France, que les syndicats sont autorisés, c’est-à-dire que les travailleurs ont le droit de se réunir en un acteur collectif pour tenter de
défendre leurs intérêts.
•La première moitié du 20è siècle
À cette période, les syndicats se construisent petit à petit et acquièrent peu à peu une certaine légitimité, tant auprès des travailleurs
qu’auprès des patrons. Le premier rôle des syndicats sera d’endiguer la violence des conflits et de diminuer les risques individuels
encourus par les grévistes en se faisant leur porte-parole. La légitimité des syndicats éclatera aux yeux de tous en 1936 (en France) : ce

Page 4 / 9
sont les syndicats qui négocient les accords Matignon avec les patrons et l’Etat, après un mouvement de grève généralisé qu’ils ont
orchestré. Parallèlement, le droit du travail se construit, essentiellement sur le plan de la protection physique des salariés pendant leurs
heures de travail.
•La période fordiste (1945-1975)
Dans un pays comme la France, cette période est marquée par le triomphe des syndicats : on observe leur institutionnalisation, c’est-à-
dire qu’ils deviennent les partenaires obligés de toutes les négociations, ils participent directement à la gestion des conflits, mais aussi à
la gestion des institutions mises en place pour protéger ou défendre les travailleurs (protection sociale et tribunal des Prud'hommes).
Les conflits eux-mêmes s’institutionnalisent, c’est-à-dire qu’ils suivent tout un rituel (préavis de grève, premières négociations, échec
de ces négociations, grève effective, négociations à nouveau) dans lequel les syndicats jouent un rôle de premier plan. Le conflit se
marque essentiellement par des grèves auxquelles les syndicats appellent et qu’ils dirigent, y compris jusqu’à l’appel à la reprise du
travail. Au début des années 1970, certains en viennent, pour parler des syndicats, à employer des expressions du genre « forteresse
syndicale » ou « État dans l'État » et ceux-ci sont des piliers de la régulation sociale. Il faut rappeler aussi que les syndicats ont obtenu
le droit de co-gérer la protection sociale, la Sécurité Sociale étant l’objet d’une gestion tripartite Etat – patronat – syndicats
représentatifs.
Vous avez l’habitude d’associer les syndicats aux conflits sociaux, et même de les considérer, sinon comme la cause, du moins
comme des acteurs essentiels des conflits. Ils sont effectivement souvent à l’origine des grèves, des manifestations, et, par les
revendications qu’ils expriment, ils peuvent entretenir la tension sociale. Mais cette vision des choses ne recouvre qu’une partie de la
réalité, car les syndicats jouent en fait un rôle bien plus complexe, et, paradoxalement, permettent aussi de réduire la conflictualité
dans les entreprises. Cela amène à s’interroger sur les conséquences de la désyndicalisation que l’on constate dans les sociétés
modernes : cela va-t-il accroître ou diminuer la conflictualité dans la société ?
1.3.2. Si les syndicats ont favorisé l'émergence de conflits sociaux par leur capacité d'organisation, ils ont
également permis de les régler plus facilement par l'institutionnalisation (des conflits et des organisations)
Voyons concrètement comment le développement des syndicats peut permettre le développement des conflits sociaux dans les
entreprises, et plus généralement au niveau de la société tout entière.
Les syndicats rassemblent les moyens matériels et humains de l’action collective. L’action collective coûte cher, et les syndicats
sont d’abord un moyen de la financer. Ils collectent des cotisations, reçoivent parfois des dons ou des subventions publiques, qui
permettent de faire face aux dépenses nécessaires à la mobilisation des salariés (presse syndicale, tracts, locaux et moyens de
communication, transports des militants, caisse de solidarité pour compenser les pertes de salaires en cas de grève). Mais ces moyens
permettent surtout de payer des permanents, c’est-à-dire des personnes qui travaillent à temps plein pour le syndicat, assurent des
permanences pour informer ou aider les salariés, gèrent les aspects matériels de la vie syndicale, négocient avec les employeurs. Les
permanents et plus généralement les militants syndicaux assurent la coordination et donc l’efficacité de la revendication. En effet, si on
veut par exemple lancer une grève pour faire pression sur l’employeur, il vaut mieux que tout le monde cessent le travail en même
temps pour que la démonstration de force soit plus convaincante : c'est le rôle des syndicalistes de coordonner les actions individuelles
de revendication. Et si on veut que la grève soit un succès, il faut aussi informer les salariés à l’avance et essayer de les convaincre de
participer, et là encore, les syndicats fournissent un travail essentiel pour le développement de mouvements sociaux.
Les syndicats sont un cadre institutionnel qui permet de faire émerger des décisions collectives et de mener des négociations pour
sortir des conflits. Enfin, pour mener une action collective, il faut s’entendre sur les buts de l’action (que réclame-t-on ?), sur les
moyens à mettre en œuvre (grève, ponctuelle ou générale, manifestation, pétition). Pour prendre de telles décisions, il faut un cadre
institutionnel démocratique précis qui offre aux individus les moyens de s’exprimer, de désigner des représentants, et pour ces
représentants, il faut des instances de réunion et de décision pour aboutir à des choix collectifs représentatifs de ce que souhaitent les
adhérents. Pour mettre un terme au conflit, il faut pouvoir discuter avec un « interlocuteur » représentatif, ne serait-ce que pour savoir
quelles sont les revendications de ceux qui protestent. Il faut aussi pouvoir discuter pour chercher d’éventuelles solutions de
compromis, ou de conciliation des points de vue. Les syndicats sont aussi nécessaires pour organiser une négociation permanente qui
prévienne les conflits. Avant de prendre une décision, la consultation des syndicats permet de repérer ce qui peut éventuellement
poser problème et susciter le conflit. On peut alors négocier les solutions a priori, et ainsi faire l’économie d’une grève, par exemple.
Les syndicats permettent de maintenir le conflit social dans des formes socialement acceptables. Dès lors que l’on rentre dans un
conflit social, la question des méthodes de revendications se pose. Elle est importante parce que des « dérapages » sont toujours
préjudiciables à la cause que l’on défend. Si, par exemple, lors d’une manifestation, des violences ou des dégradations sont commises
par les manifestants, ils auront plus de mal à rallier l’opinion publique. Les syndicats font ainsi fonction de « service d’ordre », pour
maintenir la revendication dans certaines limites.
Les conflits antérieurs et les négociations successives ont amené les employeurs et les syndicats, et souvent l'État, à s’entendre
pour édicter des règles qui régissent les situations de conflits potentiels. Ainsi, le droit du travail encadre les licenciements, en
précisant quand un employeur peut licencier et quelles compensations il doit éventuellement apporter. Cela permet d’éviter d’une part
une utilisation arbitraire, voire répressive, du licenciement, mais aussi de le rendre moins contestable par les salariés. De même, les
« grilles de rémunération », qui prévoient quels salaires peuvent être versés en fonction du métier ou de l’ancienneté, permettent
d’éviter que les promotions soient un sujet de conflit entre l’employeur et les salariés. L’émergence d’un droit du travail a aussi comme
conséquence de faire rentrer le juge dans l’entreprise. Le recours à la justice est en effet un moyen de faire arbitrer les litiges par les
tribunaux sans passer par le conflit social. De ce point de vue, les entreprises ressemblent de plus en plus à la société, qui se civilise en
remettant la charge de la résolution des conflits à une institution judiciaire indépendante.
L’existence de syndicats facilite donc grandement l’action collective. En ce sens, le syndicalisme peut être considéré comme un
facteur de conflictualité sociale. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que les grèves en France sont plus importantes dans le
secteur public que dans le secteur privé : les syndicats y sont encore relativement puissants et bien implantés. C'est pour cela aussi que
les chefs d'entreprise sont souvent réticents face à l'implantation de syndicats.
Le paradoxe n’est qu’apparent : les syndicats augmentent l’efficacité de la mobilisation collective et donc favorisent les conflits
sociaux, mais en même temps, ils permettent de « piloter » ces conflits et donc de les rendre moins radicaux et de leur trouver une
conclusion. Le syndicalisme rend en quelque sorte les conflits sociaux plus efficaces, mais plus raisonnables.
1.3.3. Mais, d'une part, les mutations du travail affaiblissent dans une certaine mesure les syndicats
Ce phénomène de la désyndicalisation est important à analyser, parce qu’il permet de comprendre pourquoi il est nécessaire que
les groupes sociaux soient organisés. Cela permet aussi de comprendre que la « mécanique » du conflit social est parfois aussi
essentielle que le fond de la discorde. Nous verrons dans un premier temps la réalité de la désyndicalisation, puis quelques éléments
d’explication et enfin les conséquences sur les conflits sociaux.
Document 1 : les raisons du déclin de la théorie du conflit de classes
L'effondrement du bloc soviétique a disqualifié tant les réalisations pratiques que le prestige intellectuel qui pouvaient s'associer
à l'idée d'un système politique alternatif issu du conflit de classes vu par Marx.
Le monde ouvrier qui constituait une classe pivot dans ces visions du conflit social subit une crise multiforme. Elle tient à la
baisse de ses effectifs, au glissement vers le tiers monde d'une part des emplois ouvriers. Elle est liée au naufrage du communisme
comme promesse d'un monde meilleur porté par ce groupe. Elle doit aussi à la dégradation fréquente des conditions de vie des
ouvriers (chômage, précarité, recul de la puissance syndicale). Mais la véritable humiliation que subit le monde ouvrier est aussi
symbolique. Aux images valorisantes du producteur, du militant (syndical ou politique), d'hommes et de femmes assumant avec
dignité des tâches souvent difficiles, se substituent une série de représentations souvent méprisantes. Le monde ouvrier et populaire
devient mis en scène comme celui des « beaufs », des Bidochons, de la famille Groseille dans La Vie est un long fleuve tranquille.
C'est une identité collective qui se défait ainsi.
Même si de grosses différences existent en leur sein entre un instituteur, un informaticien et un cadre des assurances, la montée
des classes moyennes et professions « intermédiaires », désormais majoritaires, a contribué à estomper le sentiment des différences
sociales, de leur pertinence pour comprendre la société.
L'évolution des inégalités en matière de revenus, d'insertion, d'accès à l'emploi stimule des réactions de protestation de groupes
qui se sentent exclus. Ces protestations mettent en avant des identités religieuses, ethniques, « communautaires » où les oppositions
de classes sociales semblent devenir secondaires.
Enfin, de nouvelles réalités et de nouvelles croyances convergent pour renvoyer au second plan une vision de la société fracturée
par le conflit de classes. La mondialisation invite à penser en termes d'espace plus que de groupes. Elle alimente aussi depuis le 11
septembre le fantasme d'un « choc des civilisations » comme base de conflit. Elle suggère encore une opposition à des pays lointains
où une main-d'œuvre peu coûteuse menacerait « nos » emplois. Le thème de la société de communication fait, lui, du conflit une
anomalie, un échec par rapport à un modèle théorique de relations sociales reposant sur l'écoute et l'explication. La vision simpliste
d'une société faite d'exclus et d'inclus contribue de son côté à ramener la perception de nombre de mouvements sociaux à une
crispation de corporatismes, publics ou privés, à une défense égoïste « d'avantages acquis ».
Erik NEVEU, « Conflits sociaux et action collective », Nouveau manuel, La Découverte, 2003.

Page 5 / 9
La désyndicalisation est un phénomène général dans les pays industrialisés.
Le nombre de conflits, mesuré par le nombre de journées de travail perdues du
fait des grèves, a considérablement diminué en France depuis 20 ans : entre 3 et 4
millions de journées perdues par an pour fait de grève à la fin des années 1970,
moins d’un million en général depuis 1985. Cette diminution peut étonner : on a
parfois l’impression, à tort, que les grèves sont plus nombreuses que jamais. En
fait, elles ont beaucoup plus
diminué dans le secteur
privé que dans le secteur
public, où les grèves « se
voient » plus car elles
touchent souvent des
services publics. Mais le
secteur public emploie
moins de travailleurs que le
secteur privé. Le taux de
syndicalisation (part des
syndiqués dans la
population active occupée) a beaucoup décru depuis trente ans. Aujourd’hui, en
France, on estime que 8% environ des travailleurs sont syndiqués (près de 40%
l’étaient en 1950). Le taux de syndicalisation reste bien plus élevé dans le secteur
public que dans le secteur privé (où il est d'environ 3.5%), dans les grandes
entreprises que dans les petites, même s’il a diminué partout. La diminution de
l’influence des syndicats se voit aussi au fait que certains conflits, parmi les plus
durs de ces dernières années, démarrent en dehors des syndicats, comme nous le
verrons plus loin.
Premier élément d’explication de la désyndicalisation : la montée du
chômage. C’est une explication conjoncturelle : la montée du chômage peut
expliquer que les salariés, craignant pour leur emploi, renoncent à se mettre en
grève ou à entamer un conflit avec leur employeur. Dans ce cas, on peut penser
que si la croissance repartait et si le chômage diminuait sensiblement et
durablement, le nombre des conflits pourrait repartir à la hausse.
Deuxième élément d’explication de la désyndicalisation : les transformations
du travail. Il s’agit cette fois d’une explication structurelle à la désyndicalisation.
La transformation de la
structure des emplois joue
en défaveur de la syndicalisation. En effet, le nombre d’emplois ouvriers, et plus
généralement dans les industries, a considérablement diminué depuis 1975,
comme nous l’avons vu. Or, le syndicalisme a une bonne part de ses racines
dans le mouvement ouvrier. De plus, le travail dans les usines s’est transformé,
les horaires se sont flexibilisés, et les syndicats ont plus de mal à entrer en
contact avec l’ensemble des salariés. L’éclatement du collectif de travail fait que
tous les gens qui travaillent au même endroit n’ont pas forcément le même
employeur (c’est le cas quand il y a des travailleurs intérimaires) ce qui rend
plus difficile la mobilisation. Et le développement des firmes multinationales,
qui éloigne encore les travailleurs de la direction réelle de l’entreprise, rend plus
difficile l’identification et l’atteinte du groupe avec lequel on peut rentrer en
conflit. Enfin, les emplois du tertiaire, qui se sont beaucoup développés, sont
situés dans des entreprises de taille inférieure à celle des entreprises
industrielles. Or le syndicalisme se développe plus facilement dans les grandes
entreprises que dans les petites. Et la féminisation qui a accompagné cette tertiairisation joue aussi en défaveur des syndicats car les
femmes sont, en moyenne, moins syndiquées que les hommes.
Troisième élément d’explication : l’institutionnalisation des syndicats. Ce qu’on appelle l’institutionnalisation, c’est le fait que les
syndicats sont reconnus par les employeurs comme des interlocuteurs légitimes et incontournables. C’est aussi le fait que le nombre de
permanents, c’est-à-dire de personnes qui travaillent à plein temps pour le syndicat, augmente. Cette évolution peut couper les
syndicats de leurs adhérents. Ceux-ci ne se sentent plus représentés réellement par les permanents syndicaux qui négocient avec les
organisations patronales. Les syndicats apparaissent alors comme des organisations bureaucratiques dans lesquelles les adhérents ne se
reconnaissent plus, d’où la diminution du nombre d’adhésions. Il en résulte que les syndicats encadrent moins qu’avant les conflits. Ce
ne sont pas toujours eux qui appellent à la grève (certains conflits se déclenchent « à la base », sans appel des syndicats). Leur place est
prise par des « coordinations ». De quoi s’agit-il ? Les grévistes élisent des représentants, indépendamment de leur appartenance
syndicale, qui vont aller négocier avec la direction (alors que c’est le rôle traditionnellement dévolu aux syndicats) et qui viennent
rendre compte devant la « base » de l’évolution des négociations. Dans le courant des années 90, on a vu par exemple le conflit des
infirmières ou celui des chauffeurs routiers être géré de la sorte. On peut lire ici une méfiance vis-à-vis des syndicats, considérés
comme des institutions coupées de la base des travailleurs.
1.3.4. Et, d'autre part, la montée de l'individualisme, par certains aspects, remet en cause l'action collective
Pour expliquer pourquoi un conflit social éclate ou pas, on peut d’abord se demander ce que les individus ont à y gagner. On
pourrait de prime abord penser qu’ils ont forcément intérêt à participer au conflit puisqu’ils pourront de cette façon défendre ou
améliorer leur situation. Mais l’analyse se complique dès lors qu’on intègre les coûts que représente un conflit social pour les
individus : par exemple, les journées de salaires perdues lors d’une grève, le fait que l’employeur donnera sans doute moins de
promotion à un salarié peu accommodant, etc. Cela permet de comprendre les aléas de la mobilisation sociale.
Les individus se comportent en « passagers
clandestins » et renoncent au conflit social. Si les gains
tirés d’un conflit (par exemple, une hausse des salaires)
concernent tous les salariés, les coûts de l’action ne
reposent que sur ceux qui l’auront entreprise (les
grévistes). Dès lors, il est rationnel pour un individu de ne
pas participer au conflit, même s’il a intérêt à ce que celui-
ci réussisse. En effet, s’il s’abstient d’y participer, il évite le
coût lié au conflit mais en retire les bénéfices quand les
autres auront fait aboutir la revendication. Mais comme
tout le monde fait le même calcul, personne ne s’engagera
dans le conflit parce que chacun espérera profiter de
l’action des autres. Dans ce cas, il y a bien peu de chances
qu’un conflit social éclate.
Mais alors, pourquoi y a-t-il quand même des
conflits ? Pour rester dans la même grille d’analyse, si des
individus participent à un conflit, c’est qu’ils tirent un
avantage direct de cette participation, indépendamment
du résultat du conflit. Il peut s’agir bien sûr d’avantages
symboliques (notoriété, reconnaissance des autres,
amélioration de l’estime de soi, nouvelles solidarités).
Ainsi, par exemple, les mouvements qui se rattachent à la
mouvance altermondialiste tissent-ils très souvent des
réseaux d’échanges personnels (produits bio, échanges de
services, formations réciproques), intéressants à la fois sur
le plan matériel et sur le plan des relations sociales.
Document 2 : taux de syndicalisation en
France depuis la Libération
Le taux de syndicalisation rapporte les effectifs des
confédérations, connus ou estimés, à la population
active salariée.
Source : Dominique Andolfatto, Dominique Labbé,
Sociologie des syndicats, La Découverte, 2000, in
Nouveau Manuel, La Découverte.
Document 4 : conflits du travail (1952–2000)
a. Hors fonction publique (conflits généralisés et
localisés).
Source : ministère du Travail et des Affaires sociales –
DARES, in Nouveau Manuel, La Découverte.
Document 5 : le paradoxe d'Olson
Il est faux [de croire que le conflit apparaît quand les individus sont
dans une situation inégalitaire]. C'est faux [...] parce que même le
sentiment très vif qu'il faut se mobiliser contre une situation peut
déboucher sur son contraire. C'est là le paradoxe développé par
l'économiste américain Mancur Olson. Imaginons que cent habitants
d'un petit village soit excédés par les impôts locaux fixés par le nouveau
maire. Ils se réunissent et décident d'agir. Supposons que si chacun d'eux
est prêt à donner du temps (réunions, manifestations) et de l'argent pour
le fonctionnement d'une association de défense et l'édition de tracts, un
investissement équivalent à 40€ chacun rend à peu près certain le recul
du maire et une réduction d'impôt de 100€. L'action collective est donc
assurée de rapporter (100-40) = 60€ à chaque protestataire. Oui. Ou
plutôt non, car il y a plus rentable : la posture du « passager clandestin »
qui regarde les autres agir et faire baisser l'impôt. Et qui récupère ainsi le
gain de 100€ sans le déduire du moindre coût de mobilisation. Égoïste,
mais rentable. Oui. Ou peut-être non, car lorsque les passagers
clandestins sont les plus nombreux la mobilisation est inexistante ou
inefficace. Olson souligne qu'on peut limiter le nombre des passagers
clandestins, soit par la pression (aller intimider les « lâcheurs »), soit par
l'incitation (avantages individuels comme des conseils fiscaux ou des
« pots » gratuits aux participants à l'action). Olson a l'immense mérite de
souligner que l'action collective ne va jamais de soi. Fondé sur le calcul
économique, son modèle fait aussi l'économie de beaucoup de questions
comme les sentiments de solidarité, le fait que le souci de dignité ou
l'euphorie de la mobilisation puissent conduire à des comportements
non calculateurs.
Erik NEVEU, « Conflits sociaux et action collective », Nouveau manuel, La
Découverte, 2003.
Document 3 : taux de syndicalisation (%)
Source : BIT.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%