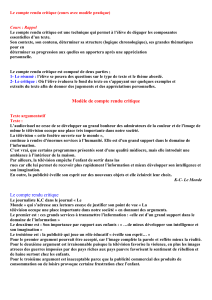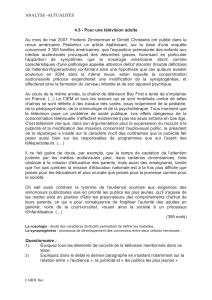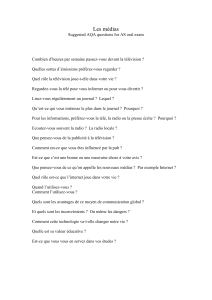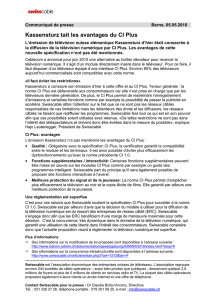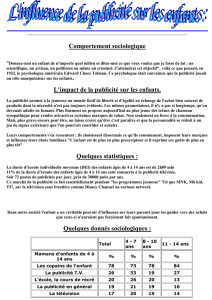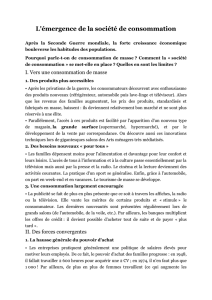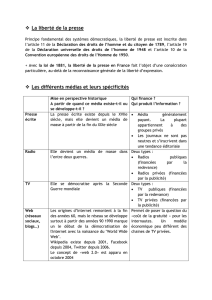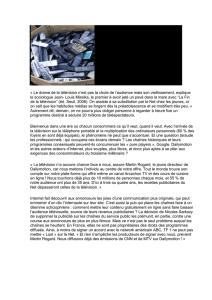1 Daniel Süss Médias et société globalisée La société

1
Daniel Süss
Médias et société globalisée
La société des médias pose de nouveaux défis en matière de quête identitaire et
d'organisation de la communication. Va-t-on vers une société de solitaires reliés par un
réseau multimédia? Voici un survol de l'état de la recherche de la psychologie des médias.
Notre société des médias recèle-t-elle plus de chances ou plus de risques? Selon la
pondération appliquée, il est possible de distinguer deux groupes naturels.
Le premier peut être classé sous l'étiquette «pessimisme culturel». Ce groupe présente les
médias comme des drogues utilisées par les récepteurs pour fuir la dure réalité du monde. Les
médias sont rendus responsables des dérangements psychiques et des conflits ainsi que de la
société du plaisir dans laquelle tout est divertissement. Sous cet angle de vue, les médias sont
de prime abord une menace pour le développement d'une identité intégrée et pour la mise en
place d'une véritable communication. D'éminents représentants de cette conception sont Neil
Postman, Marie Winn ou Werner Glogauer.
Mais nous trouvons en même temps des auteurs qui considèrent les médias comme faisant
partie intégrante de la culture. Ils soulignent que les médias sont indissociables de la réalité
actuelle des individus et des communautés, que les mondes de vie sont aujourd’hui également
toujours des mondes de médias. L'utilisation des médias est érigée au rang de technique
culturelle: ce qui compte, c'est la compétence médiatique. Une fois cette perspective admise,
les médias apparaissent comme une composante importante de l'organisation créative de
projets identitaires dans le monde actuel. D'importants représentants de cette vision sont par
exemple Christian Doelker, Dieter Baacke et Ingrid Paus-Hasebrink.
Les constats de la recherche sur la réception et les effets des médias suggèrent que les deux
perspectives ont leurs arguments: les médias peuvent contrarier les développements
identitaires et la communication, mais ils peuvent aussi les enrichir. C'est en premier lieu la
manière d'utiliser les médias qui détermine la dynamique qui intervient avec le plus de
vigueur. (...)
Courte histoire des médias
Un regard en arrière nous permettra d'éclairer l'importance des médias pour la société au fil du
temps. Si nous considérons les grandes étapes de l'évolution de la communication, nous

2
pouvons, à l'instar de Werner Faulstich («Grundwissen Medien», 1994), structurer l'histoire
des médias en quatre grandes phases. Jusqu'en 1500, l'époque était dominée par la culture
orale des «médias humains», le langage de l'homme et ses possibilités d'expression non
verbale à l'aide du corps. Entre 1500 et 1900, les supports imprimés ont constamment gagné
en importance. Alors que l'imprimerie a d'abord été réservée à une petite élite, la presse est
vite devenue un média de masse. Le 20ème siècle a vu l'émergence croissante des médias
électroniques − la radio, la télévision, la vidéo et les ordinateurs sont entrés dans la vie
courante. L'époque plus récente est maintenant dominée par des médias de substitution:
d'anciens médias sont remplacés par des médias nouveaux ou mieux intégrés à un niveau
supérieur. Les ordinateurs et les téléviseurs convergent dans la télévision interactive qui, via
Internet, offre toutes les fonctions supplémentaires possibles. Une telle substitution est visible
à la gare principale de Zurich, depuis que des parois vidéo assument la fonction d'affiches
animées, donc assimilables aux spots publicitaires. Des personnes virtuelles se substituent aux
speaker-ine-s ou aux acteurs et actrices. Les simulations sur ordinateur fournissent des
interlocuteurs virtuels et des personnages d'identification. Mais même aujourd’hui, les vieux
médias ne disparaissent pas: les hommes continuent à s'entretenir intensément via les «médias
humains», la lecture et l'écriture sont toujours aussi prisées et les médias électroniques
conservent toute leur importance.
Le développement des médias a incité à désigner des générations entières en fonction de
certains médias de référence. L'idée à la base était que les types de média dominants avaient
marqué la perception de la vie d'une certaine époque. Les années trente et quarante ont produit
les générations radio et cinéma, les années cinquante et soixante la génération télévision et les
années huitante la génération Nintendo ou les computerkids. Pour ce qui est des jeunes des
années nonante à aujourd’hui, on parle de «génération virtuelle». Les concepts de génération
ne présentent aucune uniformité dans leur manière d'appréhender les personnes: s'agit-il des
personnes nées à une période donnée comme pour la génération télévision) ou de toutes les
cohortes d'âge d'une génération qui vivent en même temps à une certaine époque (comme
pour la «génération @»).
Perspectives de recherche
Ma question est la suivante: comment apprécier la valeur des médias pour le développement
identitaire, la communication et la construction de relations? La réponse à cette question peut
être obtenue à partir de deux perspectives. Premièrement, selon la perspective de la recherche
des effets, qui demande: «Qu'est-ce que les médias font des hommes?», et, deuxièmement,

3
selon la perspective de la recherche sur l'utilisation: «Que font les hommes avec les médias?»
Les chercheurs du courant culturel pessimiste privilégient le plus souvent la question des
effets, alors que les tenants de la perspective culturelle des médias examinent plutôt la
question de l'utilisation. Ces deux approches expriment également une conception différente
de l'homme. Dans la recherche des effets, on a longtemps considéré l'être humain comme une
victime passive des incidences des médias. On défendait un concept behavioriste qui voulait
mesurer l'interdépendance entre les incitations des médias et les réactions du public. Comme
la psychologie de l'apprentissage, l'étude des médias admettait également que l'homme n'est
pas seulement une machine de type stimulus-réponse, mais également un transformateur actif
d'informations, qui construit des significations. Le même message médiatique peut donc avoir
des effets totalement différents, selon les motivations et les circonstances situationnelles dans
lesquelles il est reçu. Les satisfactions espérées sont une dimension centrale lorsqu'il s'agit de
comprendre comment les hommes utilisent les médias. L'approche de recherche de
l'utilisation des médias de Karl E. Rosengren, «Uses and Gratifications», distingue les
domaines suivants de besoins pouvant être couverts par les médias: besoins cognitifs (p. ex.,
contrôle de l’environnement), besoins affectifs (p. ex., contrôle de l'humeur), besoins
d'intégration sociale (p. ex., interaction parasociale), besoins d'intégration des habitudes (p.
ex., les médias pour marquer le temps). La valeur des médias pour le développement de
l'identité est élevée à plus d'un titre: tous les domaines cités sont importants pour une identité
intégrée. (...)
Analysons maintenant d'un peu plus près les formes d'incidence et d'utilisation pour la
génération télévision et la génération virtuelle.
La télévision d'antan et d'aujourd’hui
Dans son ouvrage «Die Fernsehgeneration», (1996), Wolfram Peiser a comparé la valeur de la
télévision pour les personnes appartenant à la première génération à grandir avec ce média à
la valeur qu'elle revêtait pour les hommes déjà adultes lors de l'apparition de la télévision. Il
appliqua pour cela l’analyse dite de cohorte. On entend par cohorte un groupe de personnes
nées durant la même période. On désigne par génération télévision toute cohorte pour laquelle
la télévision était accessible en privé et avant la scolarisation à la moitié au moins de la
population − aux USA, dès l'année 1950, au Japon dès 1960, en Suisse et en RFA environ dès
l'année 1966. Les téléviseurs de l'époque étaient de gros meubles encadrés de bois, de
véritables "autels électroniques ménagers" occupant généralement le centre du salon. Il était
assez exceptionnel de pouvoir s'offrir le luxe d'un téléviseur.

4
Peiser a étudié la thèse suivante: «La génération télévision se différencie des cohortes plus
anciennes non seulement parce qu'elle a grandi entièrement ou en grande partie avec la
télévision, mais également dans son utilisation des médias, ses valeurs, ses attitudes, sa
manière de penser et le reste de son comportement – et ce, dans une direction à chaque fois
très précise.». Le résultat attendu était: «la génération télévision a une forte affinité à la
télévision et lit par conséquent moins que les cohortes plus anciennes.»
Cette thèse n'a pas été confirmée par l’analyse des cohortes. La génération antérieure
présentait un attachement à la télévision plus fort que la génération télévision. Certes, les plus
jeunes cohortes lisent effectivement un peu moins, notamment les journaux, mais ne font pas
une consommation plus intense de la télévision. Comment expliquer ce constat? L'explication
la plus vraisemblable est que la télévision est plus évidente pour la génération télévision que
pour la génération antérieure, qui a vu naître le nouveau média. Peiser a pu démontrer qu'un
processus de quotidianisation s'est instauré et a réussi à retirer au média un peu de sa
fascination. Lorsque l'on compare entre elles des personnes d'âges différents à un moment
donné, on constate que les durées d'utilisation de la télévision augmentent avec l'âge des
personnes. De plus, le temps total moyen d'utilisation des médias a augmenté au cours des
dernières décennies.
Mais le temps consacré aux médias ne suffit pas à clarifier la valeur de la télévision en
matière d'identité, il faut également analyser les contenus consommés, avec leurs motifs et
leurs effets. A titre d'exemple, nous présentons ci-après comment les jeunes se comportent
avec les débats spectacles (talk show) à la télévision. Les débats spectacles offrent une
multitude de sujets de conversation et de modèles, dans le sens de la théorie d'apprentissage
sociocognitive selon Albert Bandura, tournant autour des questions de l'identité. Je me réfère
ici à l'étude d'Ingrid Paus-Haases «Talkshows im Alltag von Jugendlichen» de 1999, fondée
sur une enquête représentative de 650 jeunes allemands de 12 à 17 ans. L'enquête a été
complétée par des discussions de groupe, des interviews personnelles, des études de cas sur
des fans de débat spectacle et des analyses du contenu des formes de débat spectacle.
Un quart des jeunes ne regarde jamais de débat spectacle. La valeur moyenne se situe à six
contacts par semaine. 13 pour cent des jeunes sont de grands consommateurs, qui ont donc
plus de deux contacts quotidiens avec des débats spectacles. Des thèmes comme l'école, le
corps, la mode, la beauté, les piercings, le maquillage, la boulimie et l'anorexie rencontrent un
large écho. Ceci ne correspond pas simplement au classement de l'offre, puisque les cinq
thèmes les plus fréquents au cours de l'enquête avaient été: relations/amour/amitié (23 pour

5
cent), caractère/savoir-vivre/attitudes (12), famille/éducation et sexe (chacun 10),
corps/beauté/mode/aspect (tout juste 10).
L'enquête a permis de constater différents styles de réception des débats spectacles. Les
jeunes bénéficiant d'une formation plutôt réduite tendaient vers une réception naïve; ils étaient
donc d'avis que «des gens honnêtes présentaient des problèmes réels et obtenaient une aide
réelle» dans ces débats spectacles. Les jeunes mieux formés tendaient vers une réception
réflexive; en d'autres termes, ils tenaient compte du fait que le producteur s'intéressait à
l'audimat, les invités à l'argent ou à leur image et que, dans certains cas, le débat était mis en
scène. Les jeunes filles s'impliquaient plus fréquemment dans la réception: elles ressentaient
de la pitié pour les invités qui racontaient leur dure histoire ou partageaient l'enthousiasme
général lorsqu'il s'agissait d'une personne disparue et retrouvée. Les jeunes hommes
présentaient une réception plutôt distante; en d'autres termes, ils se moquaient de ces
personnes bizarres et de leurs problèmes. Ils prenaient plus souvent le contre-pied des invités
au débat spectacle. Des études de cas ont montré que les formes de réception naïve et
impliquée étaient plus souvent le fait de jeunes filles issues de milieux à problèmes. C'est là
que le recours au débat spectacle influençait le plus la construction de la réalité des jeunes.
L'exemple explique mieux le fait que des styles différents de réception imprègnent la valeur
d'un contenu médiatique pour l'identité et la communication: davantage que la réception
réflexive, le style naïf de réception mène plutôt à une influence sur l'image de soi et sur les
représentations du comportement raisonnable. Plus que la réception distante, la réception
impliquée se traduit par d'autres discussions au sein de la famille ou du cercle des amis. Mais
dans tous les cas, cette forme d'émission télévisée sert à des processus de comparaison sociale
et influence l'image que les adolescent-e-s se font de la réalité.
La génération virtuelle
En 1998, dans «Net Kids», Don Tapscott a souligné les points forts des membres de la
«génération @». Selon lui, ils sont indépendants et autonomes, émotionnels et
intellectuellement ouverts, ils ne connaissent aucun tabou et expriment librement leur opinion,
ils sont novateurs et dotés d'un esprit de chercheur, ils sont directs et authentiques. Ces
appréciations remontent au comportement actif des jeunes dans le World Wide Web. Les
opinions étaient librement exprimées dans les chats et les news groups, tous ceux qui étaient
en ligne pouvaient participer à la discussion et le développement de nouvelles formes de la
communication rapide, comme l'utilisation des emoticons et des abréviations, offrait aux chats
un moyen de communication par clavier particulièrement fluide. (...)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%