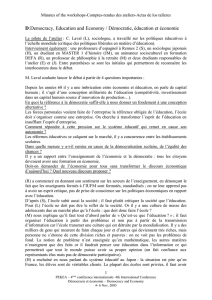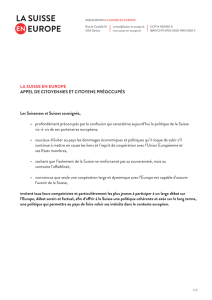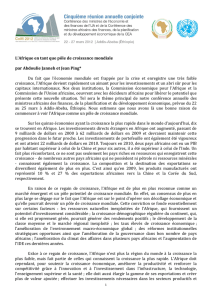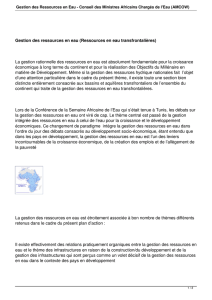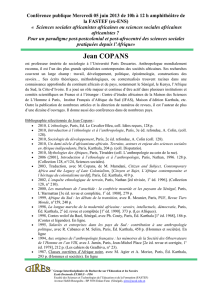De la relation entre culture et développement

CULTURE
ET
DÉKELOPPEMENT
De
la relation entre culture et
développement
:
IeGons asiatiques
pour l‘Afrique
Si l’on a beaucoup discuté au cours de la dernière décennie du
rôle que la culture a pu jouer dans le développement des nouveaux
pays industrialisés du Sud-Est asiatique, ce débat a tout simple-
ment été escamoté s’agissant de l’Afrique,
à
laquelle l’Asie est pour-
tant régulièrement donnée en exemple
(1).
Alors que l’efficacité
des mesures d’ajustement structurel est de plus en plus contestée
à
la lumière du naufrage grandissant du continent noir, il nous
semble opportun de reconsidérer l’expérience asiatique et ses ensei-
gnements, appréhendés sous leur double aspect culturel et Ccono-
mique. En partant des certitudes et des supposés de la relation
cultureldéveloppement, nous voudrions poser le problème de la
prise en compte
ou
non des facteurs culturels dans I’évaluation des
perspectives de développement en Afrique
;
et donc dire ce qu’une
telle prise en compte impliquerait
-
si elle était admise
-
au niveau
de la conception et de la conduite des politiques de développement
économique, au regard des leçons qui se dégagent de l’expérience
si riche, si foisonnante et si instructive de l’Asie.
Le
concept de développement
:
essai
de définition
I1 n’est nul besoin de s’immiscer dans les débats et autres querelles
d’experts sur ce qu’il convient d’appeler développement pour réaliser que
(1)
Les excellents ouvrages
d’Etounga Manguélé
(L’Afriue a-t-elle
besoin d’un programme d’ajustement
ciiltu-
re1
?)
et d’helle Kabou
(Et
si
Z’Afique refu-
sait le développement
?)
ont ouvert la voie
à
un tel débat, sans malheureusement
réus-
sir
à
lui donner tout le retentissement
escompté
:
celui d’un éveil des consciences
africaines sur la nécessité d’une véritable
révolution des mentalités, condition
sine
qua
non
du développement efficient d’un
continent
sous
perfusion économique
depuis pratiquement les premières heures
de son émancipation politique.
Au
demeu-
rant, ces deux auteurs ont été accusés
-
à
tort croyons-nous
-
de verser dans l’afro-
pessimisme ambiant et de ne rien apporter
de nouveau par rapport au vieux discours
misérabiliste qu’un certain nombre d’intel-
lectuels blancs entretiennent sporadique-
ment sur l’Afrique postcoloniale depuis
trois bonnes décennies.
96

JEA
N-BAPTISTE
ONANA
les performances économiques de l’Afrique l’en éloignent radicalement.
De fait, la littérature spécialisée
-
onusienne notamment
-
définit com-
munément le sous-développement ou l’absence de développement par
leurs symptômes (pauvreté, famine, sous-alimentation, analphabétisme,
forte mortalité, etc.), et tout particulièrement par le plus synthétique
d’entre eux
:
le revenu par tête. Cette approche reste évidemment super-
ficielle et peu satisfaisante; pour deux raisons essentielles. Elle n’explique
pas les spécificités structurelles du Tiers monde en général et de l’Afrique
en particulier, pas plus que les mécanismes complexes qui sont
à
leur
origine. De plus, elle conduit
à
des raccourcis trop facilement assimilateurs
entre les pays en voie de développement et les pays développés considérés
à
des étapes antérieures de leur évolution, comme si le développement
n’induisait pas des transformations qualitatives en plus d’une augmenta-
tion quantitative
du
revenu.
En réalité, trois grands critères permettent de caractériser encore
mieux le sous-développement
ou
l’absence de développement
:
les inéga-
lités sectorielles de productivité, la désarticulation du système économique
et la dépendance économique extérieure. Si les inégalités de productivité
sont communes aux pays sous-développés et aux pays développés, une
différence de taille doit cependant être relevée
:
dans ces derniers, il existe
toujours des forces économiques pour diffuser les bénéfices du progrès
à
l’ensemble du corps économique
-
notamment par les ajustements de prix
et la recherche d’un certain équilibre des salaires et des taux de profit dans
les différents secteurs. Ces forces agissent de telle manière que le centre
de gravité de l’économie se déplace invariablement vers les secteurs les
plus productifs.
I1
en résulte que les inégalités enregistrées dans la distri-
bution du
PNB
par tête sont toujours modérées
:
les rapports les plus
extrêmes relevés vont de
1
à
2
ou
à
3
entre les secteurs les plus éloignés.
Par contre, dans les pays sous-développés, des rapports de
1
à
4,
voire de
1
à
10
ou davantage sont souvent observés
-
tout simplement parce que
les forces qui, dans une économie développée, diffusent le progrès n’opè-
rent pas
ou
très mal. Ce manque de communication entre eux des diffé-
rents secteurs dans les économies sous-développées découle de la désar-
ticulation de celles-ci.
En effet, chaque économie développée constitue un tout cohérent fait
de secteurs qui procèdent entre eux
à
d’importants échanges
-
qualifiés
d’inter-industriels
ou
d’inter-sectoriels. Ceux-ci sont solidaires les
uns
des
autres,
ou
à
tout le moins complémentaires
:
les industries extractives et
énergétiques fournissent leurs matières premières principales aux indus-
tries de base, lesquelles alimentent en biens d’équipement et semi-finis les
industries légères et l’agriculture industrialisée, qui
à
leur tour produisent
des biens de consommation.
A
l’inverse, les économies sous-développées
sont constituées de secteurs juxtaposés qui n’échangent que marginale-
ment entre eux, et sont liés principalement avec l’extérieur. Ce qui pose
le problème de leur dépendance commerciale
vis-à-vis
de l’étranger. Dans
les pays sous-développés en effet, la part des exportations dans le
PIB
est
extrêmement variable, allant de
3
d
60
%.
Mais tous, pris individuellement
ou collectivement, présentent cette particularité non seulement que leurs
exportations sont constituées très largement de produits bruts (minéraux
ou agricoles) et leurs importations de produits manufacturés, mais surtout
97

CULTURE
ET
DÉVELOPPEMENT
que l’essentiel de leur commerce s’effectue avec les pays développés,
quand, au contraire, ces derniers commercent majoritairement entre eux.
Dans le contexte de misère sociale et économique qui caractérise
l’Afrique d’aujourd’hui (délabrement du tissu économique, désorganisa-
tion de l’appareil de production, pénuries
à
répétition, famines, guerres
ethniques, épidémies, chômage, fuite des forces vives, etc.) le concept de
développement prend une signification autrement plus simple. I1 doit alors
s’entendre, en premier lieu, de la capacité d’un pays
à
satisfaire ses besoins
primaires et urgents, sans recours
à
la générosité
ou
à
l’aide extérieures
;
et en second lieu, de l’aptitude de son économie
à
générer et
à
redistribuer
des richesses. En Afrique, cela veut dire réaliser I’autosuffisance alimen-
taire, garantir une couverture sanitaire satisfaisante
à
la population, créer
des emplois dans les secteurs qui offrent les meilleures potentialités
-
les
services et l’agriculture notamment
-
,
lancer de grands programmes
d’équipement en infrastructures sociales et économiques, endiguer l’exode
de l’élite et de la main-d’œuvre qualifiée en général, et réaliser la paiv civile
et l’unité nationale autour des valeurs de la citoyenneté et de la commune
identification au creuset national.
Rien de tout cela ne sera possible tant que l’Afrique n’aura pas
(re)trouvé le chemin de la croissance économique, lequel passe nécessai-
rement par son industrialisation. Une idée fort répandue dans les cercles
de pensée tiers-mondistes veut au contraire que, dans sa phase pré-
industrielle, l’Afrique doive d’abord et avant tout développer son agricul-
ture
-
notamment au motif que c’est cette dernière qui doit soutenir
l’industrie et non le contraire. S’il se fonde tout particulièrement sur
l’expérience, riche d‘enseignements, des pays d’Europe occidentale, ce
raisonnement pêche par excès d’assimilation
à
un
double point de vue.
-
D’abord, il semble ignorer que l’Afrique n’est pas un tout homo-
gène, et qu’au contraire ses mille et
un
contrastes exigent de considérer
chaque pays comme un cas d’espèce
:
de fait,
il
n’est pas pertinent de loger
à
la même enseigne économique les pays pétroliers (Gabon, Nigeria,
Angola et Congo)
ou
riches en minerais divers (Zaïre, Namibie, Botswana,
Zambie
...)
avec ceux du Sahel (Sénégal, Niger, Tchad, Mauritanie)
ou
des régions forestières propices
i
l’activité agricole (Cameroun, Ghana,
Côte d’Ivoire...). La base industrielle naturelle des premiers est le pétrole
et les minerais. S’ils prennent le parti de développer leur agriculture, et ils
y ont grand intérêt, ce doit être uniquement en complément et non en
alternative de cette base première comme cela a parfois été préconisé.
L’exemple de l’Afrique du Sud, qui a bâti sa puissance industrielle sur
l’exploitation de riches gisements d’or et de diamant tout en élevant son
agriculture au premier rang continental est
à
cet égard parlant. Quant aux
autres pays, tout particulièrement ceux qui sont dotés d’un fort potentiel
agricole, on ne saurait trop leur recommander d’accompagner la valorisa-
tion de celui-ci par un effort de développement industriel conséquent.
-
Ensuite, le raisonnement susmentionné donne
à
penser que les
Afri-
cains peuvent réinventer le monde,
ou
qu’ils doivent nécessairement pas-
ser par les mêmes stades de transformation économique et sociale que
l’Occident pour parvenir au développement. En réalité, il s’agit pour eux,
comme le suggère l’exemple des nouveaux pays industrialisés du Sud-Est
asiatique, d’acquérir et d’assimiler
un
savoir-faire et des connaissances
98

3..
N-BAPTISTE ONANA
techniques qui existent déjà, et qui ont surtout fait leurs preuves ailleurs.
Cela pose la question des transferts de technologie et celle
-
fort contro-
versée
-
de la vente d’usines clés en mains, dont on sait qu’elle a été suivie
d’échec dans la plupart des pays africains qui y ont eu recours.
Au
point
que de fausses querelles se sont développées sur l’opportunité de la pour-
suite de celles-ci.
Nous
pensons quant
à
nous que si mise en cause il doit
y avoir, elle devrait concerner non pas le principe des ventes d’usines elles-
mêmes, mais le niveau de formation et de compétence des individus aux-
quels incombent la gestion et l’administration des usines achetées.
Mais pour s’industrialiser, l’Afrique doit attirer des capitaux hangers
en quantité suffisante, compte tenu de son faible niveau d’épargne. Or il
est évident qu’elle ne pourra y parvenir si, en plus d’une politique incita-
tive, les Etats ne se dotent de réseaux de communications et de transports
efficients.
A
ceux qui, en Afrique
ou
ailleurs, auraient encore tendance
à
sous-estimer leur rôle dans l’appel des investissements, il n’y a qu’à rap-
peler les résultats d’un récent sondage
:
on
y
apprend que, parmi les rai-
sons avancées par les investisseurs qui ont choisi de s’installer en Afrique
du Sud, la qualité de ses communications et de son réseau de transports
(du reste le plus moderne du continent) arrive en quatrième position,
avant l’existence d’un noyau industriel performant et tout juste après la
démocratisation du pays
(2).
Le développement sera-t-il pour autant réalisé une fois réunis les préa-
lables et les conditions rappelées ci-dessus
?
On peut en douter, car les
Africains devront encore vaincre certains comportements et des habitudes
qui s’avèrent être des obstacles
à
leur développement au moins aussi réd-
hibitoires que l’absence d’industrialisation et le sous-équipement en infras-
tructures. De fait, toute amorce de développement dans le continent noir
est illusoire tant que le corps social africain reste
à
ce point affecté par une
corruption généralisée, un incivisme caractérisé, une conscience tribale et
ethnique antinationale, la concussion, la gabegie, le népotisme et des men-
talités d’assistés. Certes ces tares sont loin d’être une exception africaine.
Mais dans une société
où
les mentalités restent réfractaires
ou
à
tout le
moins inadaptées
à
la conception moderne du développement, elles pren-
nent une ampleur et une gravité autrement plus grandes.
Du
sens
de
la
culture économique
Tout en constatant qu’il n’y a pas d’unanimité quant au rôle que
joueraient les facteurs culturels dans la détermination des comportements
économiques individuels
ou
collectifs, on peut affirmer avec quelque cer-
titude que certaines cultures humaines se prêteraient davantage que
d’autres aux exigences et contraintes du développement économique
moderne.
A
titre d’exemple, il ne fait pas de doute qu’une culture qui
encourage le travail, l’éducation, le sens de l’épargne et une conception
restrictive de la parenté aura quelque avantage
-
du point de vue écono-
mique s’entend
-
sur celle qui favoriserait l’oisiveté, la prodigalité, les
(2) Enquête
du
Mail
and Guardian,
Afrique
du
Sud,
12 juillet 1997.
99

CULTURE
ET
DÉVELOPPEMENT
relations parentales trop extensives ou négligerait la formation des hom-
mes. Mais cela ne signifie nullement que les individus de la première caté-
gorie vont nécessairement réussir, ni que ceux de la seconde vont échouer
irrémédiablement. En réalité, de nombreux autres facteurs sont suscepti-
bles d’induire l’échec
ou
la réussite économique davantage que les carac-
téristiques culturelles d’une société. Ainsi des politiques économiques et
fiscales, des taux de change nominaux
ou
des mécanismes sociaux de redis-
tribution des ressources nationales.
On peut ajouter
à
cela que la culture n’est pas une réalité figée et
immuable. Elle est dynamique et sujette
à
des changements, fonctionnels
et structurels, qui, le plus souvent d’ailleurs, sont une adaptation
à
l’évo-
lution sociale et économique du pays considéré. Vu sous cet angle,
un
facteur culturel perçu aujourd’hui comme un avantage est susceptible de
devenir un handicap
à
terme, et vice versa. Nous voudrions donc être
explicites quant au sens et
à
la portée qu’il conviendrait de donner
à
l’oppo-
sition facteur favorable/facteur défavorable. De fait, voir dans un facteur
culturel un atout d’un point de vue économique ne revient pas nécessai-
rement
à
l’eriger en modèle
ou
en valeur universelle. Inversement, dire
qu’il n’est pas particulièrement avantageux pour qui en est doté ne signifie
pas le disqualifier forcément.
Nous
comprendrions que certaines suscep-
tibilités puissent être heurtées si des jugements de valeur étaient formulés
à
leur encontre, du genre
:
((
vous autres êtes dotés d’une mauvaise culture.
Voilà pourquoi vous ne parvenez
à
rien
D.
Tout au long du présent article,
l’expression culture économique s’entendra uniquement d’une simple
référence au contexte culturel dans lequel intervient le développement éco-
nomique de manière générale. Etanlt entendu que ce contexte est rarement
le même d’une société
à
l’autre ou d’un groupe social
à
l’autre.
Considérons par exemple les Amériques,
oÙ
les différences culturelles
ont souvent été citées parmi les causes probables des disparités économi-
ques et sociales si nombreuses qui opposent le Nord et le Sud. Historique-
ment, la culture nord-américaine a toujours symbolisé les valeurs énumé-
rées plus haut, censées être des facteurs favorables au développement
économique.
A
l’inverse, l’Amérique latine a souvent été créditée de la
plupart de celles que l’on peut raisonnablement qualifier de facteurs défavo-
rables.
Si
l’on choisit de se placer sur le seul terrain des valeurs morales
-
et
sans même qu’il soit besoin de faire de l’axiologie -il apparaît indubitable-
ment que l’Amérique latine a forgé une culture plus
((
sociabilisante
))
et plus
vivable sur un plan humain que celle de son riche et puissant voisin du Nord.
Sachant par ailleurs que les
((
valeurs du cœur
))
priment généralement
sur l’économique dans les pays en voie de développement, on pourrait
même avancer l’hypothèse que la sous-performance de leurs économies
est la nécessaire contrepartie de la préservation d’un certain humanita-
risme culturel. En ce qui les concerne, les Latino-Américains semblent
l’avoir admis, ainsi que l’illustre un célèbre essai, daté de la fin du siècle
dernier, de l’écrivain uruguayen
Hosé
Enrique Rodo. Celui-ci y identifie
l’Amérique du Nord et l’Amérique latine
à
deux personnages shakespea-
riens, Caliban et Ariel. Le premier, gnome monstrueux personnifiant la
force brutale qui est incapable d’apprécier les bonnes choses de l’existence,
est obligé d’obéir au second
-
puissance supérieure et affectueuse
-
tout
en étant en révolte permanente contre lui.
1
O0
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%