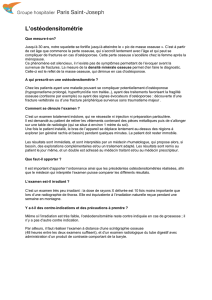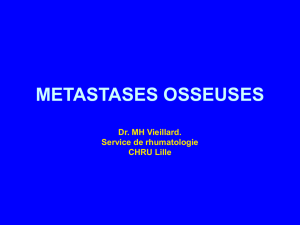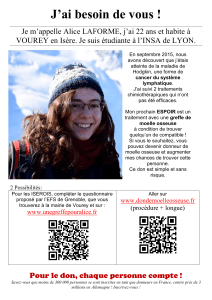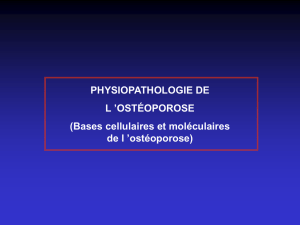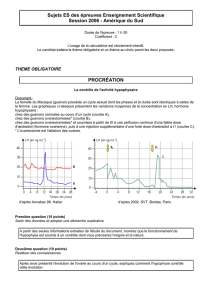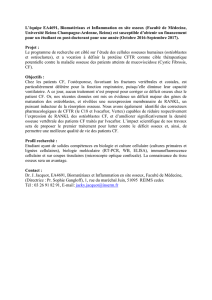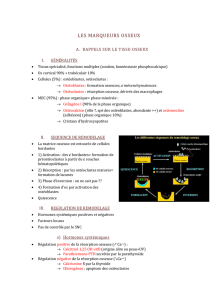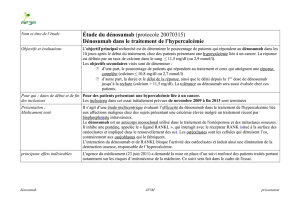Ostéoporose: Mises à jour 2013 concernant le traitement

835
curriculum
Ostéoporose: Mises à jour 2013 concernant le traitement
2e p artie: Les médicaments d’aujourd’hui et de demain
Christian Meier, Marius E. Kraenzlin
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus, Universitätsspital Basel
Tr aitement hormonal substitutif
Raloxifène et bazédoxifène
Quintessence
•
•
•
•
•
Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum
836
Bisphosphonates
Dénosumab
Ta bleau 1
Fractures
vertébrales
Fractures
non vertébrales
Fracture
de la hanche
Mortalité
Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum
837
Figure 1
Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum
838
Nouveaux développements
dans le traitement de l’ostéoporose
Inhibiteurs de la cathepsine K
Figure 2
αβ
αβ
Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum
839
Figure 3
A
βGlycogen synthase
kinase3β(GSK3β)β-β
B
ββ
β
AB
Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840
 6
6
1
/
6
100%