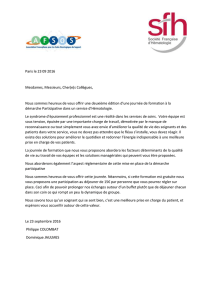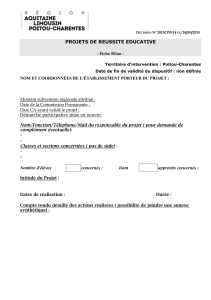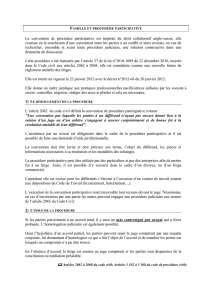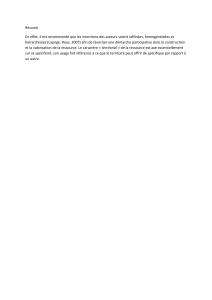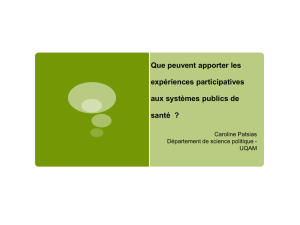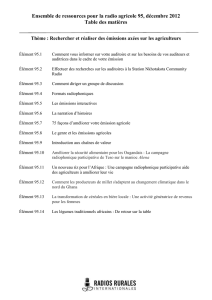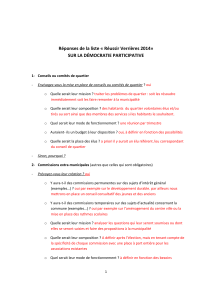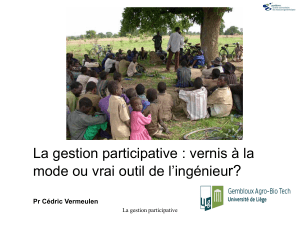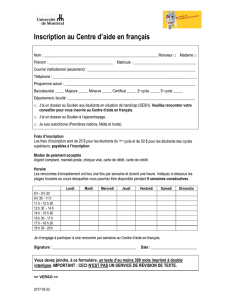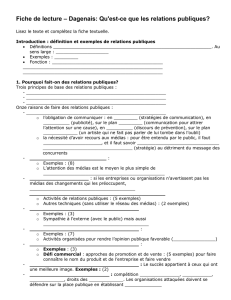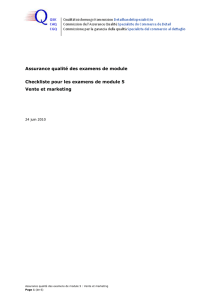RE: D.i.a.l.o.g.u.e.s. - Saw-B

Pour un
dialogue social
adapté aux entreprises
d’économie sociale
visant la participation
—
Recommandations
à destination
des acteurs européens
du dialogue social
RE:D.i.a.l.o.g.u.e.s.
Avec
le soutien
nancier
de l’Union
Européenne
Autriche / Belgique /
Espagne / France /
Italie / Roumanie /
Royaume-Uni

33
Sommaire
Introduction .......................................................... 2
Le dialogue social européen ................................................. 2
Des relations industrielles au dialogue social ............................. 2
Un dialogue social en construction ....................................... 2
L’économie sociale visant la participation .................................... 3
L’entreprise sociale : définition selon l’EMES .............................. 3
La participation en entreprise : une question d’empowerment
et d’intérêt général ..................................................... 4
Le projet RE:DIALOGUES ..................................................... 5
Un groupe, deux types de partenaires, deux types d’entreprises ........... 5
Six thèmes, six rencontres et une méthodologie concertée ................ 8
Des constats aux recommandations européennes ........ 10
Se connaître, se reconnaître et travailler ensemble .......................... 11
Une voix pour l’économie sociale dans le dialogue social ..................... 13
Pour une reconnaissance légale de la gestion participative en entreprise ..... 15
Rapports nationaux ................................................ 16
Autriche ................................................................... 17
Belgique ................................................................... 18
Espagne ................................................................... 20
France ..................................................................... 22
Italie ....................................................................... 24
Roumanie .................................................................. 26
Royaume-Uni .............................................................. 28
Conclusion ............................................................ 31
Annexes ............................................................... 32
Annexe 1 : questionnaire pour l’enquête qualitative .......................... 32
Annexe 2 : Tableau des constats et recommandations pour chaque pays ...... 38
Bibliographie .............................................................. 40
RE:D.i.a.l.o.g.u.e.s
sur le web
Retrouvez toutes les informations
relatives au projet RE:DIALOGUES
sur les sites :
http://www.ensie.org
http://www.terre.be
http://www.bbsnet.at
http://www.ideesasbl.be
Avertissement
Le contenu de cette publication
n’engage que ses auteurs.
La Commission européenne
n’est pas responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations
contenues dans cette publication.

54 5
RE:D.i.a.l.o.g.u.e.s.
Introduction
L’économie sociale,
c’est 6,53% de l’emploi rémunéré
dans l’Union Européenne
des 27 en 2009-2010, soit précisément
14.128.134 emplois. Par rapport
à 2003, cela représente
une augmentation de 26,79%.
[CIRIEC, 2012]
Le réseau EMES (Émergence des Entreprises Sociales
en Europe) comprend des centres de recherche uni-
versitaires et des chercheurs. Son objectif a été
jusqu’à présent, la construction progressive d’un
corpus européen des connaissances théoriques
et empiriques autour du concept de l’économie
sociale. Il a établi neuf critères qui caractérisent
une entreprise sociale1.
1. Une activité continue de production de biens et/ou de services ;
2. un niveau significatif de prise de risque économique ;
3. la présence d’au moins l’un ou l’autre emploi rémunéré
(malgré la présence de volontaires) ;
4. un objectif explicite de service à la communauté ;
5. une initiative émanant d’un groupe de citoyens ;
6. une distribution limitée des bénéfices.
7. un degré élevé d’autonomie (malgré certain subsides) ;
8. un processus de décision non basé sur la propriété du capital ;
9. une dynamique participative impliquant diérentes parties
concernées par l’activité (travailleurs rémunérés, usagers,
volontaires, pouvoirs publics locaux, etc.)
Dimension
économique et
entrepreneuriale
Dimension sociale
Cependant, il ne s’agit pas d’un « système de relations collectives du travail qui serait,
au plan européen, comparable à ce qui existe dans les États-membres, notamment parce
que le dialogue social européen ne dispose pas de la capacité d’action qu’ont la plupart des
instances nationales, en particulier en matière de salaires. » [LÉONARD E., 2012] De plus,
si le rôle d’information et de consultation est assuré par les acteurs du dialogue social
européen, ils peinent encore à remplir pleinement leur rôle de négociation, en témoigne
le petit nombre d’accords-cadres conclus ces dernières années.
Le dialogue social européen peut et doit encore trouver ses marques. Mais on y retrouve
déjà «des processus d’échange d’information, d’apprentissages réciproques et de coordina-
tion» qui peuvent « cadrer les négociations au plan local ». C’est pour cette raison qu’il est
apparu important aux partenaires du projet RE:DIALOGUES de s’adresser aux acteurs du
dialogue social européen.
L’économie sociale visant la participation
L’entreprise sociale : définition selon l’EMES
Introduction
Certaines entreprises d’économie sociale développent une dynamique
d’insertion voire une gestion complète de l’entreprise axée sur la
participation des travailleurs aux prises de décision. Leur fonctionnement
innovant implique dans ces entreprises une approche du travail et de la propriété,
une structure, une gouvernance, une gestion des ressources humaines, un
management ou encore une politique d’emploi spécifiques.
Ce sont des spécificités qui influencent les relations industrielles de ces entre-
prises : d’une part dans la manière dont elles pensent, considèrent et organisent
les relations industrielles dans leur fonctionnement participatif, d’autre part dans
la façon dont elles s’inscrivent dans les systèmes organisés de la concertation sociale
aux niveaux national et européen. Dans les deux cas, ces entreprises rencontrent
des dicultés. Grâce à l’analyse de ces dicultés et à l’identification d’opportunités,
les partenaires du projet RE:DIALOGUES adressent leurs recommandations à la
Commission européenne, aux responsables et aux membres des organisations
politiques et de défense des travailleurs européennes, ainsi qu’aux participants
du Comité Économique et Social Européen.
Le dialogue social européen
Des relations industrielles au dialogue social
Les relations industrielles sont définies comme « un ensemble de phénomènes, opérant à
la fois sur le lieu de travail et en-dehors de celui-ci, consistant à déterminer et à réguler la
relation d’emploi. » [SALAMON M., 2000] Le champ couvert par les relations industrielles
ne se limite donc pas uniquement à la relation entre employeur et salarié. En eet, ces
relations comprennent « l’ensemble des pratiques et des règles qui, dans une entreprise, une
branche, une région ou l’économie tout entière, structurent les rapports entre les salariés, les
employeurs et l’État. Ces rapports peuvent être individuels ou collectifs, être directement le fait
des acteurs impliqués dans la relation de travail ou de leurs représentants, s’enraciner dans des
coutumes ou donner lieu à la production de règles formelles (accords, conventions, lois, etc.) »
[LALLEMENT M., 1997] On retrouve dans cette définition la description du dialogue social.
C’est dans ce cadre que les partenaires du projet RE:DIALOGUES ont mené leur réflexion.
Un dialogue social en construction
Le dialogue social européen réunit des organisations d’employeurs et des organisations
de travailleurs européennes dans des discussions bilatérales et des processus de consul-
tation par la Commission européenne. Ils élaborent des relations collectives et contri-
buent à la construction de la politique sociale de l’Union européenne, notamment en
matière d’emploi. Ils ont également la possibilité de conclure des accords qui peuvent,
s’ils prennent la forme d’une directive européenne, devenir contraignants pour les États-
membres. Le dialogue social européen se fait sur trois plans : les plans interprofessionnel
et sectoriel, et celui de l’entreprise.
Dimension
participative
—————
1. Cf. http://www.emes.net/about-us/focus-areas/social-enterprise

76 7
Le projet RE:DIALOGUES
Ce projet a été possible grâce à la rencontre de deux conditions. La première est l’intérêt,
la disponibilité, la motivation et le niveau de maturité des diérents participants, y com-
pris les invités aux tables rondes, pour aborder la question parfois délicate du dialogue
social. La seconde, c’est l’obtention du financement de la part de l’Union européenne
pour des projets d’un an portant sur les relations industrielles. Ces conditions ont permis
d’organiser des rencontres susamment récurrentes pour atteindre le niveau de colla-
boration et la qualité de débat nécessaires.
Un groupe, deux types de partenaires, deux types d’entreprises
Le groupe qui a mené à bien ce projet était composé de deux types
de partenaires. D’une part, sept groupes-réseaux d’entreprises
sociales expérimentant dans leur pays respectifs divers types
de relations industrielles innovantes et d’autre part, quatre
groupes d’experts actifs dans les champs abordés par les re-
lations industrielles. Ce partenariat a permis d’avoir d’un côté,
une approche de terrain et de l’autre, un avis expérimenté et
des grilles d’analyse pertinentes.
Au sein des entreprises partenaires, deux sortes se distinguent
: celles qui ont une optique d’insertion à long terme et celles
qui agissent à moyen ou court terme comme « tremplin » vers le
marché du travail traditionnel. Pour les premières, la participation
s’eectue à tous les niveaux de décision et intègre une formation
continue à la participation sous forme d’un cycle de réunions complé-
mentaires. Pour les secondes, la participation est organisée dans la mesure du
possible en fonction de la rotation des personnes en insertion au sein de l’entreprise.
« RE:DIALOGUES » comme
une « RÉponse » concrète
aux dicultés rencontrées par
les entreprises d’économie sociales
dans leurs relations industrielles,
à travers un « DIALOGUE »
constructif avec les acteurs
de la concertation
sociale.
La participation en entreprise : démocratie
directe, empowerment et intérêt général
Comme expliqué ci-dessus, les entreprises d’économie sociale sont notamment caracté-
risées par une dynamique participative et un processus de décision spécifique. En combi-
nant ces deux aspects, l’entreprise développe une gestion participative. Le groupe Terre
la définit comme « l’organisation des prises de décisions stratégiques, politiques et opéra-
tionnelles en impliquant directement les travailleurs dans le débat et la décision dans une
optique d’intérêt général. » [ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE TERRE, 2012]
Deux pratiques sont fondamentales dans ce type de gestion :
1. la démocratie directe qui permet à chaque travailleur de devenir co-décideur ;
2. l’identification de lieux clairs pour le débat et la prise de décisions
qui permet à chaque travailleur de discerner son travail de production
et de co-décision.
En ce sens, la gestion participative est une innovation en matière de gouvernance1. Elle a
des répercussions sur tous les domaines de l’entreprise, et particulièrement sur sa poli-
tique de gestion des ressources humaines2.
La gestion participative favorise l’empowerment3 des travailleurs : prendre des décisions
qui engagent l’entreprise, particulièrement d’ordre stratégique, n’est ni aisé ni courant.
Cela implique des capacités de compréhension, de recul critique, d’avis, de débat et de
positionnement qui, faute de culture propice à la participation aux décisions entrepre-
neuriales, doivent s’acquérir par la formation et la pratique quotidienne de la participa-
tion. L’empowerment est de ce fait un outil de la gestion participative.
Mais l’empowerment est aussi l’objectif de la gestion participative, puisque l’être humain
y est au centre des préoccupations. Le monde du travail constitue un endroit approprié
pour l’exercice de la citoyenneté à travers la prise de responsabilités et de décisions. Tous
les travailleurs, y compris ceux qui ont une fonction d’exécutant, ont alors la possibilité
d’ajouter à leur rôle de fournisseur de travail, un rôle de décideur. Ce nouveau rôle leur
confère du pouvoir sur leur emploi, cela contribue à leur motivation.
De plus, la gestion participative favorise la poursuite de l’intérêt général. Le recours à
l’intelligence collective permet de trouver des solutions créatives, sensées, acceptées et
orientées vers l’intérêt du plus grand nombre de participants.
—————
1. La gouvernance est « le système formé par l’ensemble des processus, réglementations, lois et institutions
destinés à cadrer la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. » (HAIDAR, 2009)
2. La gestion des ressources humaines constitue l’ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer,
mobiliser et développer les ressources humaines de l’entreprise afin d’atteindre ses objectifs.
3. « L’empowerment est le processus qui augmente la capacité des individus ou des groupes à faire des choix
et à transformer ces choix en des actions et résultats souhaités. » (THE WORLD BANK, s.d.)
RE:D.i.a.l.o.g.u.e.s.
Introduction
P
o
r
t
r
a
i
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
:
K
o
r
a
k
a
n
h
S
y
c
h
a
m
p
a
n
a
k
h
o
n
e
-
©
2
0
1
2
-
L
e
R
e
l
a
i
s
P
o
r
t
r
a
i
t
s
d
e
t
r
a
v
a
i
ll
e
u
r
s
:
N
a
d
i
n
e
B
a
s
t
i
n
-
©
J
.
C
o
n
s
t
a
n
t
2
0
1
3
-
G
r
o
u
p
e
T
e
r
r
e

98 9
Entreprises partenaires
CENTRE D’ÉCONOMIE SOCIALE
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Spécificité : Expertise scientifique
> http://www.ces.ulg.ac.be
EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL
INTEGRATION ENTERPRISES
Spécificité : représentation et expertise européenne
des entreprises sociales d’insertion
> http://www.ensie.org
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN
DES ENTREPRISES SOCIALES
Spécificité : centre de recherche lié aux syndicats
> http://www.ideesasbl.be
SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES
WALLONNES ET BRUXELLOISES
Spécificité : agence conseil
> http://www.saw-b.be
Experts
GROUPE TERRE
Activité : Groupe d’entreprises actives principalement dans
la récupération, la construction et la solidarité internationale
Vision : Participer à la création d’un monde démocratique
et solidaire où chaque être humain a le droit de vivre dans
la dignité, de se réaliser dans le respect mutuel et celui des
générations futures
Travailleurs : 300 ETP
> http://www.terre.be
SOCIAL FIRMS UK
Activité : Réseau d’entreprises sociales
Vision : Tout le monde a la possibilité
d’être employé
Travailleurs : 1.751 ETP
> http://www.socialfirmsuk.co.uk
LE RELAIS
Activité : Groupe d’entreprises sociales actives dans
larécupération, le tri et la vente de vêtements de
seconde main et la production d’isolant thermique
Vision : Préserver sa dignité grâce au travail
Travailleurs : 1.200 ETP
> http://www.lerelais.org
FEDERACIÓN CASTELLANO–
LEONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
FUNDACIÓN LESMES
Activité : Réseau d’entreprises sociales d’insertion
de Castille et León
Vision : Promouvoir et développer, avec d’autres
agents économiques et sociaux, les mesures
d’inclusion sociale, les entreprises d’insertion et
l’accès à l’emploi pour les personnes victimes
de ou risquant l’exclusion sociale.
Travailleurs : 85 ETP dont 50 ETP
en insertion
> http://www.feclei.org
CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO
Activité : Réseau d’entreprises sociales d’insertion actives
principalement dans le recyclage
Vision : Insérer socialement et professionnellement des per-
sonnes défavorisées
Travailleurs : 700 ETP
> http://www.csabelelavoro.it
ATELIERE FARA FRONTIERE
Activité : Entreprise sociale d’insertion active dans
le recyclage et la réutilisation de matériel informatique
Vision : Lutter contre l’exclusion, protéger l’environnement
et développer des projets de solidarité pour l’éducation
et le développement local
Travailleurs : 20 ETP
> http://www.atelierefarafrontiere.ro
BESCHÄFTIGUNGSBETRIEBE STEIERMARK
Activité : Réseau d’entreprises sociales d’insertion
de la région de Styrie
Vision : Réunir tous les organismes sans but lucratif
de la Styrie, qui visent à réintégrer les personnes sans emploi
sur le marché du travail.
Travailleurs : 200 ETP permanents et 900 ETP en transition
chaque année
> http://www.bbsnet.at
RE:D.i.a.l.o.g.u.e.s.
Introduction
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%