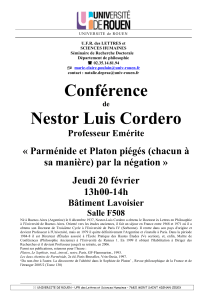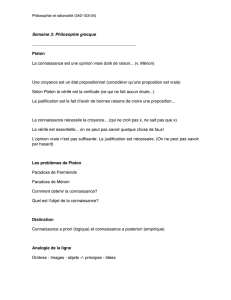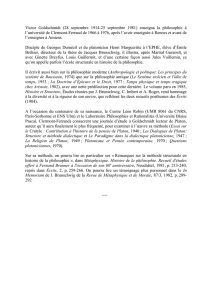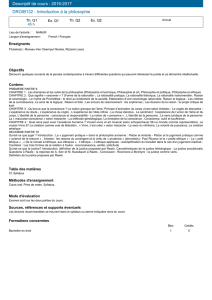Téléchargez le PDF

Alkemie
Revue semestrielle de littérature et philosophie
Numéro 3 / Juin 2009
L’autre
Editura de
Mansarda
˘
Editura de
Mansarda
˘

Directeurs de publication
Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR (Roumanie)
Răzvan ENACHE (Roumanie)
Comité honorique
Sorin ALEXANDRESCU (Roumanie)
Marc de LAUNAY (France)
Jacques LE RIDER (France)
Irina MAVRODIN (Roumanie)
Sorin VIERU (Roumanie)
Conseil scientique
Magda CÂRNECI (Roumanie)
Ion DUR (Roumanie)
Ger GROOT (Belgique)
Arnold HEUMAKERS (Pays-Bas)
Carlos EDUARDO MALDONADO (Colombie)
Simona MODREANU (Roumanie)
Eugène VAN ITTERBEEK (Roumanie, Belgique)
Constantin ZAHARIA (Roumanie, France)
Comité de rédaction
Cristina BURNEO (Equateur)
Nicolas CAVAILLÈS (France)
Aurélien DEMARS (France)
Pierre FASULA (France)
Andrijana GOLUBOVIC (Serbie)
Aymen HACEN (Tunisie)
Dagmara KRAUS (Allemagne)
Ariane LÜTHI (Suisse)
Sorin Claudiu MARICA (France)
Daniele PANTALEONI (Italie)
Ciprian VĂLCAN (Roumanie)
Johann WERFER (Autriche)
ISSN: 1843-9012
Rédaction et administration : 5, Rue Haţegului, ap. 9, 550069
Sibiu (Hermannstadt), Roumanie
Tel: 004069224522
Courrier électronique: mihaela_g_en[email protected]
Site web: http://alkemie.philosophie-en-ligne.fr/
Périodicité: revue semestrielle
Revue publiée avec le concours de la Société des Jeunes Universitaires de Roumanie
Les auteurs sont responsables de leurs propres textes.
Les auteurs sont priés de conserver un double des manuscrits, qui ne sont pas retournés.
Tous droits réservés © Editura de mansardă,
Timişoara,
www.editurademansarda.ro

SOMMAIRE
PRÉSENTATION par Mihaela-Genţiana Stănişor .........................................................5
AGORA
Marc de Launay, Pour une lecture philosophique du texte biblique ................................ 9
Constantin Zaharia, La philosophie ou comment sen débarrasser .............................. 27
Ciprian Vălcan, Le comptable des unicornes ............................................................ 38
DOSSIER THÉMATIQUE: L’AUTRE
Nicolas Cavaillès, Le suicide des autres. Genèse du texte
«Coalition contre la mort» de Cioran ....................................................................... 45
Odette Barbero, Le même et lautre, langue et parole .................................................49
Ariane Lüthi, Le «texte de lAutre» sous la plume de Perros .....................................68
Marie Joqueviel-Bourjea, «Votre désert touche au mien».
Lorand Gaspar, Georges Perros: correspondance .......................................................... 80
Daniel Mazilu, Lenfer, cest les autres. Altérité sartrienne et altérité platonicienne .... 98
Delphine Aebi, Le théâtre ou le lieu de la rencontre avec lAutre...............................111
DÉS/DEUX ORDRES DU MONDE ET DU LANGAGE
Pierre Garrigues, Nietzsche et le jeu de laiôn .............................................................125
Gilda Vălcan, Nietzsche versus Platon .......................................................................131
Eugène Van Itterbeek, Constantin Noïca : approches dune pensée humaniste ............... 148
Ilinca Ilian, Représentation et négativité chez Julio Cortázar ....................................161
Simona Drăgan, La déconstruction – le succès américain du poststructuralisme .......171
EXPRESSIS VERBIS
«Cest la faille qui compte pour moi. La faille qui existe autant chez Cioran que chez
Baudelaire; la faille (ma faille) que je voudrais traduire et par là même donner à lire en
arabe.» Entretien avec Adam Fethi réalisé par Mihaela-Genţiana Stănişor ...................183
«La poésie est, dans sa plus grande partie, cette appréhension obscure,
ce passage à travers l’informulable, à travers l’inconnu, à travers l’inconcevable.»
Entretien avec Saúl Yurkievich par Ilinca Ilian et Ciprian Vălcan ............................189
ÉCHOGRAPHIES AFFECTIVES
Adam Fethi, Poèmes inédits ........................................................................................207
Eugène Van Itterbeek, Deux poèmes dédiés à Noïca ..................................................210
Laurent Fels, Poèmes inédits ......................................................................................211
LE MARCHÉ DES IDÉES
Ger Leppers, «André Le Gall: Eugène Ionesco. Mise en scène dun existant
spécial en son oeuvre et en son temps », Paris, Flammarion, Collection «Grandes
Biographies», 2009 ....................................................................................................214


5
Présentation
Le troisième numéro de la revue ALKEMIE se propose un débat philosophique
et littéraire autour du thème de lAUTRE, tel quil apparaît chez des auteurs comme
Cioran, Nietzsche, Sartre, Platon, Lorand Gaspar, Georges Perros, Marcel Aymé, Jean
Cocteau, Jean Genet, Boris Vian etc. La diversité des perspectives de recherche et les
nouvelles dimensions dapproche de ces auteurs célèbres nous déterminent à croire
que laltérité, ce jeu de lautre ou des autres, ce soi-même comme un autre, restent des
domaines de recherche inépuisables, autant dans la littérature autobiographique que
ctionnelle, autant dans le théâtre que dans la philosophie. Le dossier thématique
comprend des textes qui analysent les diérentes facettes dans lesquelles lAutre fait
sentir sa présence dans lœuvre: «le suicide des autres» dans un texte inédit de Cioran,
les révélations du binôme «le même et lautre, langue et parole», la construction du
«texte de lautre» chez Perros, «le jeu de laiôn» chez Nietzsche, un intéressant
rapprochement entre laltérité sartrienne et laltérité platonicienne, le théâtre vu
comme «lieu de rencontre avec lautre».
Il y a dans la revue des textes qui illustrent lextraordinaire combinaison ou
alternance entre deux genres ou deux perspectives dapproche: Marc de Launay fait
une lecture philosophique, rigoureuse et appliquée, du texte biblique, Constantin
Zaharia essaie de prouver la tentation de Cioran de se débarrasser de la philosophie qui
nest au fond quune attraction de faire de la littérature et Ciprian Vălcan sexerce sur
le style fragmentaire d’«un comptable des unicornes». Avec Eugène Van Itterbeek,
le lecteur découvre les profondeurs de la pensée humaniste de Constantin Noïca; les
autres études inventorient les systèmes de pensée de deux grands philosophes, Platon et
Nietzsche, les dimensions de la représentation et de la négativité chez Julio Cortázar, ou
le principe de la déconstruction tel quil apparaît dans le poststructuralisme américain.
Lentretien avec Adam Fethi apporte un changement de tonalité, un espace de
lagréable et de la protéiforme, un univers où la poésie et la philosophie, la création et
la traduction, lOccident et lOrient, se rencontrent pour se compléter. Et les poèmes
inédits dAdam Fethi, les deux poésies dédiées par Van Itterbeek à Noïca ainsi que
deux inédits du poète luxembourgeois Laurent Fels viennent prolonger léquilibre du
déséquilibre, les maladies bienfaisantes de lesprit, le silence des mots.
Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
1
/
220
100%