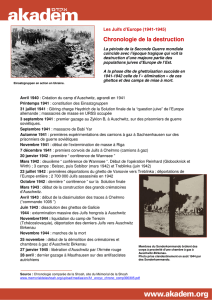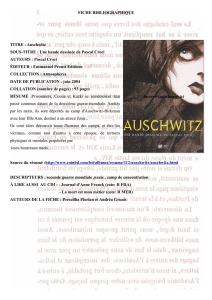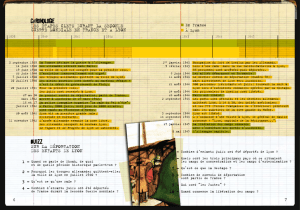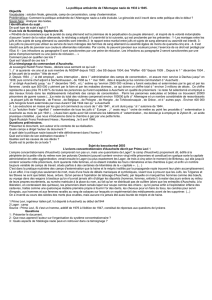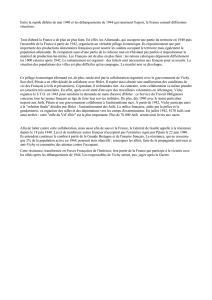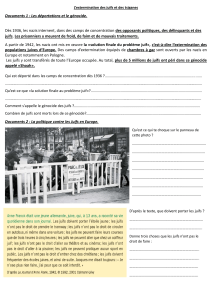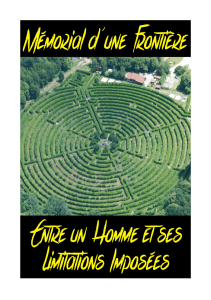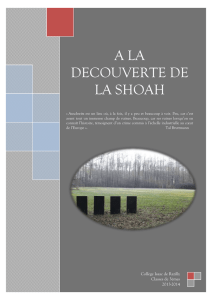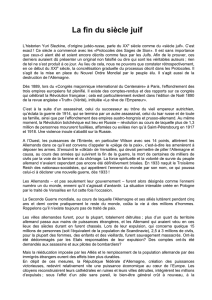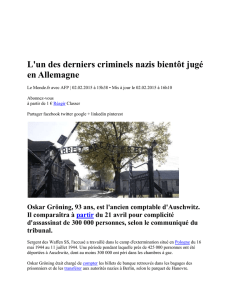LA PERSÉCUTION DES JUIFS Pour aborder le sort des Juifs

LA PERSÉCUTION DES JUIFS
Pour aborder le sort des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, il est
indispensable de connaître le contexte qui a pu permettre l’impensable. Nous
proposons ici le résumé d’un article de François et Renée Bédarida dans, La
France des années noires , tome 2 , de l’Occupation à la Libération, p.149-182,
réed.Seuil Histoire, 2000. Cet article est intitulé « la persécution des Juifs ». En
effet, les auteurs insistent sur la distinction fondamentale à apporter entre le
terme de répression qui s’applique à attaquer les personnes pour ce qu’elles font,
et le terme de persécution qui consiste à pourchasser des personnes pour ce
qu’elles sont. Pour les Juifs, le crime qui leur est reproché est d’être né.
1)UNE « QUESTION JUIVE » EN FRANCE
Pour comprendre la portée des événements de la période 1940-1944, il faut
repartir de la sociologie du phénomène juif dans la France de l’entre-deux
guerres. Les auteurs préviennent qu’on ne peut pas parler à proprement parler
d’une « communauté juive ». Les Juifs vivant en France forment un courant très
hétérogène. Il y a déjà une division entre les Juifs français et les Juifs étrangers.
Il y a en 1939, 150 000 Français de confession israélite (parmi eux, 90 000 sont
de « vieille souche » ) et 150 000 Juifs étrangers. Parmi ceux qui sont Français,
leur fierté d’appartenir à la Nation s’est renforcée lors de la guerre 14-18. Leur
francité s’est trouvée reconnue dans le sacrifice pour la patrie. Beaucoup de
choses opposent donc les Juifs français et les Juifs étrangers. Ces derniers
présentent beaucoup de différences (mode de vie, culture, pratique religieuse,
langue parlée le yiddish). Ils sont originaires de Pologne, de Roumanie, de
Hongrie, Tchécoslovaquie, Russie, et depuis peu d’Allemagne et d’Autriche. Ces
immigrés ( à part les Allemands et les Autrichiens) ont une autre différence avec
leurs coreligionnaires français, on les retrouve plutôt au bas de l ‘échelle sociale.
Ce sont en grande partie des travailleurs manuels, des ouvriers, des artisans. Ils
vivent surtout à Paris, 100 000 d’entre eux vivent dans des quartiers pauvres du
centre et de l’est (le Pletzl dans le 4
ème
arrondissement, Belleville, les Buttes
Chaumont). Les Français de confession israélite vivent plutôt dans les quartiers
bourgeois de l’ouest parisien. Les Juifs étrangers arrivés récemment sur le sol
français ont tendance à se regrouper dans des associations qui sont censées les
aider : Union des sociétés juives de France ( à tendance communiste) ou la
Fédération des sociétés juives de France ( de tendance sioniste). De manière
générale, les solidarités sont plus ancrées chez les immigrants récents, les
israélites français ne se reconnaissent pas dans le sionisme. On peut même
distinguer une inquiétude chez les Juifs français qui craignent un regain
d’antisémitisme face à l’immigration juive venue d’Europe centrale.
De fait, cet antisémitisme présente deux visages. L’un est violent, haineux,
alimenté par des phobies et des fantasmes. Il se retrouve à droite et à l’extrême
droite. Un autre antisémitisme est présent, plus latent, banalisé, insidieux. On le
retrouve chez certains communistes et socialistes.
La France de 1939, est le premier pays d’immigration au monde. La xénophobie
et l’antisémitisme s’entremêlent largement. En toile de fond, on retrouve deux
thèmes majeurs : le juif avide d’or et de richesses, et le juif errant, apatride.
Mais attention, comme le montre l’historien Ralph Schor, il existe aussi un « front
philosémite », chez les républicains et démocrates attachés aux droits de
l’homme, et dans le courant chrétien un journal comme La Croix a bien changé
depuis l’affaire Dreyfus, pour certains intellectuels chrétiens l’antisémitisme

devient une injure à la religion chrétienne (en parallèle à la redécouverte des
racines juives du christianisme).
2)DU STATUT DES JUIFS À L’ÉTOILE JAUNE
Le sort des Juifs en France a été subordonné à deux politiques aux objectifs et
aux modalités différents voire rivaux, la politique d’exclusion et de persécution
conduite par Vichy et la politique de déportation et d’extermination dans le cadre
de la « solution finale ».
De l’été 1940 au printemps 1942, la politique anti-juive d’origine française
prédomine. Elle s’inscrit dans une guerre contre les « étrangers de l’intérieur ».
Le 22 juillet 1940, on a d’abord la création par Allibert de la commission de
révision des naturalisations prononcées depuis 1927. (500 000 cas sont traités et
15 000 se voient retirer la nationalité française dont 40 % de juifs.) En Alsace,
les Allemands procèdent à l’expulsion des Juifs alsaciens-lorrains envoyés en
zone non occupée (20 000 Alsaciens). Le 27 août Vichy abroge le décret-loi
Marchandeau qui autorisait la poursuite contre les propos antisémites.
Le 3 octobre 1940 est créé le STATUT DES JUIFS.
Le 4 octobre 1940 un décret autorise l’internement des ressortissants étrangers
de « race juive » dans des « camps spéciaux ».
Le 7 octobre 1940 le décret Crémieux du 24 octobre 1870 est abrogé (il donnait
la nationalité française aux juifs algériens).
Les juifs se retrouvent exclus de la fonction publique, de l’armée, de
l’enseignement, de la presse, de la radio, du théâtre, du cinéma. Le statut est
justifié par le rôle des Juifs dans le déclin de la France, dans la défaite de 1940.
Le statut définit le juif comme race et non comme une religion. «Est déclarée
juive « toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux
grands-parents, si son conjoint est juif ».
Le 2 juin 1941, un deuxième statut aggrave le premier. Il établit un numerus
clausus dans les professions libérales et limite l’accès aux études. Et surtout, il
met en place le recensement des Juifs. En décembre 1941, Vichy obtient le
chiffre de 140 000 Juifs en zone non occupée.
Au total 3 422 fonctionnaires sont démis (1284 militaires, 1 111 professeurs dont
426 en zone occupée et 685 en zone non occupée, 545 fonctionnaires des PTT et
169 aux finances). Les auteurs soulignent que cette politique d’exclusion est
spontanée, autonome, française, vichyssoise. Le maréchal Pétain est un acteur
direct de cette politique.
Autre face sordide de la persécution vichyssoise : la France des barbelés et des
camps. Les auteurs rappellent les conditions de détention épouvantables des
camps de Gurs ( 60 000 personnes, hommes, femmes et enfants, internés de
1939 à 1945, dont plus d’un millier sont morts), Le Vernet, Noë, Rivesaltes, les
Milles…
Le 29 mars 1941, Vichy met en place le commissariat général des questions
juives dirigé par Xavier Vallat, le créateur de la Légion.
Comment réagissent les Juifs face à ces mesures ? Ils sont en fait divisés.
Certains ne voient pas d’un mauvais oeil le principe de la Révolution nationale,
du moins dans les premiers temps. Mais beaucoup se sentent offensés et
s’interrogent sur la nécessité de rendre leur médaille d’anciens combattants et
celles de leurs ancêtres… morts pour la France. Les dissensions sont mises à jour
par la création de L’UGIF par la loi du 29 novembre 1941. Ce rouage du système
vichyssois déconcerte les Juifs. L’UGIF est chargé d’assurer la représentation des

Juifs auprès des pouvoirs publics. Doit-on, peut-on participer à une institution qui
est entre les mains de Vichy et des Allemands ? Et sinon, comment faire pour
éviter le pire ?
En zone occupée, la persécution a commencé plus tôt. Le recensement de la
population juive a été prévu par l’ordonnance du 27 juillet 1940. Les magasins
juifs doivent être revêtus de l’écriteau « juif ». En octobre, les pièces d’identité
doivent avoir le tampon « juif ». En 1944, dans le cadre des spoliations des biens
juifs, 30 000 entreprises sont aux mains d’un « administrateur provisoire » et 10
000 ont fait l’objet d’une « aryanisation ». Au printemps 1942, l’étoile jaune
devient obligatoire. 83 000 étoiles sont distribuées en quelques jours. La
persécution s’accélère.
3)LA SOLUTION FINALE
La « solution finale » s’incarne dans une trilogie : concentration, déportation,
extermination. Elle commence en France le 27 mars 1942, avec le premier
convoi qui part de Compiègne.
Le 2 juillet 1942, l’accord entre la général SS Oberg et le René Bousquet,
secrétaire général de la police est conclu. La solution finale trouve désormais
dans la police française un appui solide et décisif. Le 4 juillet 1942, Laval prend
l’initiative inattendue par les Allemands, de proposer de déporter les enfants de
moins de 16 ans avec leurs parents… Sous le nom de code « vent printanier », la
grande rafle du Vel d’hiv peut commencer les 16 et 17 juillet 1942. Le travail
monumental de Serge Klarsfeld, le mémorial de la déportation des juifs : Vichy-
Auschwitz, permet de mesurer la portée de la solution finale en France.
76 000 Juifs ont été déportés. 3 % ont survécu, 2 500 sont revenus.
24 000 étaient français, les deux tiers des décédés étaient donc étrangers. La
plupart des Juifs déportés depuis la France sont morts à Auschwitz ( 70 000 ). En
1942, on a 43 000 déportés, 17 000 en 1943 et encore 16 000 en 1944.
Les trois cinquièmes des déportés, soit 43 000 ont été envoyés directement à la
chambre à gaz. Pour les 3 % qui sont revenus, le « syndrome du survivant »
traduit un malaise lancinant d’avoir survécu.
4)TROIS DÉBATS HISTORIOGRAPHIQUES
L’Histoire des Juifs de 1940 à 1944 a suscité d’innombrables débats et
polémiques.
On retrouve trois débats principaux :
-la responsabilité de Vichy ?
Les auteurs s’étonnent de voir la thèse du « bouclier » protégeant les Juifs mis
en place par Vichy bénéficier encore d’une fortune récurrente en dépit du nombre
impressionnant d’études qui montre son inanité. En effet, si on ne peut pas
parler d’un projet homicide avec volonté physique d’anéantir la race juive, le
gouvernement de Vichy a été un instrument efficace des première étapes de la
« solution finale » : l’exclusion et la déportation . Vichy a aidé l’occupant en
définissant, classant et isolant les Juifs au sein de la population. Vichy a
développé une propagande violemment antisémite et xénophobe. Et surtout,
Vichy a mis en place une collaboration d’État antisémite en utilisant son

administration et sa police contre les Juifs. 80% des Juifs déportés de France ont
été arrêtés par des forces de police françaises…
-la Résistance juive ?
Existe-t-il une Résistance spécifiquement juive, axée sur la lutte contre
l’extermination et le sauvetage communautaire ? Faut-il parler de Juifs résistants
ou de résistants juifs ? A ces questions complexes, se rajoutent la division entre
Juifs français et Juifs étrangers, et l’appartenance au phénomène communiste.
Pour les deux auteurs, le rôle principal dans la Résistance juive, a été tenu par
les Juifs étrangers, pour beaucoup communistes, pour certains sionistes. Ceux-ci
se sentent les premiers visés, habitués à l’antisémitisme, et se regroupent plus
facilement dans des organisations juives. Les auteurs citent pas exemple la sous-
section juive de la MOI dès l’été 1940, le Comité Amelot, l’ORT (Organisation
reconstruction travail) et l’OSE (organisation de secours aux enfants) en zone
non occupée ainsi que l’Armée ,juive d’inspiration sioniste qui devient en 1944
l’Organisation juive de combat (OCJ).
La recherche historique a également réévalué depuis quelques années les formes
de résistance sur la solidarité et les sauvetages : camouflage des enfants, filières
d’évasion, fabrication de faux papiers et services sociaux. Pour les auteurs
l’opposition entre « Résistance active » et « passive » est aujourd’hui artificielle
et spécieuse.
Les auteurs remarquent enfin que de nombreux juifs ont rejoint la Résistance à
des postes de responsabilité. Ces résistants combattent le nazisme en tant que
français avant tout, ils se sentent bien plus représentants de la Résistance
française que de la Résistance juive. La part de ces résistants a été importante.
Dans les compagnons de la Libération, ils forment 5 % du total, alors que les
Juifs ne représentent alors que 0,75 % de la population…
-l’attitude des Français ?
Après de vigoureuses controverses et des plaies encore à vif, l’historiographie
s’accorde aujourd’hui à distinguer trois aspects : la passivité des années 1940 et
1941, le tournant de l’année 1942 et la dimension de l’aide apportée aux Juifs
persécutés. En 1940 et 1941, l’apathie et la léthargie de l’opinion dominent, la
population est préoccupée par le ravitaillement, le sort des prisonniers et le
Statut des Juifs d’octobre 1940 et celui de juin 1941sont accueillis sans état
d’âme. Tout change avec les grandes rafles de l’été 1942. On assiste alors à un
revirement capital de l’opinion. La violence et la cruauté de la persécution
apparaissent au grand jour et les autorités spirituelles, catholiques et
protestantes, jusque là discrètes, condamnent publiquement les méthodes
employées. Le réveil des consciences se conjugue avec l’impopularité croissante
du gouvernement. La chaîne de solidarité se met en place (établissements
religieux, écoles, pensionnats, orphelinats, familles). 45 000 enfants de moins de
15 ans ont ainsi échappé à la mort. Grâce à cette protection au sein de la
population, les trois quarts des Juifs de France ont pu être soustraits à la
« solution finale ».
Résumé d’un article de François et René Bédarida

HISTORIOGRAPHIE DE LA DEPORTATION DES JUIFS DANS LE
DEPARTEMENT DE L’AUBE
Pour commencer à présenter le sujet difficile de la déportation des juifs du
département de l’Aube, une première remarque s’impose. L’histoire du génocide
est désormais bien connue dans sa globalité grâce en particulier aux recherches
et publications de Serge Klarsfeld ou d’Annette Wieviorka, grâce également
à une multiplication des œuvres cinématographiques (Shoah de Claude
Lanzmann restant la référence). Mais il faut constater que les études sur la
déportation des juifs à l’échelle locale ou départementale, même si elles tendent
à se développer, ne sont pas encore très nombreuses. De même, il est tout à fait
étrange de constater que le soixantième anniversaire de la libération des
camps donne lieu à bien plus de publications, de documentaires, de cérémonies
que lors du cinquantième anniversaire. Comme si un dernier tabou avait sauté.
En parallèle, les propos antisémites et les réflexions négationnistes les plus
choquantes se multiplient. Au-delà du devoir de mémoire, ce dossier a donc
pour but de rapporter les faits historiques qui montrent l’étendue de la
déportation dite raciale dans notre département, et de montrer à nos
collégiens, lycéens, étudiants, à tous les citoyens qui se sentent concernés par ce
sujet, que le processus d’arrestation puis de déportation des Juifs s’est ancré
dans des lieux aubois, villages, villes qui nous sont familiers. Lorsqu’on évoque
les Hauts Clos, les Troyens reconnaissent le nom de leur hôpital public, bien peu
savent qu’il a servi de centre d’internement aux Juifs (et à ceux accusés de
collaboration en 1944-1945), si on évoque Clairvaux, on pense volontiers aux
restes de la prestigieuse abbaye médiévale ou plus récemment à une prison
connue pour ses tentatives d’ évasion, mais peu de personnes savent qu’on y a
interné des Juifs pendant la guerre en prélude à leur déportation…
Méthodologie
En Champagne-Ardenne, en contrepoint à ce que nous écrivons plus haut, on
bénéficie du travail remarquable de Jocelyne Husson sur La Déportation des
juifs de la Marne. Son ouvrage réédité en 2001 peut servir à bien des titres de
modèle. Cette historienne a confronté toutes les sources possibles, "mémoire de
la pierre", sources contenues dans les archives nationales, départementales et
municipales. Elle a pu bénéficier des archives personnelles de Serge Klarsfeld et
a dépouillé les archives du Centre de documentation juive. Prolongeant son
travail d’histoire par un travail de mémoire, elle a également recherché les
quelques rares documents personnels, lettres, photographies, qui n’ont pas
sombré dans la destruction.
On trouvera ici une liste des Juifs arrêtés et déportés depuis le département
de l’Aube qui s’appuie autant que possible sur la méthodologie développée par
Jocelyne Husson, mais qui ne prétend pas être aussi exhaustive. Il faut l’avouer,
beaucoup de questions restent en suspens, faute d’archives et de
témoignages, il faudrait continuer la recherche dans de nombreuses directions
que nous n’aborderons pas ici : la vie quotidienne de 1940 à 1942 sous la
coupe des lois antisémites ( des interdictions professionnelles au port de l’étoile
jaune), l’étendue de la spoliation des biens, des logements et des entreprises,
le sort des enfants, l’organisation des centres d’internement aubois, les
réactions des populations non juives face aux rafles… Notre étude a d’abord
pour ambition d’établir une liste des victimes la plus complète possible et
de servir de point d’appui pour un approfondissement ultérieur. Elle appellera
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%