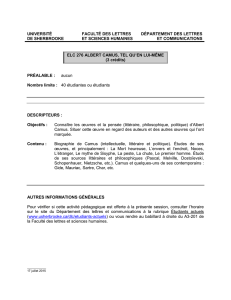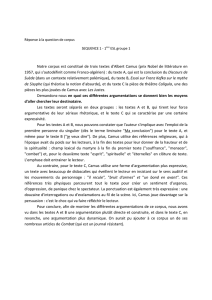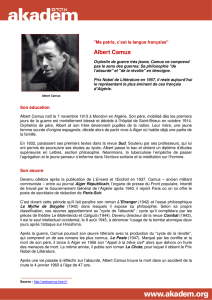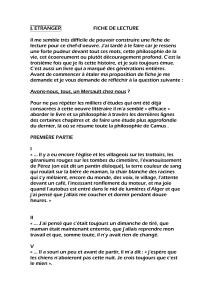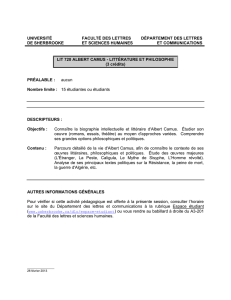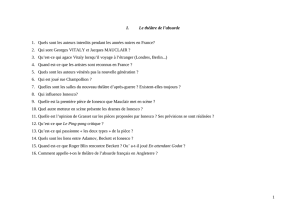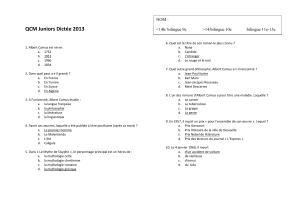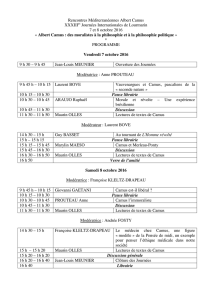Albert Camus contre le totalitarisme: une pensée de la mesure

A
LBERT CAMUS est un penseur de la modération, du juste milieu, de la recherche
de l’équilibre, des intermédiaires, des limites, des médiations. «L’action révoltée
au then tique, écrit-il dans L’Homme révolté, ne consentira à s’armer que pour des
institutions qui limitent la
violence, non pour celles qui la
codifient»[1]. Il ne pouvait donc
plaire – si tant est qu’il l’eût
voulu – à certains de ses contem-
porains, parmi les intellectuels les
plus en vue, dont la radicalisation
lui était étrangère. Francis Jeanson
d’ailleurs, en l’occurrence porte-
parole du directeur des Temps
Modernes, après une lecture atten-
tive (et en fait partielle et partiale)
de L’Homme révolté, répudie
Camus en écrivant ceci: «[…] à
mes yeux, tout se passe comme si
Camus était pour lui-même en
quête d’un refuge, et s’efforçait
par avance de justifier ici un éven-
tuel “décrochage”, une évasion
vers quelque définitive retraite où
se vouer enfin aux délices révol-
LES JOURNÉES SOUVARINE 2010
Albert Camus contre le totalitarisme:
une pensée de la mesure
par Stephen Launay *
DOSSIER
N° 43
79
* Politiste, Université de Paris Est.
1. Nous citons l’édition Gallimard/Folio de 2010 (1re éd. Gallimard, 1951) p. 364.
© Robert Edwards
Albert Camus en 1957
079-088-Launay-10P:H&L-dossier 23/09/10 17:18 Page79

tées d’une existence sans histoire»[2]. Camus ne pouvait pas être plus voué aux gémonies
que par cette accusation de désengagement, mêlant subrepticement (ou de façon
perverse) une interprétation (fallacieuse) du livre et une accusation personnelle, en un
style qui sera aussi celui de Sartre en août de la même année.
Situation
Nous allons voir qu’il n’a pas voulu s’échapper de l’histoire mais en prendre la mesure…
et la démesure, et qu’il a en ceci de profonds points communs avec de grands libéraux
français, en particulier avec Constant et sa théorie des principes intermédiaires, mais
aussi avec son contemporain José Ortega y Gasset.
Cette position permet de comprendre – il s’agit bien de comprendre et non d’expli-
quer, ni moins encore de transformer, suivant en cela la conception camusienne de la
connaissance, tout en nuances, qui parcourt ses premiers beaux textes rassemblés dans
Noces – la place que prit Camus dans ce qu’on peut appeler la querelle du totalitarisme.
Cette querelle s’ouvre à la fin des années 1920 et dans les années 1930 surtout, mais
prend toute son ampleur après la Seconde Guerre mondiale, avec la publication des
textes d’Aron sur «les religions séculières» en 1944, puis surtout avec celle des Origines
du totalitarisme de Hannah Arendt la même année que celle de L’Homme révolté (1951),
avec aussi celle de Leo Strauss sur la tyrannie, Aron apportant de nouveau sa pierre à
l’édifice en 1955 avec L’Opium des intellectuels.
Le grand problème auquel s’attelle Camus dans son ouvrage de 1951 est celui de la
«religion de l’histoire», qui s’est esquissée au XVIIIesiècle et développée au XIXepour
porter le meurtre au rang d’une obligation absolue au XXesiècle.
Il y a chez notre auteur une horreur du nihilisme contemporain – nihilisme dont il
fait la généalogie – à laquelle il répond par une morale de l’incertitude, de l’approxima-
tion («La pensée approximative est seule génératrice de réel» écrit-il dans L’Homme
Révolté)[3], de la prudence, exprimant le rôle qu’il confère à l’intellectuel, rôle qui n’est
certainement pas pour lui celui d’un engagement tous azimuts sous prétexte de respon-
sabilité illimitée, à la manière de Sartre. Examinons donc ces quelques points: l’Histoire
divinisée, la nécessité morale de la mesure, et condition – ce sera le troisième point –
d’une définition au plus juste du rôle de l’intellectuel.
HISTOIRE &LIBERTÉ
2. L’article de Jeanson puis la lettre de Camus, la réponse de Sartre et le commentaire de Jeanson furent publiés
dans Les Temps Modernes, en mai 1952 pour le premier et en août 1952, pour les autres.
3. L’Homme révolté, p. 170-171 essentielles, plus «les déicides» p. 173.
80
OCTOBRE 2010
079-088-Launay-10P:H&L-dossier 23/09/10 17:18 Page80

L’histoire divinisée
Nous avons mentionné la hauteur, voire le mépris qu’exprimait Jeanson en 1952 pour la
pensée de Camus. Pour Jeanson en effet, la protestation de Camus est «trop belle, trop
souveraine, trop sûre d’elle-même, trop accordée à soi» et Camus joue le «pur esprit» qui
s’oppose donc, nous nous en doutions, à la «conscience située» que défend l’entourage de
Jeanson.
Mais contre quoi Camus proteste-t-il? Allons directement au cœur du problème, et
dans ce dessein, citons Camus lui-même: «Dès l’instant où les principes éternels seront mis
en doute en même temps que la vertu formelle, où toute valeur sera discréditée, la raison se
mettra en mouvement, ne se référant plus à rien qu’à ses succès. Elle voudra régner, niant
tout ce qui a été, affirmant tout ce qui sera. Elle deviendra conquérante. Le communisme
russe, par sa critique violente de toute vertu formelle, achève l’œuvre révoltée du XIXesiècle
en niant tout principe supérieur […]. Le règne de l’histoire commence et, s’identifiant à sa
seule histoire, l’homme, infidèle à sa vraie révolte, se vouera désormais aux révolutions nihi-
listes du XXesiècle qui, niant toute morale, cherchent désespérément l’unité du genre
humain à travers une épuisante accumulation de crimes et de guerres».
Voici qu’apparaissent «les révolutions cyniques, qu’elles soient de droite ou de gauche»,
fondées sur «la religion de l’homme». Et cette conclusion lapidaire: «Tout ce qui était à
Dieu sera désormais rendu à César»[4].
Sont ici présents les principaux éléments de l’idéologie totalitaire, donc de ce que, au
même moment, Arendt désigne comme la mise en branle de «la logique d’une idée» qui
arase le réel et d’abord l’humanité.
Pour Camus, la divinisation de l’histoire est la suite logique de celle de l’homme. Le
problème vient de ce que, toute valeur étant discréditée, la raison se nie elle-même comme
raisonnable, en justifiant son propre mouvement – seulement son mouvement – par une
divinité creuse, l’Histoire, qui n’a de correspondance avec le réel que dans l’action répétée
indéfiniment. Mais il s’agit d’une action particulière, dont le trait spécifique est d’être ce que
le penseur espagnol José Ortega y Gasset nomma en 1930 «l’action directe»: action qui n’a
plus de raison(s), qui ne donne pas ses raisons mais dont la nature est seulement de s’im-
poser. Ortega y Gasset la distingue (dans La Révolte des masses) de «l’action indirecte»,
action de la raison civilisée qui trouve des médiations pour s’affirmer et qui ne s’affirme
pleinement que dans le dialogue.
« L’action directe» d’Ortega y Gasset semble donc la manifestation apparente de ce que
Camus nomme «le nihilisme», produit d’un hégélianisme tordu, voire torturé, et qui
aboutit, comme on le lit dans L’homme révolté, à ce que «les philosophes de la dialectique
ALBERT CAMUS CONTRE LE TOTALITARISME: UNE PENSÉE DE LA MESURE
4. Ibid.
N° 43
81
DOSSIER
079-088-Launay-10P:H&L-dossier 23/09/10 17:18 Page81

incessante ont remplacé les harmonieux et stériles constructeurs de la raison». La pensée
totalitaire délaisse ici un aspect de l’hégelianisme qui «a voulu être l’esprit de la réconcilia-
tion». En oubliant que «tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel»,
la voie est ouverte à la justification de «toutes les entreprises de l’idéologue sur le réel.»[5]
Le nihilisme individuel du «tout est permis» s’accomplit alors, selon Camus, dans le
«chigalévisme». Chigalev, le philanthrope des Possédés, soutient l’entreprise nihiliste jusqu’à
son extrême pointe: le terrorisme d’État. Camus le nomme aussi «socialisme scientifique»,
«société militaire», «despotisme illimité», empruntant cette expression au personnage cité.
Le lien entre le socialisme individuel et le socialisme militaire (ce dernier refusant et
niant le premier) se fera par une aspiration folle à l’égalité qui ne peut se réaliser qu’avec
l’arme ultime du désespoir: «Parti de la liberté illimitée, dit Chigalev, j’arrive au despotisme
illimité.»[6] La «totale dictature» (expression de Camus) devient un passage obligé. Et Camus
de diagnostiquer: «C’est le gouvernement des philosophes dont rêvaient les utopistes,
simplement ces philosophes ne croient à rien».
On a voulu diviniser l’homme et on est arrivé à le soumettre totalement. «Illimitation»,
«démesure», «totalitaire» – et toutes les expressions voisines – vont dorénavant revenir
comme des litanies sous la plume de notre auteur. Et même s’il fait des distinctions entre
nazisme et communisme (le premier réalisant la folie la plus extrême), le fait que Camus en
montre la généalogie amorale et les développements communs nous permettent de
comprendre le grand intérêt que Arendt porta à la réflexion de cet intellectuel qu’elle consi-
dérait comme le meilleur de son époque en France, littéraire comme elle et, dans une
certaine mesure, bouillonnant comme elle l’était.
Nous en arrivons à présent au terrorisme d’État. Si Camus énonce des différences entre
communisme et nazisme dans le style d’Arendt, il faut souligner une nuance de taille qu’il
pose entre Mussolini et Hitler: «Mussolini, écrit-il, juriste latin, se contentait de la raison
d’État qu’il transformait seulement, avec beaucoup de rhétorique, en absolu.» Autrement dit,
Mussolini n’a pas fait table rase du passé; il n’a pas tout à fait supprimé quelque chose qui
s’approche de ce que Camus appelait «la vertu formelle». Il ne s’agit pas de dire que
Mussolini conserve une sorte de morale des Antiques mais que, dans son comportement il
conserve des aspects de la politique traditionnelle: son machiavélisme le sauve de l’absolue
illimitation national-socialiste. La raison d’État est en effet un principe ou une doctrine d’ac-
tion qui vise à défendre les intérêts de l’État tels que conçus par ses dirigeants. La raison
d’État peut alors aboutir à une transgression des normes publiques et constitutionnelles,
mais elle constitue aussi, dans le même temps, un principe de délimitation puisqu’elle
s’aligne sur une rationalité politique: celle des intérêts de l’État ou des intérêts nationaux.
HISTOIRE &LIBERTÉ
5. Op. cit., p. 175.
6. Ibid., p.224.
82
OCTOBRE 2010
079-088-Launay-10P:H&L-dossier 23/09/10 17:18 Page82

Pour Camus, l’Allemagne hitlérienne est allée beaucoup plus loin. Il écrit: «L’Allemagne
hitlérienne a donné à cette fausse raison [la raison d’État] son vrai langage qui était celui
d’une religion»[7]. Camus laisse ici glisser sa plume en suggérant que la raison d’État est par
définition illimitée. Mais l’essentiel est qu’il nous conduise au cœur de l’irrationalité nazie.
Citons-le: «Les crimes hitlériens, et parmi eux le massacre des Juifs, sont sans équivalents
dans l’histoire parce que l’histoire ne rapporte aucun exemple qu’une doctrine de destruc-
tion aussi totale ait jamais pu s’emparer des leviers de commande d’une nation civilisée. Mais
surtout, pour la première fois dans l’histoire, des hommes de gouvernement ont appliqué
leurs immenses forces à instaurer une mystique en dehors de toute morale. Cette première
tentative d’une Église bâtie sur un néant a été payée par l’anéantissement lui-même»[8].On
voit ici que la morale camusienne repose sur un fondement chrétien raisonné – et raison-
nable d’ailleurs.
L’important est que Camus ait distingué la raison d’État mussolinienne et ce qu’il
nomme «la rage démesurée de néant» du nazisme.
La spécificité du «communisme russe» (expression la plus neutre qu’il emploie pour
désigner le phénomène) tient alors en ce que le communisme «prétende ouvertement à
l’empire mondial»[9], ce qui passe par l’exercice d’une «terreur rationnelle» et non plus irra-
tionnelle comme dans le cas du fascisme. Marx n’est d’ailleurs pas exempt de toute responsa-
bilité – pour ne pas dire de culpabilité – dans l’avènement du communisme (on retrouve ce
thème sous la plume d’Aron en 1977 dans Plaidoyer pour l’Europe décadente). Et, même si
Camus reconnaît que les évocations par Marx du communisme sont assez diffuses et impré-
cises, il discerne chez lui «une notion mystique» qui perturbe «une description qui se veut
scientifique»[10]. Cette «notion mystique» tient en la «disparition finale de l’économie poli-
tique [qui] signifie la fin de toute douleur ».
La manière de Camus de retourner le marxisme contre lui-même est assez intéressante
pour qu’on y soit attentif. En effet, à l’entendre, la dialectique marxienne[11], donc la dialec-
tique que Camus nomme «appliquée» pour la distinguer de celle de Hegel, n’a aucune
raison de s’arrêter, sauf à introduire «un jugement de valeur venu du dehors»[12]. En effet, la
dialectique, par elle-même, suscite toujours un nouvel antagonisme: après la société féodale,
la société capitaliste qui lui est supérieure; puis à la société de classes succédera une société
sans classes; «mais, dit Camus, animée par un nouvel antagonisme, encore à définir».
Autrement dit, il faut prendre la dialectique au sérieux… si l’on ne veut pas se moquer du
ALBERT CAMUS CONTRE LE TOTALITARISME: UNE PENSÉE DE LA MESURE
7. Op. cit., p.233.
8. Op. cit., p.235.
9. Op. cit., p.238.
10. Op. cit., p.280.
11. C’est-à-dire de Marx: Camus ne distingue pas les adjectifs «marxien» et «marxiste».
12. Op. cit., p. 221.
N° 43
83
DOSSIER
079-088-Launay-10P:H&L-dossier 23/09/10 17:18 Page83
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%