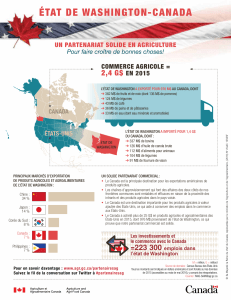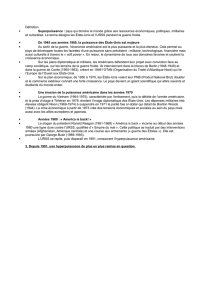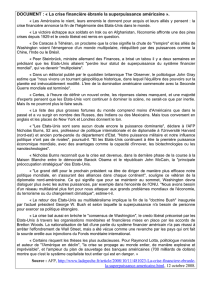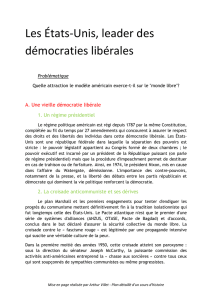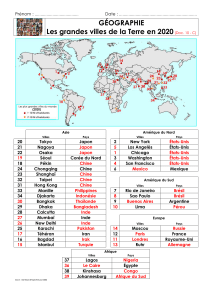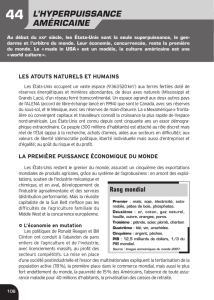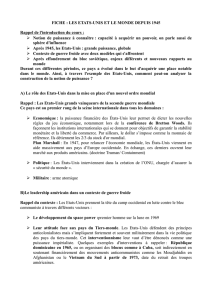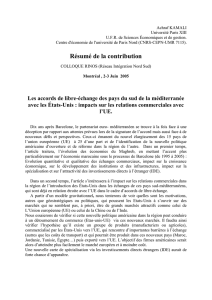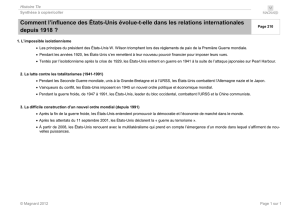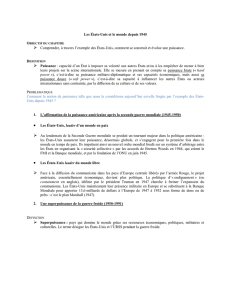Quelle évolution de la notion de puissance et de ses modes d

Quelle évolution de la notion de puissance
et de ses modes d’action à l’horizon 2030,
appliquée aux États-Unis, à l’Europe et à la Chine ?
Par Barthélémy COURMONT, Valérie NIQUET et Bastien NIVET
chercheurs à l’IRIS
Etude réalisée pour le compte
de la Délégation aux Affaires Stratégiques
selon la procédure du marché public passé selon une procédure adaptée n°2004/007

2
Sommaire
Introduction 4
Chapitre I :
L’évolution de la notion de puissance et de ses modes d’action 7
I. La puissance et ses modes d’action : perspectives historiques et théoriques 8
A. La puissance: émergence d’une notion clé accompagnant la naissance
des relations internationales comme discipline et objet scientifique 8
B. La puissance : capacité des États 10
C. La puissance et ses modes d’action 15
D. Les critères de puissance 18
II. La notion de puissance dans un environnement post-Guerre froide 23
A. De la superpuissance à la notion d’hyperpuissance 24
B. Entre unilatéralisme et soft power 26
III. L’exercice de la puissance dans un environnement post-11 septembre 28
A. Une vision stratégique à Washington qui influence la notion de puissance 29
B. La sécurité comme nouvel enjeu de puissance 32
Chapitre II :
Les États-Unis et la Chine 37
I. Les États-Unis 37
A. Entre « nation indispensable » et « wilsonisme botté » 39
B. Les débats sur l’unilatéralisme américain 44
C. Une notion de puissance en quête de définition 48
D. Une notion évolutive face à un environnement changeant 52

3
II. La Chine 59
A. Les critères de la puissance chinoise 62
B. Les stratégies de mise en œuvre de la puissance chinoise 65
Chapitre III :
L’Union européenne, puissance à l’horizon 2030 ? 71
Introduction : Comment pesner l’Union européenne comme puissance ? 71
I. L’Europe et la puissance : émergence d’un objet politique et
difficultés conceptuelles 72
A. L’Europe et la puissance, une contradiction originelle ? 73
B. Impuissance des nations, puissance de l’Union ? 75
C. Les déterminants de l’évolution de la puissance de l’Union européenne 79
II. Quelle puissance pour l’Union européenne à l’horizon 2030 ?
Un champ des possibles 82
A. L’Union européenne, pôle d’influence passif,
ou le renoncement à la puissance 82
B. La stratégie de niche, ou l’Union européenne présence intermittente 89
C. L’Union européenne, puissance kantienne, entre puissance civile
et puissance militaire de basse intensité 91
D. L’Union européenne, puissance globale 98
Conclusion 102
Repères bibliographiques 106

4
Introduction
Traditionnellement au cœur de la réflexion sur les relations internationales, la notion
de puissance est généralement utilisée pour tenter d’évaluer les capacités d’action des États,
voire d’en établir une hiérarchisation.
L’école classique - ou ‘réaliste’ - des relations internationales envisage en particulier
la puissance comme « la capacité d’un acteur d’imposer sa volonté aux autres1 », dans un
système international dont les États sont les acteurs dominants et leurs interactions les
phénomènes structurants. La notion de puissance apparaît donc comme étant relative, puisque
son exercice concerne des rapports entre acteurs et non de simples données brutes. Cette
lecture quelque peu rigide des relations internationales et de la notion de puissance a fait
l’objet de redéfinition et/ou d’approfondissement conceptuels utiles pour l’observateur ou
l’acteur des relations internationales.
Joseph Nye a par exemple proposé au début des années 1990 la distinction entre le
Hard power et le Soft power2, (re)mettant en évidence le caractère multiforme de la notion de
puissance et de ses modes d’exercice en soulignant que les critères classiques les plus visibles
(les capacités politico-militaires), n’étaient pas les seuls à prendre en compte.
Les capacités militaires ont certes été le premier critère de puissance utilisé dans
l’analyse des rapports de puissance internationaux3, aux côtés de critères tels que le territoire,
les ressources naturelles ou la démographie, ces derniers étant considérés essentiellement sous
le prisme des avantages militaires potentiels qu’ils pouvaient apporter. Cette primauté du
militaire dans les rapports entre États et dans la hiérarchisation de ces derniers est aujourd’hui
en partie remise en cause : l’URSS, qui était l’une des deux premières puissances militaires au
1 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calman-Lévy, 1962, pp.16-17.
2 Joseph S.Nye, Bound to Lead, the Changing Nature of American Power, New-York, Basic Books, 1990.
3 Dans un chapitre du Prince consacré au moyen de mesurer la puissance de chaque principauté, Nicolas
Machiavel retient en effet comme critères l’importance des forces armées, les atouts/capacités matériels, les
disponibilités financières, le talent militaire, le moral des troupes et de la population, etc. Si l’on excepte
l’Histoire de Thucydide, Nicolas Machiavel est traditionnellement considéré comme le premier auteur de l’école
réaliste des relations internationales.

5
monde jusqu’à la fin de la décennie 1980, s’est effondrée faute de cohésion économique,
politique et sociale. Si les capacités militaires restent un critère de puissance primordial, elles
ne sont pas le seul. En particulier, la puissance économique et la maîtrise technologique, sont
aujourd’hui souvent mises en avant comme des critères de plus en plus pertinents. La
mondialisation et la fin de la bipolarité semblent de fait inviter une nouvelle fois à une
relecture de la notion de puissance tenant davantage compte de la complexité des interactions
entre acteurs (États ou non) des relations internationales. De nouveaux critères de puissance
semblent ainsi prendre de l’importance, tels la maîtrise du savoir et de l’information, le niveau
d’éducation ou le rayonnement culturo-linguistique, dont l’appréciation et l’évaluation –
qualitative comme quantitative – semblent néanmoins beaucoup plus incertaines que dans le
cas de critères classiques comme les capacités militaires.
De même, si les puissances ne peuvent s’exprimer de façon indépendante, et doivent
en conséquence tenir compte de systèmes d’alliances et de partenariats, la question de
l’intervention a fait, depuis la fin de la Guerre froide, l’objet de nombreuses interrogations, en
particulier aux États-Unis. S’interrogeant sur les contraintes imposées au fort, certains experts
tel Richard Haass, aujourd’hui conseiller au Département d’État, ont ainsi posé la question de
l’internationalisme, et du statut de Washington en tant que « nation indispensable », répondant
ainsi aux souhaits de Bill Clinton4. Plus récemment, tandis que la diplomatie américaine
faisait l’objet de critiques de la part de certains partenaires européens, l’éditorialiste Robert
Kagan a proposé une lecture néoconservatrice de la puissance et de la faiblesse, justifiant le
« wilsonisme boté » de l’administration Bush, qui voit en l’Amérique un acteur
incontournable des relations internationales, et n’exclut pas une forme d’unilatéralisme pour
garantir le succès de valeurs démocratiques5. Sans doute plus kantien qu’hobbesien, le
mouvement des néoconservateurs américains voit dans les États-Unis une puissance investie
d’une mission particulière, et porteuse de valeurs vertueuses et universelles, telles que les
avait déjà imaginées le philosophe prussien.
Enfin, les événements récents nous rappellent que les puissances trouvent souvent
dans des acteurs asymétriques leurs adversaires les plus coriaces, car susceptibles de remettre
en cause leur leadership, et de provoquer une crise de la représentativité au sein même de
leurs sociétés. Ainsi, à horizon 2030, doit-on considérer que les plus préoccupantes menaces
pour les grandes puissances seront-elles d’autres puissances ou, au contraire, des acteurs
faibles trouvant refuge dans des zones grises ?
4 Richard Haass, The Reluctant Sheriff, Washington DC, Council on Foreign Relations Books, 1997.
5 Robert Kagan, La puissance et la faiblesse, Paris, Plon 2003 (pour la traduction française).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
1
/
114
100%