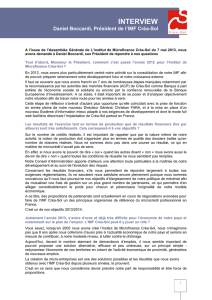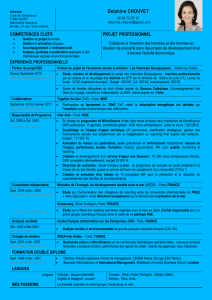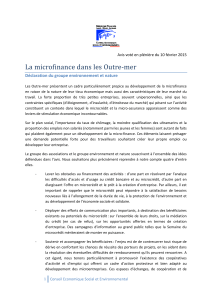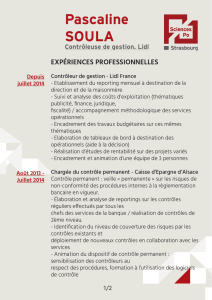Editorial Une microfinance massifiée mais en quête de sens

pI1
Editorial
Une microfinance massifiée mais en quête de sens - une opinion
DOMINIQUE LESAFFRE, Consultant ........................................................................................................... 5
Les limites de la microfinance et le rôle de la recherche
ISABELLE GUERIN, IRD/IFP (Inde) .......................................................................................................... 11
La gouvernance, noeud gordien de la microfinance ?
DOROTHÉE PIERRET ET FRANÇOIS DOLIGEZ, IRAM .................................................................... 17
Comment mal gérer une institution de microfinance ou le «top ten» des erreurs à
commettre !
CARLOS VASCONCELLOS ET SOLANGE MONTEIRO ....................................................................... 23
Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en place
de sociétés de microassurance
CGAP GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MICRO-ASSURANCE, ICMIF .......................................... 29
Mirage financier au cœur de la brousse : le cas PPPCR
FRANÇOIS ROSSIER, Université Catholique de Louvain la Neuve .............................................. 43
Année de la microfinance : l’overdose ou changer de concept
MARC ROESCH, IRD/IFP (Inde) ................................................................................................................ 53
Microfinance et démocratie : encore un mythe à déconstruire ?
ISABELLE GUERIN, IRD/IFP (Inde) .......................................................................................................... 59

ADA DIALOGUE, N°35, décembre 2005

pI3
Editorial
Comment mal gérer une institution de microfinance ? Quel est le «top ten»
des erreurs à commettre ? Quelles sont les mauvaises recettes pour mettre
en place une société de microassurance ? Voilà des titres «accrocheurs»,
qui attirent l’attention en cette fin d’année du microcrédit ! En effet, en
2005, on a plutôt entendu une autre voix, un discours plus lénifiant parant
le concept de microcrédit et mieux encore la microfinance de toutes les
vertus ! La lutte contre la pauvreté va désormais être «révolutionnée» grâce
à cet excellent outil qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde,
au Sud comme au Nord, à l’Ouest comme à l’Est. Pour faire bref et comme
le dénonce Isabelle Guerin, « la microfinance serait capable de réduire la
pauvreté, promouvoir l’émancipation des femmes, favoriser l’éducation des
enfants et l’accès aux services de santé, tout en faisant preuve de rentabilité ».
Un
rêve en quelque sorte pour ceux qui s’occupent du développement depuis
plusieurs décennies ! C’est plutôt aller vite en besogne que de tenir un
discours aussi simpliste.
Revenons sur une question souvent débattue dans le cénacle microfinancier :
fonds publics / fonds privés, quelle approche privilégier pour développer
le secteur ? Par un bon dosage de ces deux types de ressources, toujours
activement recherchées d’ailleurs par les meilleures IMF. En effet, méfions
nous des pensées maximalistes et restons réalistes. L’illusion suprême, celle
qu’il faut éviter à tout prix, serait d’imaginer que seuls les investisseurs
privés sont aujourd’hui capables de « booster » le secteur et en référence au
nombre de nouveaux fonds d’investissement dédiés en partie ou en totalité
à la microfinance annoncés en 2005, on dirait que ce message constitue
désormais l’air du temps. Or, au-delà des effets d’annonce promettant monts
et merveilles aux investisseurs - on lutte contre la pauvreté, on développe le
marché et par la même occasion, on se donne bonne conscience, on relève
par contre très peu de débats sur la capacité d’absorption de toute cette
manne destinée aux IMF. Comme si cela allait de soi que tout offreur trouve
rapidement ou dans un délai raisonnable un preneur. Halte aux Fonds a-t-on
envie de crier fin 2005 ! Des nouvelles ressources sont certes nécessaires
mais ce n’est pas suffisant pour en faire un secteur durable. Quelle institution

pI4
ADA DIALOGUE, N°35, décembre 2005
peut en effet gérer sans accrocs du jour au lendemain un doublement de
son portefeuille de crédit ? Et dans les marchés très concurrentiels, quel
impact sur le niveau d’endettement des microentrepreneurs ? Il faudra donc
rester attentif à ce genre de phénomène après 2005. Enfin, pour chaque
fonds actif en microfinance, avoir une idée plus précise des ressources
réellement allouées aux IMF, sous forme de prêt, de garantie ou de prise
de participation, par rapport au total des ressources disponibles et des
placements bancaires effectués permettrait d’avoir une idée plus précise de
cette capacité et de la rapidité d’absorption du secteur. Encore faut-il avoir
accès à cette information ?
Pour en revenir à ce Dialogue qui rassemble une série d’avis ou d’opinions
sur la question et que nous avons intitulé «La microfinance à voix basse»,
nous sommes partis de l’idée communément admise aujourd’hui que la
connaissance des échecs, des faillites, des « non success stories » en
microfinance ou dans d’autres domaines est tout aussi importante que les
succès ou les réussites. Connaître et comprendre ce qui n’a pas marché est
tout aussi intéressant que « les bonnes pratiques ». Parfois, cela permet
même d’aller plus vite, de gagner du temps. Or, force est de constater que
les échecs en microfinance sont encore très peu relatés et documentés. N’y
a-t-il pas là aussi un manque de transparence au niveau de tous les acteurs ?
Luc Vandeweerd
ADA

pI5
Une microfinance massifiée
mais en quête de sens -
une opinion
DOMINIQUE LESAFFRE, CONSULTANT
Améliorer le contrôle interneAméliorer le contrôle interne
Le micro-crédit ou la microfinance ont fait beaucoup parler d’eux cette année.
Comme pour d’autres phénomènes, ceux qui y travaillent depuis longtemps
continueront après la vague, probablement stimulés par elle. Les autres,
incidemment ceux qui auront fait le plus de bruit cette année, attendront après
le reflux de se coller à une nouvelle vague thématique…
Le développement spectaculaire de la microfinance depuis deux décennies dans
les pays du Sud, et plus récemment dans ceux anciennement de l’Est, s’explique
par la combinaison de plusieurs facteurs :
• Les programmes d’ajustement structurel (PAS) ont réduit l’envergure de
l’emploi public ;
• La faiblesse de la rémunération de l’activité agricole amplifie les phénomènes
migratoires et notamment l’exode rural continu qui concentrent dans les
(grands) centres urbains une population à la recherche de services (y compris
de services financiers) ;
• La pression démographique des pays du Sud a généré une demande
croissante d’auto-emploi et amené les populations pauvres à développer par
elles-mêmes des activités qui génèrent les revenus suffisants pour faire vivre
les familles ;
• Les réductions ou la complexification de l’aide par subvention a réduit l’accès
à des ressources non liées à des obligations.
En conséquence, la majorité de la population mondiale appartient désormais à ce
que l’on appelle le secteur non structuré (ou secteur informel). Ces personnes,
organisées collectivement ou non perçoivent maintenant clairement que leur
subsistance d’abord et leur développement ensuite dépend de leurs propres
capacités d’insertion et d’entreprise individuelle ou collective. Pour répondre à
cet état de fait, elles ont besoin d’accéder à des services financiers de proximité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
1
/
66
100%