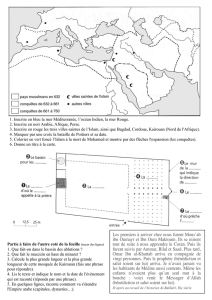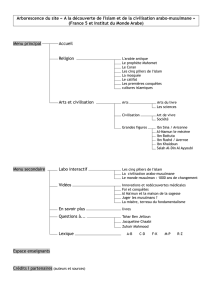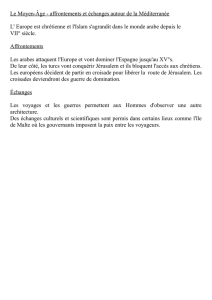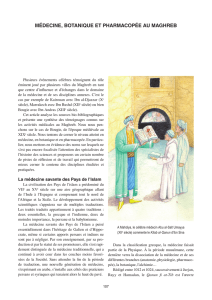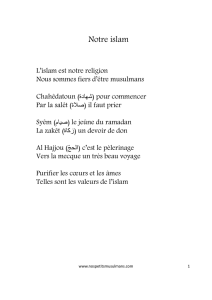Islam d`interdits, Islam de jouissances, La recherche face aux

UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE-PARIS IV
ISLAM D’INTERDITS, ISLAM DE JOUISSANCES
La recherche face aux représentations courantes de la sexualité
dans les cultures musulmanes
Recherche inédite en vue de l’Habilitation à Diriger la Recherche (H.D.R.)
présentée par :
Frédéric LAGRANGE
Directeur de recherche :
Abdallah CHEIKH-MOUSSA
Jury composé de :
Abdallah CHEIKH-MOUSSA (Professeur des Universités, Paris Sorbonne-Paris IV)
Jocelyne DAKHLIA (Directeur d’études, EHESS)
Luc-Willy DEHEUVELS (Professeur des Universités, INALCO)
Ludvik KALUS (Professeur des Universités, Paris Sorbonne-Paris IV)
Everett K. ROWSON (Associate Professor, New York University)
Katia ZAKHARIA (Professeur des Universités, Lyon 2)
Année universitaire 2007-2008

Introduction ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1- Les corps et la foi
1-1 L’institution des genres ------------------------------------------------------------------------------------ 21
1-2 Plaisirs de l’au-delà ----------------------------------------------------------------------------------------- 29
1-3 La police des corps : masculinité et féminité ----------------------------------------------------------- 41
1-4 Failles du genre : efféminés, travesti(e)s et eunuques ------------------------------------------------ 80
2- La gestion des désirs : lois, transgressions et pratiques sociales ----------------------------------- 98
2-1 Plaisirs licites d’ici-bas : mariage, polygamie, concubinage --------------------------------------- 102
2-2 Sexualité illicite : adultère et fornication -------------------------------------------------------------- 127
2-3 Le crime du peuple de Loth ------------------------------------------------------------------------------ 135
2-4 La sexualité féminine source de désordre ? ----------------------------------------------------------- 144
2-5 La séparation des sexes: voile, réclusion, harem ----------------------------------------------------- 153
2-6 Deux enjeux de la « modernité islamique » : visibilité de la femme et hétéronormalisation -- 175
3- Discours alternatifs de l’Islam : médecine, littérature savante, expressions populaires ----- 195
3-1 Médecine et sexualité ------------------------------------------------------------------------------------- 196
3-2 Le modèle littéraire de la passion ----------------------------------------------------------------------- 201
3-3 La littérature comme espace de transgression -------------------------------------------------------- 215
3-4 La littérature moderne et le tabou de la sexualité ---------------------------------------------------- 230
Epilogue --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237
Bibliographie --------------------------------------------------------------------------------------------------- 242
1

translittération :
Arabe : consonnes et glides : ', b, t, th, j (sauf dans les noms propres égyptiens du XIXe et XXe siècle, g), ḥ, kh,
d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ‘, gh, f, q, k, l, m, n, h, w, y.
voyelles longues et brèves : â, û, î ; a, u, i. ê et ô pour les dialectes utilisant ces phonèmes.
Turc et persan : les translittérations suivent les sources consultées et sont standardisées pour les noms propres à
partir de l’Encyclopédie de l’Islam. Quand des sources en caractères arabes ont été consultées, les voyelles
longues ont été marquées.
traductions :
Les traductions de l’arabe et de l’anglais sont toutes de l’auteur, sauf indication contraire. Les traductions du
turc et du persan sont indirectes, effectuées à partir des traductions anglaises consultées. Les formules pieuses
suivant la mention de Dieu, d’un prophète, ou des compagnons de Muḥammad, de type Sur lui la prière et le
salut, ont été retirées des traductions du ḥadîth afin d’alléger le texte.
références bibliographiques :
- sources primaires classiques : L’édition de référence est indiquée en bibliographie. Seul le titre est signalé (ex.
Aghânî = Abû l-Faraj al-Iṣfahânî, Kitâb al-Aghânî) pour certains ouvrages courants. Quand l’édition consultée
est la version électronique du site internet http://www.alwaraq.com, la référence est indiquée comme suit :
[alwaraq XX], XX représentant la page. Pour les ouvrages de tafsîr coranique et les six collections canoniques
de ḥadîth, une version électronique a été systématiquement utilisée, en raison de la sûreté de ces versions et de
l’uniformité des références ; seule la mention de sourate et de verset est indiquée pour l’exégèse, seul l’ouvrage,
le numéro de la tradition et le chapitre est indiqué pour le ḥadîth.
- sources modernes : l’édition de référence figure en bibliographie. Pour les sources souvent citées, seuls
l’auteur et la date sont mentionnés.
- Encyclopédie de l’Islam : l’édition utilisée est la version sur CD-ROM ainsi que l’édition en ligne de
Encyclopaedia of Islam, [seconde édition] Leiden, Brill, 2003-2007. Le texte anglais est traduit en français par
l’auteur. Les références suivent ce modèle : Auteur(s) de l’article, “titre de l’article”, EI2. Les articles
actuellement en ligne de la troisième édition n’ont pas été utilisés.
Mes plus profonds remerciements sont adressés à A. Cheikh-Moussa et J. Dakhlia pour l’aide
permanente apportée au cours de la rédaction de ce travail.
2

«C’est cela que les musulmans n’osent clamer : que pour l’Islam, l’individu ne peut
pas disposer de son corps comme il veut, manger ce qu’il veut, faire ce qu’il veut»1.
«Comme l’Islam détermine toutes les facettes de la vie sociale et personnelle du
musulman, du moins en théorie, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’Islam donne aussi
des instructions sexuelles au vrai croyant. Ces instructions se fondent sur le Coran,
ainsi que des propos et des comportements que l’on prête au prophète Mahomet, les
Hadiths. En Europe, dès le 17esiècle, on décrivait l’Islam comme une religion
pornographique. Une association d'idée qui s’explique non seulement par
l’hédonisme de Mahomet – à qui l'on doit ces paroles célèbres: "Pour ce qui est des
affaires terrestres, j’aime les femmes et le parfum" – ainsi que par la sensualité des
descriptions coraniques du paradis, mais aussi par l’intérêt accordé à la sexualité
(masculine). Pour Mahomet, le sexe ne sert pas uniquement à la reproduction, mais
on peut en jouir à part entière – il autorisait d’ailleurs le coït interrompu comme
mode de contraception. Le 11 septembre 2001, de religion pornographique, l'Islam
est d'un coup devenu une religion terroriste. C'est un changement évidemment
regrettable»2
Les normes sexuelles des cultures musulmanes, à travers le temps et l’espace, sont actuellement
perçues, dans le discours généraliste de l’Occident tel qu’il se reflète dans la presse et les ouvrages de
vulgarisation, selon deux axes, à la fois antagonistes et complémentaires, mais tous deux également
essentialistes, statiques et totalisants. D’une part, un courant éditorial animé par une intention de
«réhabilitation» des cultures musulmanes, généralement représenté dans l’édition, dans la littérature
et le cinéma, dans un moindre degré dans la recherche académique. Ce courant affirme une forte
différence entre islam et christianisme : d’un côté exaltation des voluptés sexuelles, «constitutives des
conditions mondaines de la vie», sachant que la concupiscence qui accompagne l’amour est «une
manière de réaliser l’harmonique cosmique»3et d’assurer la survivance de la race humaine. La
jouissance en islam serait donc à la foi plaisir et devoir, à condition qu’elle se réalise dans les limites
de l’union licite. De l’autre côté, dans le christianisme, on ne trouverait que péché originel et haine de
la chair, exaltation du modèle monacal, valorisation de l’abstinence, et une moderne liberté sexuelle
conquise contre les Eglises. On construit donc le topos d’un «islam de jouissance», libéral en matière
de sexualité, non répressif, généralement situé en amont de l’histoire. Les tenants de ce courant se
basent sur une relecture contemporaine des textes classiques des littératures arabe, persane et
ottomane, et particulièrement sur l’érotologie et la poésie amoureuse ou transgressive, lectures parfois
hâtivement projetées sur le présent. Il s’agit de donner sa place à la civilisation musulmane dans ce
que ce courant perçoit comme d’universelles valeurs humanistes et libérales, en privilégiant dans le
legs millénaire de cette civilisation une image supposée attirante pour le public occidental post-
moderne.
Ce courant répond implicitement ou explicitement, par son entreprise de «banalisation» de l’islam
par le plaisir, à une autre tendance, illustrée le plus souvent par la presse mais aussi par des essais
polémiques, qui souligne, dénonce ou exemplifie quant à elle, tout à l’inverse, le puritanisme forcené
et l’enfermement identitaire que défendent aujourd'hui les courants activistes islamistes, les Etats
1. Anne-Marie Delcambre, L’Islam des interdits, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, p. 80.
2. Hafid Bouazza, DENG (Anvers), traduit dans Courrier International 738-9, 23 décembre 2004. Hafid
Bouazza est un romancier néerlandais d’origine marocaine, salué par la critique de son pays, et qui dans
certains de ses écrits de presse s’applique à illustrer par ses traductions de l’arabe la face érotique de la
civilisation arabo-musulmane. Dans le débat national hollandais, où la tolérance et la permissivité dans le
domaine des moeurs sont des valeurs senties comme constitutives de l’identité nationale, «l’islam
érotique» est clairement une stratégie d’intégration, H. Bouazza représentant une face souriante et
rassurante de l’immigration marocaine dans un pays frappé par l’assassinat de Theo Van Gogh
(02/11/2004).
3. Les deux citations sont tirées d’Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, Paris, PUF, 1975, p. 110.
3

autoritaires et les médias arabes ou des pays musulmans. Ces derniers sont effectivement souvent
prompts à réclamer une censure protégeant les «traditions» culturelles contre la «corruption morale»
importée d’Occident. Ce second courant éditorial, qui n’est pas nécessairement animé d’une intention
de dénigrement mais reflète parfois ses propres enjeux (presse féminine, presse homosexuelle), fait de
l’islam le lieu même de l’intolérance.
Ces deux visions sont bien évidemment les héritières des deux faces de l’altérité arabo-musulmane
construites à l’ère pré-coloniale, «face Galland4» ou peut-être plus exactement face Mardrus ou
Burton, d’après les deux principaux traducteurs respectivement français et anglais des Mille et une
nuits au XIXe siècle, contre «face Voltaire» ou «face Renan», qui voyait dans l’islamisme5«la
chaîne la plus lourde que l’humanité ait jamais portée». Renan ne parlait certes pas de rapport au
corps, mais de place de la raison et de système politique ; or, il est frappant de constater que le
discours de la dénonciation examine comment la violence est exercée contre le corps par les
détenteurs du pouvoir, tandis que le discours de la réhabilitation se base sur des textes et pratiques
présentés comme émanant en opposition au pouvoir ou bénéficiant de son indifférence. L’équation
entreun pouvoir exercé au nom de l’islam (par l’Etat ou le groupe social) et une ferme limitation du
plaisir est donc intégrée dans les deux discours, et réclame à ce titre un nouvel examen.
La conscience d’une tension entre ces deux visions de l’islam est ancienne, et Flaubert l’exprime déjà
dans une lettre d’Egypte datée de 18506 :
«On se figure en Europe le peuple arabe très grave ; ici il est très gai, très artiste dans sa
gesticulation et son ornementation. Les circoncisions et les mariages ne semblent être que
des prétextes à réjouissances et à musiques. Ce sont ces jours-là que l’on entend dans les
rues le gloussement strident des femmes arabes qui, empaquetées de voiles et les coudes
écartés, ressemblent, sur leurs ânes, à des pleines lunes noires s’avançant sur je ne sais
quoi à quatre pattes. L’autorité est si loin du peuple que ce dernier jouit (en paroles)
d’une liberté illimitée. Les plus grands écarts de la presse donneraient une idée faible des
facéties que l’on se permet sur les places publiques. Le saltimbanque, ici, touche au
sublime du cynisme».
Perception de rigorisme d’un côté, perception de liberté discursive et d’inclinaison à la fête de l’autre,
le voyageur français distingue bien une «réalité autre». Mais laquelle serait donc la plus
représentative de l’islam ?
On construit actuellement la vision mythique d’une «vraie tolérance» originelle, dont littérature et
témoignages de voyageurs donneraient la mesure, opposée au «faux rigorisme» contemporain ; ou au
contraire, on cherche dans les textes juridiques et religieux anciens l’expression d’une éternelle
misogynie, d’une sanctification de la domination masculine, d’une anachronique «haine de la
différence» et d’une mise en coupe réglée du plaisir physique. Aucun de ces deux courants n’invente
les faits : poèmes érotiques, contes dans lesquels s’exprime le désir nu, traditions d’usage libre de la
parole, paysannes sans voiles, adolescents courtisés, courtisanes s’offrant en liberté et danses
impudiques, tout cela est encore ou a été ; de même que le corps dissimulé, la méticuleuse mise en loi,
en licite et en illicite, de tout l’être au monde, les adultères exécuté(e)s, les sodomites battus, jetés en
prison ou tués au nom de l’honneur ou au nom de la justice divine, tout cela est et a été : les rigueurs
de la loi n’ont jamais été suspendues lors d’un imaginaire âge d’or. Mais ce que les deux courants
inventent est leur islam, tout comme les musulmans de tout lieu et de tout temps inventent aussi en
permanence leur islam un et éternel. Seul un croyant peut penser une vérité, une essence véridique.
L’historien ne voit que discours, pratiques, et un rapport au temps et au lieu sans cesse modifié.
L’idée que le présent doit être éclairé par des textes du passé, que les données de la longue durée
permettent de saisir l’actuel ne peut être discutée. Mais celle selon laquelle ces mêmes discours du
passé auraient une quelconque actualité est quant à elle le cœur même d’une pensée essentialiste.
4. Antoine Galland (1646-1715) est le premier traducteur européen du recueil de contes des Mille et une
nuits, à partir d’un manuscrit libanais du XVIIe siècle auquel il ajoute diverses histoires.
5. Au sens de religion musulmane et non de l’islam politique comme a évolué le terme.
6. Gustave Flaubert, lettre au docteur Jules Cloquet, Le Caire 15 janvier 1850 in Correspondance, nouvelle
édition augmentée, 2 (1847-1852), Paris, L. Conard, 1826, p. 149.
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
1
/
252
100%