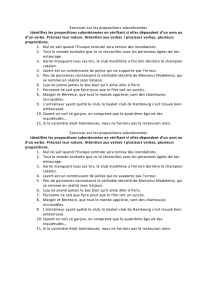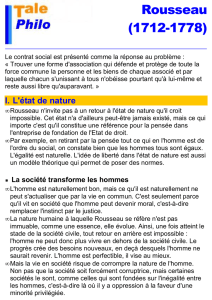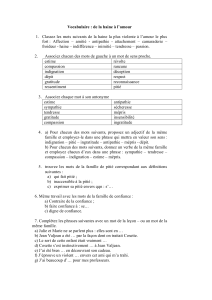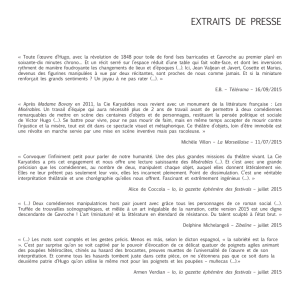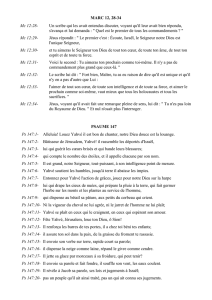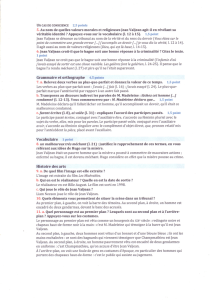10 textes pour préparer la rentrée

1/9
Lycée LES BRUYÈRES
67, Avenue des Canadiens
76300 SOTTEVILLE-LES -ROUEN
Tél : 02.32.81.69.70
Fax : 02.35.73.51.78
PHILOSOPHIE
Voici dix textes dont la lecture est particulièrement recommandée aux élèves de Première
admis en Terminale afin qu’ils se préparent à l’échéance de l’enseignement de la philosophie
au cours de leur prochaine année scolaire.
*
* TEXTE N°1 & 2 : ALAIN
Alain : Propos sur les pouvoirs : propos n°139 du 19 Janvier 1924 – Editions Folio Essais p. 351-352.
1
5
10
15
20
« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui
s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi ? Au monde, au tyran,
au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée
dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat
contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me
trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens,
c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est
que je respecte au lieu d’examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette
somnolence. C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que
l’on croit.
Qui croit seulement ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne
pense plus rien. Je le dis aussi bien pour le choses qui nous entourent. Qu’est-ce que je
vois en ouvrant les yeux ? Qu’est-ce que je verrais si je devais tout croire ? En vérité une
sorte de bariolage, et comme une tapisserie incompréhensible. Mais c’est en
m’interrogeant sur chaque chose que je la vois. Ce guetteur qui tient sa main en abat-jour,
c’est un homme qui dit non. Ceux qui étaient aux observatoires de guerre pendant de longs
jours ont appris à voir, toujours par dire non. Et les astronomes ont de siècle en siècle
toujours reculé de nous la lune, le soleil et les étoiles, par dire non. Remarquez que dans la
première présentation de toute l’existence, tout était vrai ; cette présence du monde ne
trompe jamais. Le soleil ne paraît pas plus grand que la lune ; aussi ne doit-il pas paraître
autre, d’après sa distance et d’après sa grandeur. Et le soleil se lève à l’est pour
l’astronome aussi ; c’est qu’il doit paraître ainsi par le mouvement de la terre dont nous
sommes les passagers. Mais aussi c’est notre affaire de remettre chaque chose à sa place et
à sa distance. C’est donc bien à moi-même que je dis non. »
*
Alain : Propos sur les pouvoirs : propos n°140 du 5 mai 1931 – Editions Folio Essais p. 353-354.
« Le doute est le sel de l’esprit ; sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont
bientôt pourries. J’entends aussi bien les connaissances les mieux fondées et les plus
raisonnables. Douter quand on s’aperçoit qu’on s’est trompé ou que l’on a été trompé, ce n’est
pas difficile ; je voudrais même dire que cela n’avance guère ; ce doute forcé est comme une
violence qui nous est faite ; aussi c’est un doute triste ; c’est un doute de faiblesse ; c’est un
regret d’avoir cru, et une confiance trompée. Le vrai c’est qu’il ne faut jamais croire, et qu’il
faut examiner toujours. L’incrédulité n’a pas encore donné sa mesure.
Croire est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à
liberté, à justice, à paix. »
*

2/9
* TEXTE N°3 : Aristote :
Aristote : La Métaphysique, trad. de jean Montenot légèrement modifiée, Classique Hachette de la
philosophie, 1997, pp17-18.
« C'est bien en effet le fait de s’étonner qui, aujourd'hui comme au début, commande
aux hommes de philosopher. Dès l’origine, ils s’étonnèrent des choses étranges qui étaient à
portée de main ; puis, progressant peu à peu, ils furent embarrassés par des phénomènes plus
importants, comme ceux qui affectent la lune, ceux du soleil et les astres, ainsi que la
génération de tout ce qui est. Or celui qui doute et s'étonne reconnaît sa propre ignorance ;
c'est pourquoi même l'amateur de mythes est, en quelque manière, philosophe [amoureux de
la sagesse], car le mythe est un assemblage de choses étonnantes. Ainsi donc, si ce fut bien
pour échapper à l'ignorance que les premiers hommes se mirent à philosopher, c'est
qu'évidemment ils poursuivaient le savoir en vue de connaître et non en vue d’un usage
quelconque. Et ce qui s'est passé en réalité en fournit la preuve : c’est parce que presque
toutes les nécessités fondamentales d’un vie heureuse et agréable étaient satisfaites que l’on
commença à chercher un tel mode de pensée.
Je conclus que, manifestement, nous ne cherchons ce savoir pour aucun intérêt qui lui
soit étranger. Mais, de même que nous appelons libre l’homme qui vit pour lui-même et non
pas au service d’un autre, de même seule la philosophie, parmi les sciences, peut être déclarée
libre, puisque seule elle est à elle-même sa propre fin. »

3/9
* TEXTE N°4 : LA BIBLE : Ancien Testament : Extrait :
La Bible de Jérusalem – in site Internet : http://www.biblia-cerf.com/BJ/gn3.html
Genèse : versets 2.25 à 3.19.
1
5
10
15
20
25
30
35
« Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant
l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait
faits.
Il dit à la femme : « Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ? »
La femme répondit au serpent : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas,
vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. »
Le serpent répliqua à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui
connaissent le bien et le mal. »
La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre,
désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna
aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent
et ils connurent qu'ils étaient nus; il cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes.
Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et
l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin.
Yahvé Dieu appela l'homme : « Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le
jardin », répondit l'homme ; « j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il
reprit : « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais
défendu de manger ! » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi
qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé ! » Yahvé Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?
et la femme répondit : C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. »
Alors Yahvé Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous
les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la
terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage
et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. »
A la femme, il dit : « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu
enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. »
A l'homme, il dit : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de
l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi ! A force de
peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et
chardons et tu mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras ton
pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu
retourneras à la glaise. »
*

4/9
* TEXTE N°5 : Victor Hugo :
Présentation : Javert est inspecteur de police. Il cherche à arrêter Jean Valjean, un ancien
forçat accusé de vol. Mais ce dernier vient de lui sauver la vie. Javert ne sait plus quelle
attitude est juste : laisser Jean Valjean libre ou bien le livrer à la justice. Finalement il choisira
de démissionner de son poste et de se suicider.
Victor Hugo, Les Misérables, 5ème partie, livre IV (1862), Folio Classiques, Gallimard, p. 719.
« Javert souffrait affreusement.
Depuis quelques heures Javert avait cessé d'être simple. Il était troublé ; ce cerveau, si
limpide dans sa cécité, avait perdu sa transparence ; il y avait un nuage dans ce cristal. Javert
sentait dans sa conscience le devoir se dédoubler, et il ne pouvait se le dissimuler. Quand il
avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui
quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître.
Il voyait devant lui deux routes également droites toutes deux, mais il en voyait deux; et
cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite.
Et, angoisse poignante, ces deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes
droites excluait l'autre. Laquelle des deux était la vraie?
Sa situation était inexprimable.
Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être, en dépit de soi-
même, de plain-pied avec un repris de justice, et lui payer un service avec un autre service ; se
laisser dire : Va-t'en, et lui dire à son tour : Sois libre ; sacrifier à des motifs personnels le
devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de
général aussi, et de supérieur peut-être ; trahir la société pour rester fidèle à sa conscience; que
toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce
dont il était atterré.
Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce, et une chose l'avait
pétrifié, c'était que, lui Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean.
Où en était-il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant ? Livrer Jean
Valjean, c'était mal; laisser jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de
l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne; dans le second, un forçat montait plus haut
que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas, déshonneur pour lui Javert. Dans tous
les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute. La destinée a de certaines extrémités à
pic sur l'impossible, et au-delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de
ces extrémités-là.
Une de ses anxiétés, c'était d'être contraint de penser. La violence même de toutes ces
émotions contradictoires l'y obligeait. La pensée, chose inusitée pour lui, et singulièrement
douloureuse.
Il y a toujours dans la pensée une certaine quantité de rébellion intérieure; et il s'irritait
d'avoir cela en lui.
La pensée, sur n'importe quel sujet en dehors du cercle étroit de ses fonctions, eût été
pour lui, dans tous les cas, une inutilité et une fatigue ; mais la pensée sur la journée qui venait
de s'écouler était une torture. Il fallait bien cependant regarder dans sa conscience après de
telles secousses, et se rendre compte de soi-même à soi-même. »
*

5/9
* TEXTE N°6 : Marc Aurèle :
Marc Aurèle : Soliloques, trad. par Léon-Louis Grateloup, Livre de poche 1998, p. 54.
Livre IV : § 47
1
5
10
§ 47 : « Considère sans cesse combien de médecins sont morts, après avoir tant de
fois froncé les sourcils à la vue des malades ; combien d’astrologues qui croyaient avoir
fait un exploit en prédisant la mort des autres ; combien de philosophes qui avaient discuté
indéfiniment sur la mort ou l’immortalité ; combien de chefs qui avaient fait mourir tant
de gens ; combien de tyrans qui avaient usé avec une singulière arrogance, et comme s’ils
étaient eux-mêmes immortels, du droit qu’ils s’étaient arrogé sur la vie des autres ;
combien de villes sont, pour ainsi dire, mortes tout entières : Héliké1, Pompéi,
Herculanum2 et d’autres innombrables. Rappelle-toi tous ceux que tu as vu mourir l’un
après l’autre. Celui-ci après avoir rendu les derniers devoirs à celui-là, et celui-là à un
troisième, tous ont été couchés par la mort, et tout cela en peu de temps. En somme, vois
comme les choses humaines sont éphémères et sans valeur : hier, un peu de glaire, demain
momie ou tas de cendres. Passons donc conformément à la nature la durée infime de notre
vie, et détachons-nous d’elle avec sérénité, comme une olive mûre, qui tomberait en
louant la terre qui l’a portée, et en remerciant l’arbre qui l’a produite. »
*
1
Hélikè : ville d’Archaïe en Grèce qui, selon Polybe, aurait été engloutie par la mer avant la bataille de Leuctres
en 373 avant J.C.
2
Pompéi & Herculanum furent détruites par une éruption du Vésuve en 79 après J.C.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%