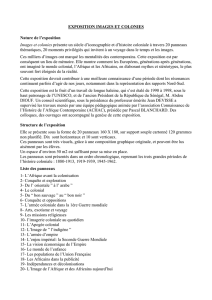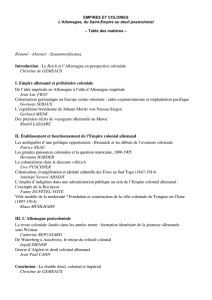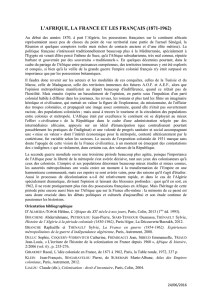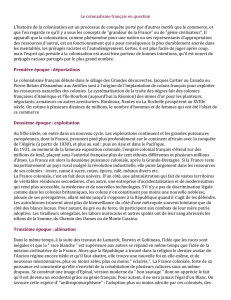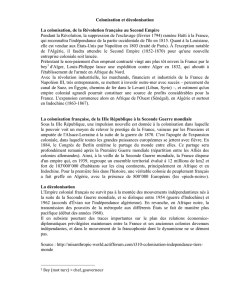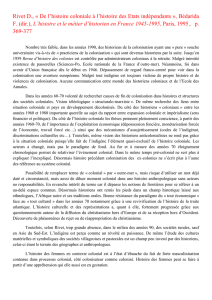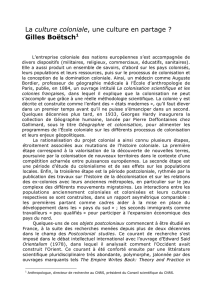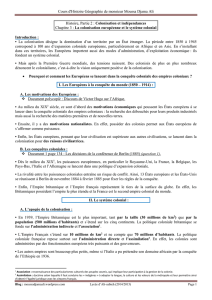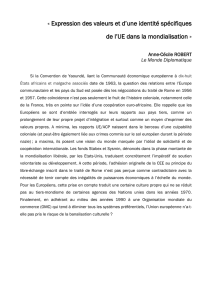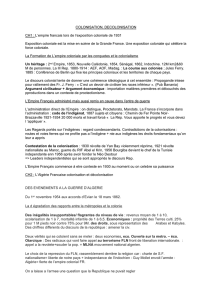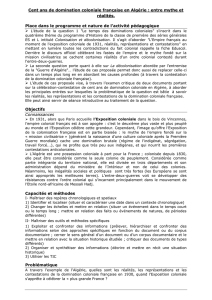Dossier de Presse

1
DOSSIER THEMATIQUE
Vendredi 15 septembre à 18h30 - Conférence
Salle du Capitole - Alès (30)
La fracture coloniale par Nicolas Bancel
Historien. Université de Strasbourg II. Marc Bloch
L'histoire coloniale est aujourd'hui au coeur d'enjeux polémiques, qui se sont particulièrement
manifestés dans les débats autour de la loi du 23 février 2005, stipulant dans son article 4 le " rôle
positif de la colonisation française ", article finalement retiré. Ces polémiques ont mis à jour des
mémoires blessées, celle des harkis, des pieds-noirs et des anciens colonisés, chacun revendiquant leur
"part de vérité". Ce maelström mémoriel a le mérite d'ouvrir d'autres perspectives : les marques
laissées dans la société française par la période coloniale. Étudiées depuis plus de vingt ans par la
littérature scientifique de langue anglaise (dans les postcolonial studies, certains champs des subaltern
studies ou des french studies), ces marques, héritages et filiations sont largement restés ininterrogés
dans les sciences sociales en France, en particulier dans le domaine de l'histoire contemporaine et
coloniale. Nous nous proposons d'évoquer quelques-uns de ces héritages, constitutif de ce que nous
avons nommé "La fracture coloniale". Nicolas Bancel
Organisée par le CMLO –
Renseignements et Réservation conseillée au 04 66 56 67 69
La conférence sera suivie d'une signature de l'ouvrage,
organisée par la librairie Sauramps-en-Cévennes

2
SOMMAIRE
PRESENTATION DU LIVRE ET DE L'AUTEUR .......................................................................................... 3
LE POINT DE VUE DE SCIENCES HUMAINES ........................................................................................... 8
ESCLAVAGE, COLONISATION... UN PASSE QUI NE SE PENSE PAS ...................................................... 8
UN PASSE COLONIAL QUI NE PASSE PAS ................................................................................................. 8
LE MONDE DIPLOMATIQUE ........................................................................................................................ 11
DES EXHIBITIONS RACISTES QUI FASCINAIENT LES EUROPÉENS,
CES ZOOS HUMAINS DE LA REPUBLIQUE COLONIALE ........................................................................................ 11
LES IMPASSES DU DÉBAT SUR LA TORTURE EN ALGÉRIE,
UNE HISTOIRE COLONIALE REFOULEE ............................................................................................................... 17
REVUE MOUVEMENTS - ARTICLE DE NICOLAS BANCEL ET DE PASCAL BLANCHARD ........ 20
LA FONDATION DU REPUBLICANISME COLONIAL. RETOUR SUR UNE GENEALOGIE POLITIQUE
.......................................................................................................................................................................... 20
LE NOUVEL OBSERVATEUR – DOSSIER SUR L'IMMIGRATION ....................................................... 24
ENTRETIEN AVEC L'HISTORIEN PASCAL BLANCHARD NON A LA GUERRE DES MEMOIRES .... 24
POSITIVE POUR LES UNS, CRIMINELLE POUR LES AUTRES, COLONISATION: D'UNE VERITE L'AUTRE ................... 25
UNE GENERATION EN MAL D'ANCETRES,« ON SE DEMANDE CE QU'ON FAIT LA » ............................................... 27
« ON LEUR A VOLE LEUR AME EN LES PRIVANT DE LEURS RACINES », RACONTE-MOI TON HISTOIRE ................. 28
L'HISTORIEN MARC FERRO REVISITE CINQ SIECLES DE COLONISATION ............................................................. 29
A CONTRE SENS – DEBAT SUR LA REPUBLIQUE COLONIALE .......................................................... 33
DEBAT SUR LA RÉPUBLIQUE COLONIALE ............................................................................................. 33
RINOCEROS – CRITIQUES DES LIVRES DE NICOLAS BANCEL ........................................................ 36
OUMMA – ENTRETIEN AVEC LES AUTEURS DE LA FRACTURE COLONIALE ............................... 37
« LA QUESTION COLONIALE LONGTEMPS OCCULTEE, PEUT ECLAIRER DES PANS DE NOTRE
PRESENT » ...................................................................................................................................................... 37
LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME DE TOULON ET LA POLEMIQUE AUTOUR DU
MEMORIAL DE L'OUTRE-MER ................................................................................................................... 40
NICOLAS BANCEL : NE PAS TRANSFORMER UNE MEMOIRE EN VERITE HISTORIQUE ............... 40
MEMOIRE COLONIALE : LE DEBAT AUTOUR DES JOURNEES DE MARSEILLE .............................. 42
MEMOIRE COLONIALE : LE DEBAT AUTOUR DES JOURNEES DE MARSEILLE – 2,
CLAUDE LIAUZU REPOND A NICOLAS BANCEL : POUR UN DEBAT ... .................................................................. 47
L’EXPOSITION COLONIALE DE 1931 .................................................................................................................. 49
LE CRAN ET LE MRAP DEMANDENT LE RETRAIT DU PETIT ROBERT DU MOT "COLONISATION".......................... 52
AFRICULTURES- MUSEE DE L'IMMIGRATION ...................................................................................... 54
POLEMIQUE PAR RAPPORT A LA CREATION DU MUSEE DE L'IMMIGRATION,
MISSION DE PREFIGURATION DU CENTRE DE RESSOURCES ET DE MEMOIRE DE L’IMMIGRATION :LA NECESSITE
D’UN VERITABLE DEBAT ? ................................................................................................................................. 54
LE FUTUR MUSEE DE L’HISTOIRE ET DES CULTURES DE L’IMMIGRATION .......................................................... 58
MUSEE DES IMMIGRATIONS : PASCAL BLANCHARD REPOND A JACQUES TOUBON ............................................ 60
CONQUETE MILITAIRE ET POLITIQUE COLONIALE .......................................................................... 63

3
PRESENTATION DU LIVRE ET DE L'AUTEUR
LA FRACTURE COLONIALE
La société française au prisme de l'héritage colonial
Sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire
SOMMAIRE
1) Présentation de l'auteur et bibliographie
2) Quatrième de couverture
3) Table des matières de l'ouvrage
4) Extraits de la presse
5) Présentation plus longue du livre
1) Présentation de l'auteur et bibliographie
Nicolas Bancel, historien, est professeur à l'université de Strasbourg-II Marc-Bloch, vice-président de l’ACHAC.
Il a codirigé Zoos humains (La Découverte, 2002) et, avec Jean-Marc Gayman, Du guerrier à l’athlète (PUF,
2002).
Images et colonies, avec P. Blanchard et L. Gervereau, Achac-BDIC, Paris, 1993
De l'indigène à l'immigré, avec P. Blanchard, Gallimard, Paris, 2002
Zoos humains. De la Vénus hottentote aux reality shows, avec P. Blanchard, G. Boëtsch, E. Deroo et S. Lemaire
(dir.), La Découverte, Paris, 2002, 2004
De l'Indochine à l'Algérie. La jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962, avec D.
Denis et Y. Fates (dir.), La Découverte, Paris, 2003
Culture coloniale La France conquise par son Empire 1870-1931, avec P. Blanchard et S. Lemaire Paris,
Autrement, 2004.
La République coloniale. Essai sur une utopie, avec Pascal Blanchard et Françoise Vergès, (dir.), Albin Michel,
Paris, 2003
La Fracture coloniale, avec Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire (dir.), La Découverte, Paris, 2005.
2) Quatrième de couverture :
Cinquante ans après la défaite indochinoise de Diên Biên Phu et le début de la guerre d’Algérie, la France
demeure hantée par son passé colonial, notamment par ce rapport complexe à l’« Autre », hier indigène,
aujourd’hui « sauvageon ». Pourquoi une telle situation, alors que les autres sociétés post-coloniales en Occident
travaillent à assumer leur histoire outre-mer ? C’est à cette question que tente de répondre cet ouvrage, où Pascal
Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, en partant d’une enquête conduite à Toulouse – et présentée ici
–, ont décidé d’ausculter les prolongements contemporains de ce passé à travers les différentes expressions de la
fracture coloniale qui traverse aujourd’hui la société française. Ils ont réuni, dans cette perspective, les
contributions originales de spécialistes de diverses disciplines, qui interrogent les mille manières dont les
héritages coloniaux font aujourd’hui sentir leurs effets : relations intercommunautaires, ghettoïsation des
banlieues, difficultés et blocages de l’intégration, manipulation des mémoires, conception de l’histoire nationale,
politique étrangère, action humanitaire, place des Dom-Tom dans l’imaginaire national ou débats sur la laïcité et
l’islam de France… Les auteurs montrent aussi que la situation contemporaine n’est pas une reproduction à
l’identique du « temps des colonies » : elle est faite de métissages et de croisements entre des pratiques issues de
la colonisation et des enjeux contemporains. Pour la première fois, un ouvrage accessible traite de la société
française comme société postcoloniale et ouvre des pistes de réflexion neuves.
2) Table des matières :
Introduction. La fracture coloniale : une histoire française, par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et
Sandrine Lemaire -
I / Histoire coloniale et enjeu de mémoire –
1. Les origines républicaines de la fracture coloniale, par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard - La promotion

4
d’un « modèle français » - S’inscrire dans un mouvement républicain - Est-ce vraiment la République ? –
2. Aux origines : l’indépendance d’Haïti et son occultation, par Marcel Dorigny - Aux origines de la fracture
coloniale - Une défaite niée… et des « pères fondateurs » occultés -Une lente et progressive mise à l’écart - Une
mémoire retrouvée ? –
3. Quand une mémoire (de guerre) peut en cacher une autre (coloniale), par Benjamin Stora - Un drame
périphérique - Des images sans histoires - La solitude des porteurs de mémoire - La guerre entre les victimes –
4. L’Outre-Mer, une survivance de l’utopie coloniale républicaine ?, par Françoise Vergès - Que sont les
outre-mers ? - Une diversité propre aux outre-mers - Une histoire qui est une non-histoire… - Un sentiment de «
pas assez » -
5. Islam et République : une longue histoire de méfiance, par Anna Bozzo - La difficulté d’être à la fois
musulman et citoyen français - Un héritage colonial : la surveillance sécuritaire - La fausse application de la loi
de 1905 à l’islam algérien –
6. L’histoire difficile : esquisse d’une historiographie du fait colonial et postcolonial, par Nicolas Bancel -
Qu’est-ce que l’histoire coloniale et postcoloniale ? - La faible reconnaissance de l’histoire coloniale
universitaire - Une illégitimité universitaire de l’histoire postcoloniale ? –
7. Colonisation et immigration : des « points aveugles » de l’histoire à l’école ?, par Sandrine Lemaire - Le
manuel scolaire au centre du système - Une césure nette entre histoire nationale et histoire coloniale -
Focalisation sur les épisodes traumatiques - Les lacunes de l’enseignement, terreau de la radicalisation ? –
8. Trois musées, une question, une République, par Sarah Frohning Deleporte - Trois musées pour la
mémoire « nationale » - La tâche difficile de la « destruction créative » - Entre « unité républicaine » et « crise
nationale » -
9. La République, la colonisation. Et après…, par Michel Wieviorka - Une association paradoxale - La France
postcoloniale - La crise du modèle républicain d’intégration - Extension du domaine des débats - 10. Sur la
réhabilitation du passé colonial de la France, par Olivier Le Cour Grandmaison - L’« œuvre positive » de la
France en Algérie - Du révisionnisme officiel - Le bon temps des colonies ? –
11. La colonisation française : une histoire inaudible, entretien avec Marc Ferro - La République a trahi ses
valeurs - Les « tabous de l’Histoire » - L’autocensure des citoyens et la censure des autorités - Les ornières du
grand public sont structurelles –
II / République, « intégration » et postcolonialisme –
12. La République et l’impensé de la « race », par Achille Mbembe - Décoloniser sans s’auto-décoloniser - Au-
delà de la fin de la tutelle - Le miroir de la « francophonie » - Le difficile passage au cosmopolitisme –
13. L’héritage colonial au cœur de la politique étrangère française, par François Gèze - La colonisation au
service de la « grandeur de la France » - La « Françafrique » au cœur de l’État français - Les vieux démons
coloniaux de la diplomatie française –
14. Indigènes et indigents : de la « mission civilisatrice » coloniale à l’action humanitaire, par Rony
Brauman - Altruisme et modernisation - Avancés et attardés - Propreté et rédemption - Pouvoir et valeurs - 15.
La France, entre deux immigrations, par Pascal Blanchard - Une construction de la différence… par le
juridique - L’invention de l’indigène - Une histoire mythifiée… -
16. Le « creuset français », ou la légende noire de l’intégration, par Ahmed Boubeker - Les héritiers de
l’exception coloniale - Une faim d’égalité sans lendemain ? - Le grand malentendu –
17. L’ennemi intérieur : la construction médiatique de la figure de l’« Arabe », par Thomas Deltombe et
Mathieu Rigouste - L’essentialisation de l’Arabe musulman - Le ver est dans le fruit - Figures de l’ennemi,
figures de l’ami - Discours sécuritaire et retour de l’imaginaire colonial –
18. La réduction à son corps de l’indigène de la République, par Nacira Guénif-Souilamas -L’ordre patriarcal
au service de l’ordre colonial, ou le « gouvernement des corps » - L’éternel indigène en sa réserve - Des rôles
sexuels imposés - Les normes de l’indigénisation contemporaine –
19. La banlieue comme théâtre colonial, ou la fracture coloniale dans les quartiers, par Didier Lapeyronnie
- Une image imposée qui devient une identité revendiquée - Des mots pour le dire… - Une « déréalisation » en
phase terminale… -
20. Le retour permanent de l’Afrique au cœur des ténèbres, par Olivier Barlet - Un espace de contre-
regard… - Désarmer la mauvaise conscience et la persistance du discours racial - Un travail collectif de
déconstruction des préjugés –
21. Sport, mémoire coloniale et enjeux identitaires, par Philippe Liotard - Des réminiscences coloniales dans
le champ du sport ? - Ressentiment et identification au champion - Le nous et l’autre sportifs - « Racisme anti-
blanc » ou rejet du fait colonial? –
22. La République face à la diversité : comment décoloniser les imaginaires ?, par Patrick Simon - Les
dissidents de la norme majoritaire - Le modèle français d’intégration et la vision pluraliste - Le rapport aux
origines : ambivalence et discrédit –
23. Les enseignements de l’étude conduite à Toulouse sur la mémoire coloniale, par Nicolas Bancel, Pascal

5
Blanchard et Sandrine Lemaire - La focalisation des mémoires sur l’Algérie - Une tendance à l’« ethnicisation »
des regards sur la société française - Une forte demande sociale pour mieux connaître la période coloniale –
Épilogue : De « notre » mémoire à « leur » histoire : les métamorphoses du Palais des colonies, par Arnauld
Le Brusq - Hommage des richesses - La France au centre des cinq continents - Cosmologie coloniale - Tourner
la page ? - Histoire fille de mémoire –
Annexe 1. : Méthodologie de l’étude « Mémoire coloniale, mémoire de l’immigration, mémoire urbaine »
menée à Toulouse en 2003, par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire -L’enquête par
questionnaire - Interviews des personnes ressources –
Annexe 2. : Synthèse des principaux résultats de l’étude de Toulouse, par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard
et Sandrine Lemaire - Une connaissance très faible de l’histoire coloniale - Une attente très forte de
l’enseignement de l’histoire coloniale - Un jugement largement négatif sur la période coloniale - Un regard
stéréotypé au cœur de relations intercommunautaires - Une demande majoritaire de socialisation de la mémoire
coloniale - Une perception ambivalente des ex-espaces coloniaux -L’échec de l’intégration ? - Le tabou colonial
au cœur de la société française ? - Bilan des supports de transmission de savoirs sur l’histoire coloniale - Les
auteurs.
3) Extraits de presse :
« A la fracture sociale qui brise la République risque désormais de s'ajouter une fracture coloniale. C'est la thèse
d'un livre-événement que nos responsables politiques seraient bien inspirés d'ouvrir. »
LES INROCKUPTIBLES
« Une belle manière "d'affronter la crise identitaire" dans laquelle la France et l'école se trouvent plongées. »
LE MONDE DE L'ÉDUCATION
« La France en a-t-elle véritablement terminé avec son passé colonial ? [...] Cet ouvrage collectif démontre à
quel point notre pays reste hanté par ce passé. [...] Alors les auteurs s'interrogent : existe-t-il une fracture
coloniale ? Pour eux, ce "retour du refoulé" signifie que la France ne parvient pas à surpasser sa crise identitaire.
Le signe d'une société qui doute de son avenir faute d'assumer son passé. »
ZURBAN
« Voici un livre intelligent, riche, construit, posé, qui remet les pendules à l'heure, à un moment où le débat sur le
passé colonial de la France, souvent instrumentalisé à des fins politiciennes, revient en force dans l'excès et
l'invective. [...] Dans ce climat délétère où la concurrence des victimes, des mémoires - et des musées ad hoc -
remplace le travail d'historien, le premier intérêt de ce livre est de reposer quelques jalons sur ce projet clonial
français qui s'intégrait parfaitement, au XIXème siècle, au discours républicain. »
TÉLÉRAMA
« Après Diên Biên Phu et la guerre d'Algérie, la France a du mal à digérer son passé colonial, contrairement aux
autres sociétés post-coloniales en Occident qui, elles, tentent de l'assumer. C'est le constat des auteurs, historiens,
qui s'appliquent à rechercher les raisons de cette différence et à ausculter les retentissements contemporains de ce
malaise. Un essai qui ouvre une nouvelle réflexion. »
L'AMOUR DES LIVRES
« La lecturede La Fracture coloniale est éclairante et juste [...]. »
DNA
« Un ouvrage fondamental. »
AFRICULTURES
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%