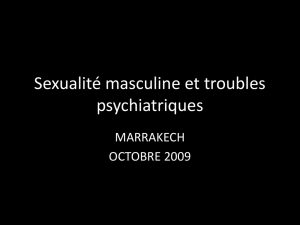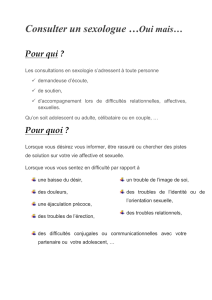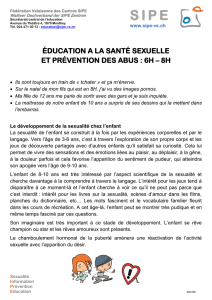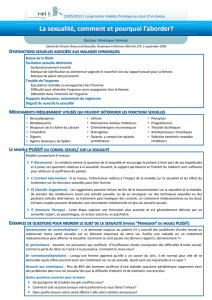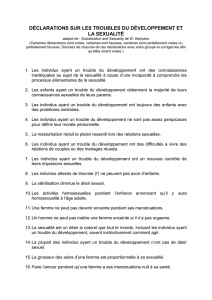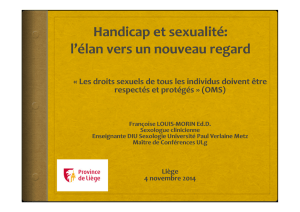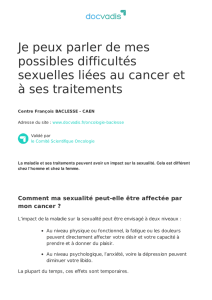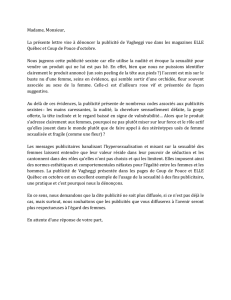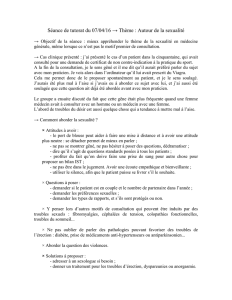Texte des communications

1
A.R. S. I. N. O. E.
Autre Regard Sur l’Inceste pour Ouvrir sur l’Espoir
Actes des journées d’étude et de réflexion franco-québécoises
Angers 9 – 11 mai 2006
Sous la présidence de Roland COUTANCEAU
Inceste : un autre regard sur les différences culturelles
et les situations de handicap.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citer ce document / Cite this document : l’auteur, le titre de la communication et la page
« in ARSINOE, Actes des journées d’étude et de réflexion franco-québécoises, Angers 9-
11 mai 2006, site www.arsinoe.org »
Pour tout contact : [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Sommaire des communications
Inceste : un autre regard sur les différences culturelles et les
situations de handicap.
Agressions sexuelles, inceste : approche interculturelle.
Amérindiens face à l’inceste. Une perspective anthropologique.
Gilles BIBEAU ………………………………………….…………… ….4
Le tabou de l’inceste consanguin et symbolique à travers la culture française, maghrébine et
tamoule (Sri Lanka)
Yolande GOVINDAMA………………………………………… ………………..13
Le cercle de guérison pour les hommes Amérindiens en milieu carcéral
Bob et Johanne BOURDON………………………………………………………..23
Double trahison : Inceste et religion. Quel avenir pour ces souvenirs ?
Jean-Bernard POCREAU et Lucienne Martins BORGES………………………24
L’inceste en Afrique
Etsianat ONDONGH-ESSALT…………………………………………………….37
Agressions sexuelles et handicaps. Constat et perspectives.
Message d’ouverture
Paul JEANNETEAU………………………………………………………………..52
Sexualité et abus sexuels chez les enfants et adolescents porteurs de handicap.
Henri Nhi BARTE ……………………………………………………… ………..56
Maltraitance, violences sexuelles sur des personnes "handicapées mentales" : briser le tabou.
Nicole DIEDERICH…………………………………………………… …………..73
Sexualité et déficience intellectuelle. Quel espace entre protection et reconnaissance du désir
Denis VAGINAY………………………………………………………………… .82

3
Regards pluridisciplinaires.
L’amour et la mort, le sexe et la violence à la lumière de l’anthropologie spirituelle.
Michel FROMAGET…………………………………………………………… 100
Expérience d’un partenariat de dix ans avec la justice dans la prise en charge thérapeutique
des victimes d’agression sexuelle et de leur famille.
Dominique FREMY……………… ………………………………………………113
Justice et réparation. Peut-on « réparer » des agressions sexuelles ?
Michel SUARD………………………………………………………… ……… .118
Quand l’enfant victime devient adulte : principales étapes d’une lutte contre la répétition…
pour tenter de l’éviter.
Jean-Paul MUGNIER……………………………………… ………………… …131
Présentation des intervenants…………………………………………………… … …137

4
Amérindiens face à l’inceste, une perspective anthropologique.
1
Gilles BIBEAU
Professeur au Département d’anthropologie, Université de Montréal.
L’inceste est-il meurtrier ? Existe-t-il vraiment des liens entre l’inceste et le suicide des jeunes
filles autochtones ? Est-il davantage meurtrier chez les jeunes filles et les femmes autochtones qui
choisissent huit fois plus souvent de se donner la mort que leurs consoeurs canadiennes? Il semble
impossible de répondre à ces questions. Dans une pratique de douze ans, la psychanalyste Ginette
Raimbault n’a rencontré, écrit-elle dans Incestes (2005), que deux fois l’issue dramatique du suicide
chez une jeune femme et chez un jeune homme qui avait connu l’inceste. Il est vrai que la situation des
jeunes filles autochtones du Québec a sans doute peu à voir avec celle des femmes que la
psychanalyste française rencontre dans sa pratique.
Le désir de mourir et son accomplissement fatal dans certains cas s’expliquent, si on s’appuie
sur ce que disent les jeunes survivantes de tentative de suicide, par le fait qu’elles avaient cru trouver
dans le suicide une issue à une impasse relationnelle confuse, à une situation désespérée et au
sentiment que leur avenir était bouché. À travers ces passages à l’acte «pour s’en sortir», le jeu avec la
mort se révèle des plus préoccupants. Les comportements autodestructeurs tels que la tentative de
suicide, l’automutilation, l’abus de l’alcool et/ou des drogues et les troubles de l’alimentation chez les
filles autochtones sont autant de «conduites à risques» qui exposent ces filles à une probabilité non
négligeable de se blesser et de mourir, de détruire leur avenir personnel, de mettre leur santé en péril.
Sans doute faut-il considérer que les très nombreuses tentatives de suicide chez les filles
amérindiennes sont de vrais passages à l’acte suicidaire au même titre que le suicide complété.
Ces passages à l’acte d’auto-destruction, souvent mortels, signalent ni plus ni moins la
prégnance massive de la mort dans la psyché de ces jeunes femmes en même temps qu’ils manifestent
un désinvestissement dangereux de la parole à l’égard de la souffrance reliée au trauma sexuel et à
l’inceste en particulier. L’impossibilité de dire cette souffrance précipite la jeune fille dans le silence,
en dehors de l’espace social, dans une exclusion d’autant plus porteuse de désespoir que la vie
communautaire définit largement l’identité dans les petites communautés amérindiennes, surtout dans
le cas des communautés géographiquement isolées.
Un cadre pour penser l’inceste : la mise en jeu répétitive de la sexualité et de la mort
La perspective que je propose pour interpréter l’inceste en milieu amérindien s’ancre dans une
réflexion qui combine l’histoire, l’anthropologie et la psychanalyse. Je soutiens que nous assistons,
dans les communautés autochtones, à un phénomène arborescent et systémique de la violence où la
sexualité et la mort sont violemment et répétitivement mises en jeu. Lorsque le sujet traumatisé est lui-
même traumatisant pour celles et ceux qui partagent, avec lui, une même enveloppe narcissique
commune, on peut penser que « le trauma, vécu par l’un, prend valeur de rappel traumatique
insupportable et de blessure narcissique impansable, pour l’autre » (Kaës 1989 : 177). Dans le cas
1
Ce texte a été rédigé en m’appuyant sur les travaux de Denis NOËL, un membre de l’équipe de recherche-intervention du
projet NOKITAN que je dirige. Cette équipe travaille dans les communautés Atikamekw.

5
amérindien, nous devrions dire « impansable pour les autres », particulièrement pour les jeunes filles
qui deviennent souvent la cible de la violence des pères. Kaës évoque l’idée d’une co-production
traumatique affectant l’ensemble de l’espace psychique partagé par une famille et éventuellement par
toute une communauté. Il ne s’agit pas, pour chaque relance traumatique, d’un simple ajout, mais d’un
renvoi dénégateur en miroir d’une immensité parfois abyssale. Autrement dit, la violence et la
souffrance qu’elle réveille chez l’un, par défaut d’être justement contenues, élaborées et intégrées, sont
indéfiniment renvoyées d’un sujet à un autre, comme une balle folle, rebondissante, meurtrissante, que
personne n’est en mesure de garder, d’abriter pour en guérir.
Le phénomène de la co-production traumatique en tant qu’horizon pour penser l’inceste est à
son comble et repérable comme tel dans les communautés autochtones, notamment lors d’épisodes de
crises répétées, provoqués par des suicides en rafale, alors que les intervenants des services sociaux
appellent à l’aide faute de ne plus pouvoir contenir la souffrance, ni répondre à la demande d’aide
intrapsychique de la communauté. Le psychanalyste dirait que nous sommes ici confrontés à une
situation dans laquelle on peut penser que narcissisme et pulsion de mort sont antagonisés.
L’anthropologue ajouterait que les repères symboliques et éthiques servant d’étayage à la fonction de
paternité s’affolent et se brouillent : dans le cas d’un bouleversement radical du champ culturel comme
celui qui a affecté les sociétés amérindiennes, c’est d’abord la figure du père qui se révèle la plus
fragile ou qui tend à prendre le bord ; la maternité est bien sûr elle-aussi l’objet d’un glissement des
repères de certitude mais sans être aussi profondément affectée dans ses fondements. Le sort de la
fonction paternelle se révèle être prisonnier de la violence structurelle qui a historiquement déstructuré
en profondeur les nations amérindiennes.
Alors que l’on assiste à une croissance démographique significative dans les communautés
autochtones, les chercheurs remarquent une augmentation importante du nombre de foyers
autochtones dans lesquels la mère s’acquitte seule de l’ensemble des fonctions parentales ; on trouve
aussi un nombre grandissant de jeunes mères célibataires, ce qui aggrave la problématique de la non-
reconnaissance de la paternité par les enfants ; enfin, les enfants d’une même mère sont souvent de
plusieurs pères, ce qui contribue à amplifier la reconfiguration de la figure paternelle dans les familles
autochtones (Affaires Indiennes et du Nord Canadien, 1985-1999). Ces faits révèlent non seulement la
fragilité au sein des couples et dans les relations familiales mais aussi l’existence d’un écart
grandissant entre jeunes hommes et jeunes femmes au niveau des relations amoureuses et familiales.
Les repères traditionnels de la filiation sont subvertis, les questions que les enfants se posent au sujet
de leur origine sont reformulées dans un cadre qui mélange souvent le réel, le symbolique et
l’imaginaire.
À l’heure du post-colonialisme et de la post-modernité qui prévalent dans l’ensemble des
sociétés occidentales (y compris au Québec), le climat familial et social dans les communautés
autochtones au Québec apparaît marqué par un double mouvement. D’une part, un nombre important
de personnes travaille avec conviction à l’intégration des forces d’intégration et au renforcement des
liens sociaux au sein des communautés ; d’autre part, beaucoup d’autres personnes, jeunes et adultes,
entretiennent sans toujours le vouloir l’anomie dans leur communauté à travers la multiplication de
comportements destructeurs et autodestructeurs. Or dans ce second groupe, on compte certains
hommes qui occupent des fonctions politiques importantes : leur inadéquation leur confère une figure
d’Autorité défaillante, laissant ainsi entrevoir une souffrance du côté de l’énoncé de la Loi dont ils
sont par ailleurs les représentants. La défaillance des leaders politiques autochtones traduit la blessure
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
1
/
137
100%