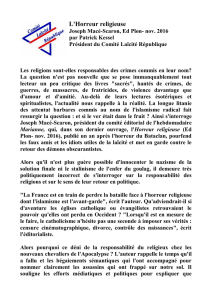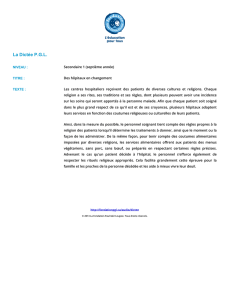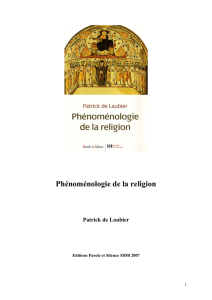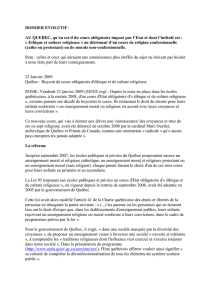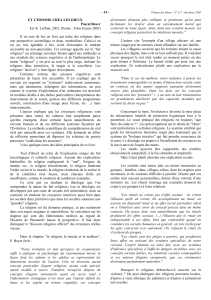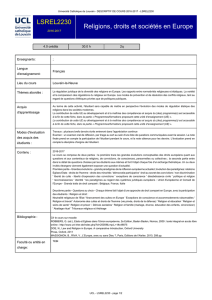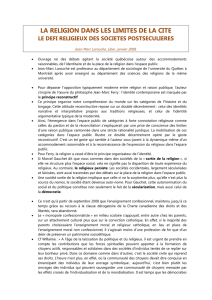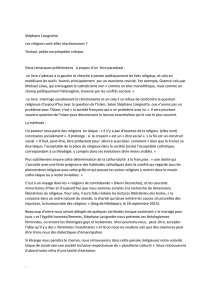3E - Le Portail du Collège Stanislas

COLLÈGE STANISLAS
Notes de cours – 3E
Prof. Luc Phaneuf
REGARDS SUR LE PHÉNOMÈNE RELIGIEUX
DEPUIS LES ORIGINES DE L’HOMME
1
Quels que soient le lieu et l’époque,
l’humanité est renvoyée aux
questions essentielles,
indépendamment du besoin de se
consoler ou de se rassurer : D’où
venons-nous ? Que faisons-nous ?
Où allons-nous ? La question de l’au-
delà n’a donc cessé de se poser.
Même si elle est aujourd’hui mise
entre parenthèses par une culture
occidentale agnostique, elle ne
peut disparaître. (Jean Delumeau,
Histoire du Paradis)
LA RELIGION, PHÉNOMÈNE UNIVERSEL
L’homme religieux, d’hier à aujourd’hui
De la préhistoire à aujourd’hui, l’être humain a toujours été interpellé par le sacré,
par ce qui le dépasse, par le mystère, l’au-delà de ce que ses sens sauraient
percevoir.
Il a pressenti que ce sacré, ce mystère, renvoyait à un autre monde habité par une
ou des divinités. Dès lors, l’être humain a cherché à entrer en contact, voire en
relation, avec cet autre monde mystérieux et habité : le monde de(s) dieu(x).
La création des mythes, cultes et religions
C’est ce désir et cette conviction qui l’ont poussé à créer des mythes, des cultes,
des systèmes de croyances, des livres sacrés, des règles morales, des rites et
liturgies (cérémonies sacrées, donc tournées vers une ou des divinités), autant de
tentatives d’explication du SENS TOTAL, du pourquoi de l’existence humaine et de
ses nombreux mystères.
Cette rencontre de l’être humain avec le sacré est au coeur de l’histoire humaine.
Elle s’est produite dans TOUTES les cultures ancestrales, sans exception. En ce sens,
on peut affirmer sans risquer de se tromper qu’elle fait partie de la condition
humaine.
1
Ces notes de cours doivent beaucoup à l’ouvrage suivant : Jean Dansereau, Jean
Gadbois, Le Phénomène religieux La rencontre de l’être humain avec le sacré, Les Éditions la
Pensée, Montréal, 2002, 92 pages. Elles ont servi d’inspiration notamment en ce qui a trait au
canevas (les titres et intertitres) de ces notes. Je me suis servi des contenus proposés, avant
de les modifier, souvent substantiellement.

Introduction au phénomène religieux : l’être humain et le sacré 2
Déjà à l’ère du paléolithique (de 3 millions à 12 000 ans av. J.-C.), l’homme ancien
enterrait les morts de son clan et avait créé un culte fort complexe : l’adoration des
crânes.
Dès que l’homme raisonnable (homo sapiens sapiens) est apparu sur terre, il a
ressenti le besoin de se « relier » (une des racines du mot religion, religare, religio =
(se) relier) à cette présence mystérieuse, à cette réalité qui le dépasse, à l’au-delà
du visible, mais aussi aux personnes décédées avec lesquelles il voulait demeurer en
contact.
C’est cette rencontre de l’être humain avec le sacré qui a fait naître dans un premier
temps les mythes (que nous étudierons dans une prochaine leçon) et, d’une
certaine façon, les divinités
2
(Zeus, Deo, Dieu, Jupiter, Allah, Yahvé, Brahma, etc.),
de même que les grandes organisations religieuses, et leurs symboles religieux tels
que la croix, le yin et le yang, le tao, l’étoile de David, le croissant, d’innombrables
oeuvres picturales (dessins) et réalisations architecturales (les pyramides incas ou les
temples d’Anghor, etc.), la musique sacrée, etc.
Aujourd’hui : l’Occident abandonne les dieux... vraiment ?
Malgré les avancées de l’athéisme (doctrine philosophique qui nie l’existence de
Dieu et d’un monde spirituel) depuis quelques siècles en Occident, jumelé au recul
des grandes religions et de la pratique religieuse, le besoin du religieux, du sacré, est
tout aussi présent aujourd’hui au coeur de l’être humain qu’il y a 35 000 ans.
Ce besoin de se relier (religion) à quelque chose de plus grand que soi, de sacré, qui
transcende et donne un sens global à l’aventure humaine et à la vie, ce besoin vital
du religieux et de SENS TOTAL à donner à l’existence humaine, qu’il se manifeste tôt
ou tard dans la vie, est encore inscrit au fond du coeur de chaque être humain. (Les
athées, quant à eux, trouveront alors un sens à la vie en dehors des chemins
religieux.)
Le recul du religieux en Occident depuis trois siècles
D’abord, rappel d’une évidence : ce qui a changé depuis les derniers siècles, surtout
en Occident, c’est l’environnement dans lequel vivent les êtres humains. Pendant
plus d’un millénaire, l’Occident a été une chrétienté, c’est-à-dire une organisation
sociale avec en son centre Dieu et l’Église catholique; en contexte de chrétienté, la
religion et la politique étaient deux soeurs marchant main dans la main.
Or la Révolution Française en France (1789), allait mettre à mal cette chrétienté,
avec notamment la chute de la monarchie de droit divin et l’apparition de la laïcité,
soit la séparation de l’Église et de l’État. Au Québec, c’est avec la Révolution
tranquille des années 1960 que la chrétienté québécoise allait tomber, sans violence
toutefois.
2
Cette tournure de phrase laisse croire que les divinités sont toutes des inventions des
hommes, ce qui est une possibilité, mais certes pas « la vérité » pour les milliards de croyants
de toutes les religions qui croient en l’existence réelle de celles-ci, qu’il s’agisse des religions
monothéistes ou des polythéistes.

Introduction au phénomène religieux : l’être humain et le sacré 3
Le recul du religieux en Occident ne découle pas seulement de l’avènement de la
laicité. Au XIXe et en première moitié XXe siècles, d’autres facteurs ont aussi contribué
à ce désenchantement du monde, au recul des églises, voire à l’éclipse de Dieu :
Les avancées prodigieuses de la science et du progrès, qui sont devenues pour
ainsi dire les nouvelles religions;
L’amélioration des conditions de vie, le recul de la mortalité, et du confort;
Une certaine évolution de la pensée humaine centrée sur l’homme plutôt que
Dieu, dont les philosophies nihiliste et matérialiste (rien n’existe en dehors de la
matière) comme le marxisme, qui nient l’existence de Dieu.
En seconde moitié du XXe siècle, l’avènement des mass media et de la culture de
masse a joué un rôle de premier plan, vraiment capital, dans cette évolution des
mentalités (les façons de penser), notamment en relayant les nouvelles idées des
philosophies matérialistes qui critiquaient jusqu’à la pertinence de la religion et de
ses croyances.
Tous ces facteurs, et d’autres, comme le consumérisme (vivre pour consommer) et
l’hédonisme (vivre pour s’amuser, pour les plaisirs), ont contribué à détourner
l’attention de nos contemporains des questions religieuses.
Si bien que la place que la plupart consacrent à la vie spirituelle, à la vie intérieure,
s’est réduite comme une peau de chagrin (énormément) et ce, au profit de
préoccupations et de valeurs plus matérialistes, plus terre-à-terre.
Dieu (la religion) est-il mort ?
Malgré l’affirmation du philosophe athée Nietzsche (1844-1900), Dieu n’est pas mort,
tout comme la religion qui prétend parler de Lui.
L’Occident vit actuellement une situation paradoxale au plan religieux. D’une part,
les sociétés modernes, dont le Québec, tendent à devenir de plus en plus laïques et
sécularisées, c’est-à-dire neutres sur le plan religieux. On affirme que l’État ne doit
pas favoriser une religion au détriment des autres et ce au nom du respect du
pluralisme culturel et religieux de la société, et ce afin de favoriser le vivre-ensemble
et la tolérance.
Cette laïcisation du Québec a eu comme effet de faire de la religion un tabou pour
bon nombre de baby-boomers (nés dans les premières décennies d’après 1945), qui
l’ont rejetée avec vigueur au tournant des années 1960. Donc, en apparence,
l’époque actuelle vit un recul de Dieu, voire un rejet.
Cela dit, malgré les apparences, ceci expliquant probablement cela, chez bon
nombre de nos contemporains, y compris chez bien des jeunes, la soif de sacré et
de religiosité, la quête identitaire religieuse, sur une base individuelle, s’en trouve au
contraire exacerbée (augmentée); au fond, plus l’Occident cherche à se
débarrasser de Dieu et de la religion, plus il constate que c’est une tâche impossible.
La religion, expulsée par la fenêtre, refait son entrée par la grande porte.

Introduction au phénomène religieux : l’être humain et le sacré 4
Ce phénomène tend à démontrer, une fois de plus, non pas que Dieu existe hors de
tout doute, mais que, plus simplement, le besoin de Dieu, de transcendance et de
sacré, est logé au plus profond du coeur humain, et qu’aucun système ou idéologie
politique (comme le marxisme athée) ne réussira jamais à l’en extraire de toutes les
consciences individuelles et collectives.
Le philosophe athée Michel Onfray, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps
notamment en raison de son Traité d’athéologie (2005), commentait ainsi cette
résurgence du religieux dans les sociétés modernes, elles qui croyaient s’en être
débarrassées :
La désaffection de la pratique (religieuse) ne témoigne pas du recul de la
croyance. (...) On peut même penser que la fin du monopole des
professionnels de la religion sur le religieux a libéré l’irrationnel et généré
une plus grande profusion de sacré, de religiosité, de soumission à la
déraison
3
.
LA RELIGION, PHÉNOMÈNE UNIVERSEL PRÉSENT DANS TOUTES LES CULTURES
La religion, considérée dans sa facette rituelle, constitue donc une des plus
anciennes activités humaines, universellement répandue. Depuis l’apparition de
l’être humain sur terre, la religion touche en lui à ce qu’il a de plus intime, de plus
profond : la foi, les convictions personnelles, les conceptions du monde et de la vie.
Mais en même temps, le phénomène religieux n’est pas qu’une affaire intime, de
conscience, de vie intérieure : il se manifeste de façon très concrète et visible dans
les arts, les lettres, la politique, l’éducation, les sciences, en bref : dans les CULTURES
(mot dont la racine est culte : acte rituel qui vise à honorer une divinité).
Plus de 90 % de la population mondiale dit appartenir à une religion et que 80 % des
habitants de notre terre se déclarent croyants ?
On compterait plus de 6 000 religions dans le monde (mais au minimum 10 fois plus
de mythes) – , dont moins d’une dizaine d’importance. Plusieurs d’entres elles sont
des nouveaux mouvements religieux ou des sectes, issues ou non du Nouvel-Âge, et
comptent très peu d’adeptes.
Les innombrables manifestations culturelles du religieux
La presque totalité des chefs d’oeuvre artistiques et culturels mondiaux sont
d’inspiration religieuse : bâtiments, créations littéraires, musicales, écoles
prestigieuses, etc.; même plusieurs des plus importantes découvertes scientifiques n’y
échappent pas (ayant été faites par des prêtres, tel un Georges Lemaître, créateur
de la théorie du Big Bang).
3
Michel Onfray considère que toute croyance religieuse est déraisonnable. Mais ce
qu’il semble oublier, c’est que, en l’absence de preuve scientifique validant hors de tout
doute l’inexistence de Dieu, l’incroyance n’est pas plus raisonnable que la croyance; en
effet, l’existence de Dieu ne peut pas plus être prouvée qu’infirmée. En ce sens, la seule vraie
position raisonnable est la suivante (pour paraphraser Eric-Emmanuel Schmitt) : on ne sait pas
avec certitude.

Introduction au phénomène religieux : l’être humain et le sacré 5
Les traces de ces manifestations de foi sont visibles partout : les mosquées,
pyramides, synagogues, musées, cimetières, lieux de pèlerinage, églises et
cathédrales, croix ou chapelles de chemin, noms de rue (surtout au Québec !), etc.
Même la monnaie de la première puissance mondiale, les États-Unis, est gravée de
la maxime In God We Trust (En Dieu nous mettons notre confiance). Même notre
monnaie canadienne n’y échappe pas : toutes les pièces de monnaie portent
l’inscription, au-dessus de l’effigie de la reine la mention D.G. Regina Elizabeth II, les
D. et G. signifiant Dei Gratia, soit : moi Élizabeth, je règne par « la grâce de Dieu ».
D’autres exemples ? Les Jeux Olympiques modernes, qui sont la continuation depuis
le XIXe siècle de la « fête des dieux grecs ». Et que dire des fêtes religieuses que nous
célébrons dans nos vies : baptême, mariage, funérailles, Noël, Halloween (fête de
tous les saints). Plus près de vous, peut-être, combien de livres, de films, de pièces de
théâtre, témoignent des questions religieuses : Da Vinci Code, Anges et Démons, La
cité des anges, Sept jours au Tibet, l’Exorciste, La Neuvaine, etc. ?
Toutes ces créations artistiques soulèvent ou tournent autour de thématiques
proprement religieuses : l’au-delà, les êtres surnaturels, la présence du diable, la
quête du salut éternel
4
, parmi d’autres.
Enfin, l’actualité, dont les journaux et autres médias, regorgent d’événements qui
touchent de près ou de loin le phénomène religieux : les élections américaines, les
attaques du 11 septembre et le fanatisme violent musulman, les voyages du Pape et
ses interpellations morales sur certains enjeux éthiques (avortement, divorces,
manipulations génétiques, etc.).
En bref, les religions font partie depuis toujours de la réalité humaine, dans toutes les
cultures, et pour cette raison, elles ont laissé des traces de leur passage et de leur
vitalité. Elles ont aussi été un peu partout créatrices de beauté, jusqu’à édifier des
cultures ! On ne peut nier que le génie humain s’est maintes fois exprimé sous des
formes religieuses !
Malgré cet héritage d’une infinie richesse, il est vrai que les religions, en Occident,
laissent de moins en moins de traces, puisqu’elles sont en net recul. Les différentes
formes d’art tirent leur inspiration d’autres sources, moins spirituelles et religieuses,
plus humaines.
De grands témoins qui ont façonné les cultures du monde
Qu’ont en commun Confucius, Bouddha, Jésus de Nazareth, Jean-Paul II, Mère
Teresa, le dalaï-lama, pour ne nommer que ceux-là ?
Ce sont tous des individus qui, par l’intensité de leur vie religieuse et spirituelle, sont
devenus de grands témoins de l’Absolu, autant de témoins de l’importance de la
dimension spirituelle de l’existence humaine en tant qu’inspiration profonde à se
4
Le salut éternel, c’est pour les catholiques « la vie heureuse avec Dieu pour l’éternité » après la
mort. Le contraire est la damnation (la séparation), soit la vie éternelle privée des jouissances qu’offre la
présence de la divinité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%