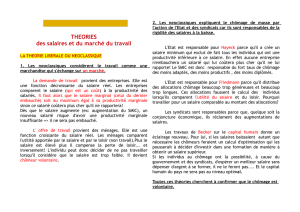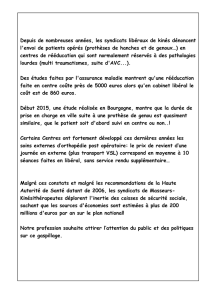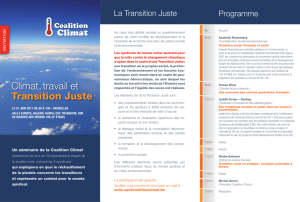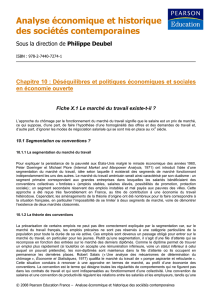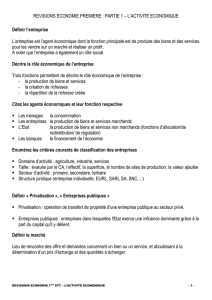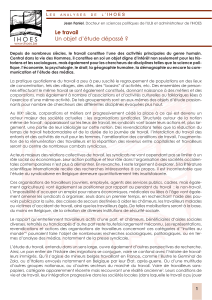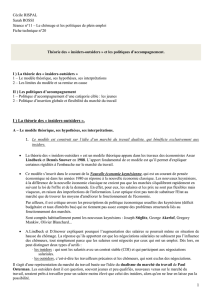les syndicats sont-ils un frein à l`emploi - IEP Rennes

BROCHARD Aurélie
Groupe 3- Mlle Gaulard.
Conférence de méthode d’économie n°5.
Argumentation : les syndicats sont-ils un frein à l’emploi ?
Depuis les années 1970, le chômage sévit de façon spectaculaire dans les économies européennes.
A tel point que certains économistes se demandent si un retour au plein-emploi qui caractérisait les
années 1960 est possible.
Les syndicats se définissent comme des organisations qui visent à unifier les travailleurs pour défendre
leurs intérêts communs (hausse des salaires, meilleures conditions de travail, lutte contre les
licenciements, protection de l’emploi…)
Les conséquences sur la vie économique des syndicats sont encore aujourd’hui vivement discutées, tout
particulièrement dans le contexte de crise actuel. En effet, alors que le patronat prône qu’une relance de
l’activité économique, et surtout de l’emploi, passerait par un allègement des charges sociales et la mise
en place d’une flexibilité sur le marché du travail ; les syndicats quant à eux, réclament une sécurité de
l’emploi, et insistent sur le rôle de la formation. Ils apparaissent alors comme étant le dernier rempart à
une déréglementation du marché du travail, et la question suivante peut alors se poser : sont-ils, oui ou
non, un frein à l’emploi ?
Certains arguments sont avancés pour plaider en faveur du fait que les syndicats seraient un frein à
l’emploi.
Selon les théories classiques et néo-classiques, les syndicats fausseraient les mécanismes du
marché en imposant des niveaux de salaires supérieurs à celui du salaire réel, salaire réel qui résulte des
fluctuations entre l’offre et la demande sur le marché du travail, c’est à dire résultant du simple jeu de la
concurrence. Ainsi, le salaire réel proposé sera égal à la productivité marginale du travail, et l’équilibre du
marché du travail est assuré par la flexibilité de celui-ci. Cette théorie ne conçoit qu’un chômage qui ne
peut être que volontaire. Il apparaît donc que les syndicats seraient la cause de rigidités qui nuiraient à la
flexibilité du salaire réel à la baisse, qui pour les néoclassiques est une condition du plein-emploi, tout
comme l’absence d’entraves aux licenciements et l’absence d’intervention de l’Etat à travers
l’instauration d’un salaire minimum et une politique budgétaire et monétaire active.
Cette idée se retrouve dans la théorie des insiders-outsiders. Les outsiders, nouveaux venus sur le marché
du travail, seraient prêts à travailler pour un salaire moins élevé que celui des insiders alors qu'on ne leur
en laisse pas la possibilité. Ce modèle oppose d'une part les insiders, par exemple salariés avec un contrat
stable et de l'autre les outsiders, travailleurs précaires ou chômeurs. L'analyse en terme
d'insiders/outsiders insiste ainsi sur le rôle de l'action, et notamment de l'action syndicale, des insiders. Ils
profitent de cette façon d'une véritable « rente de situation » en vue d'augmenter le coût du turn-over et
surtout les salaires, au détriment de l'embauche de nouveaux salariés, réalisant ainsi leur profit individuel.
Dans la même optique, les syndicats étant porteurs de revendications salariales, poussant les
salaires à la hausse, empêcheraient la création d’emplois. Ainsi, prenons l’exemple d’une augmentation
générale des salaires : cette hausse entraînerait également une augmentation des coûts de production qui
se répercuterait alors sur le niveau des prix, ce qui aurait pour conséquence une diminution de la demande
ou un détournement de celle-ci vers des produits concurrents. Or, cette diminution déboucherait sur des
anticipations pessimistes et sur de possibles licenciements.
Les syndicats seraient donc une source de rigidités, notamment en revendiquant une hausse des salaires
ainsi qu’en s’opposant à une flexibilisation du marché du travail, ce qui serait un obstacle à l’ajustement
des entreprises aux évolutions de la conjoncture économique. Mais cette vision ne repose que sur des
théories qui ne se vérifient pas forcément au niveau empirique.

Les entreprises considèrent que le principe de flexibilité serait le remède miracle au problème de
l’emploi. Ce concept de flexibilité apparaît toutefois comme étant flou : ici, il s’agit de la flexibilité des
contrats de travail, c’est-à-dire la possibilité pour une entreprise de se séparer de ses salariés en temps de
crise, sans que cela soit trop coûteux pour elle. Or, actuellement, la protection de l’emploi va à l’encontre
de ce type de flexibilité et est même accusée d’être responsable du chômage : les coûts du licenciement
étant trop élevés contribueraient à accroître le chômage en décourageant les entreprises d’embaucher.
Mais il faut savoir que les syndicats ne sont pas contre la flexibilité, comme le prouve l’exemple du
Danemark, mais ils souhaitent en parallèle une certaine sécurité et une protection sociale forte : ainsi, il
est très facile pour les entreprises danoises d’ajuster leurs effectifs en opérant des licenciements, mais
dans un même temps les salariés ne craignent pas le chômage du fait d’une forte indemnisation et aussi
parce qu’ils retrouvent un emploi assez rapidement. Mais cette « flexicurité » n’est pas mise en place dans
tous les pays : ainsi, aux Etats-Unis la flexibilité va de pair avec une augmentation des inégalités entre les
salariés, une détérioration de la protection sociale et une précarisation croissante du marché du travail. En
France, on assiste à une segmentation du marché du travail avec d’un côté des emplois stables et protégés,
et de l’autre des emplois temporaires, peu protégés, qui permettent d’ajuster les effectifs à tout moment.
Ces derniers représentaient 64% des embauches en 2003.
De plus, le lien entre flexibilité et emploi n’est pas prouvé empiriquement : ainsi, des économistes du BIT
ont montré que l’ancienneté favoriserait la productivité (ce n’est qu’au-delà de 16 ans que la productivité
régresserait), et donc que « employeurs et travailleurs trouvent leur intérêt dans une relation stable ». La
protection de l’emploi peut même avoir des effets bénéfiques sur la croissance, notamment en période de
récession, puisqu’elle permet de limiter les licenciements, et évite alors un freinage de la demande
globale, qui entraînerait elle-même des anticipations pessimistes de la part des entreprises, et donc encore
plus de licenciements.
Quant à la question du coût du travail, le niveau des salaire n’apparaît pas comme étant un frein
particulier à l’emploi. La modération salariale prônée par les employeurs afin de répondre à des exigences
de compétitivité sur le plan mondial peut avoir des effets pervers : les pays où les salaires ont été le plus
bloqués ont enregistré une croissance moindre, et ont crée moins d’emplois. Ainsi, dans une optique
keynésienne, une baisse des salaires ne peut combattre le sous-emploi car cela entraînerait une
insuffisance de la demande et donc un recul de la demande de travail. De même, les entreprises peuvent
avoir intérêt à mettre en place des politiques d’incitation, puisque selon la théorie du salaire d’efficience,
ce dernier peut influencer la productivité. Si le salaire a un effet incitatif, une baisse de celui-ci provoque
une baisse de la productivité, ce qui nuit alors à la compétitivité et pèse négativement sur l’emploi. Au
niveau macroéconomique, une hausse de salaire peut se répercuter positivement sur la consommation,
donc sur la production et l’emploi (cf. effet débouché).
Enfin, il faut tenir compte du fait que le pouvoir de négociation des syndicats dépend en grande
partie de la situation du marché : en effet, en période de croissance, ce pouvoir de négociation est fort,
mais en temps de crise il apparaît comme étant faible, notamment dans le contexte actuel de
mondialisation, où il est facile pour les entreprises de jouer sur les peurs de chômage des salariés par le
biais des délocalisations. Actuellement, certains estiment que les entreprises profitent de la conjoncture
qui leur est favorable pour revenir sur les accords sociaux imposés par les syndicats dans les années 50-
60.
Dire que les syndicats sont un frein à l’emploi est une affirmation gratuite qui n’est pas réellement
prouvée. Le chômage n’est jamais dû à un facteur institutionnel pris isolément, comme les syndicats, mais
plutôt à une combinaison de facteurs.
Il existe aujourd’hui une certaine tendance à ne pas rapporter les performances relatives des pays à leur
taux de croissance, variable pourtant majeure. Cet oubli conduit à accorder un rôle disproportionné aux
caractéristiques institutionnelles et autres indicateurs de la « rigidité » des marchés du travail : ainsi, les
entreprises pensent réellement que la flexibilité ou la modération salariale permettent par elles-mêmes de
créer des emplois indépendamment du taux de croissance du pays considéré. C’est pourtant là le
problème car les pays qui enregistrent une croissance plus élevée créent plus d’emplois.
1
/
2
100%