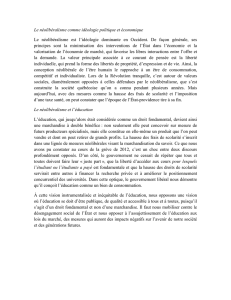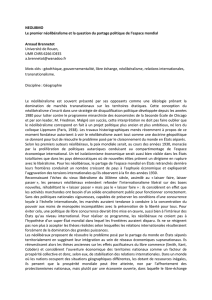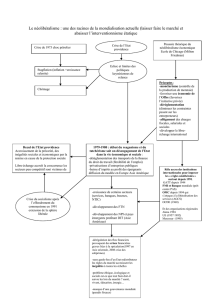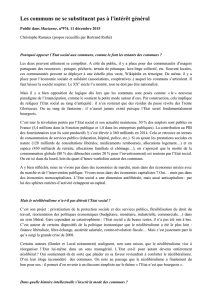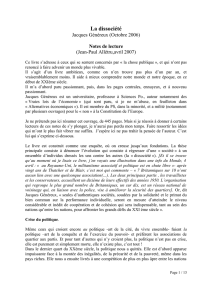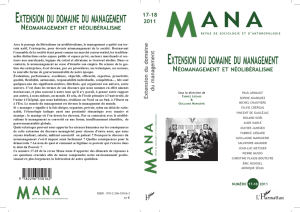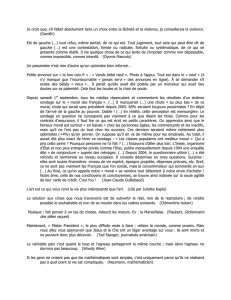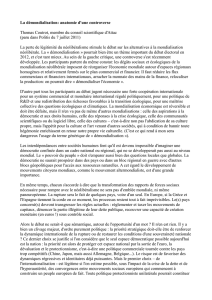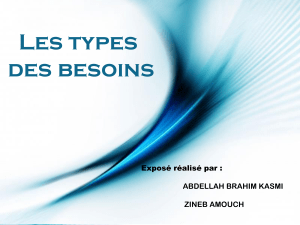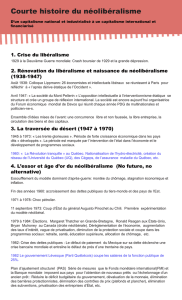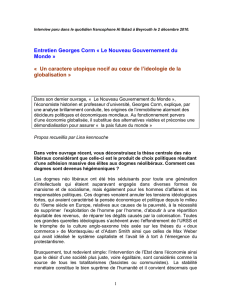Communiqué de l`éditeur

Communiqué de l'éditeur de La Dissociété Par Jacques Généreux
450 pages, 22 €. Éditions du Seuil. Parution le 5 octobre.
Qui accepterait que ses relations avec ses enfants, ses parents et ses amis soient régies par la loi de l’offre
et de la demande, fondées sur la rivalité et non sur la coopération, sur l’égoïsme et non sur le partage ?
Personne ! Pourtant, les comportements que nous réprouvons dans nos relations privées sont devenus les
normes d’une société de marché fondée sur le culte de l’individu, de la performance, de la marchandise et
de la compétition. Beaucoup d’entre nous ont l’intuition d’un divorce croissant entre notre conception
intime d’une vie humaine et les nouvelles exigences de la vie en société. En privé, nous nous efforçons de
trouver un équilibre entre les deux aspirations qui constituent notre désir d’être : le désir d’être soi-même et
pour soi ; le désir d’être avec et pour les autres. La logique de compétition généralisée, qui domine
désormais la vie sociale, exige de nous une dissociation psychique douloureuse : elle exige
l’amputation de notre désir d’être avec et promeut l’épanouissement de notre seul désir d’être soi et
pour soi. Elle est le contraire d’une « société de progrès humain » qui favorise une synergie positive
entre nos deux aspirations. Elle conduit les individus à préserver des espaces d’humanité dans le repli sur
des sous-communautés de semblables (la communauté religieuse ou ethnique, la famille, la bande de
quartier) qui finissent par pervertir la fraternité entre proches en repli défensif contre les non-semblables. La
mixité sociale cède la place au zonage social et à la ghettoïsation... Ainsi va la « dissociété », force
centrifuge qui éclate et isole en fractions rivales les éléments autrefois solidaires d’une communauté
nationale.
Au nom du réalisme, le discours dominant nous explique que cette évolution est l’effet inéluctable de
mutations technologiques et économiques, au terme desquelles la libre compétition généralisée est le moins
mauvais des modes de régulation sociale. Généreux fait ici la démonstration implacable qu’il n’en est
rien. Il met en évidence la mutation des rapports de force politiques qui a permis, non pas le déclin
d’une régulation publique des sociétés, mais la « privatisation » des États, toujours aussi puissants
malgré la mondialisation, mais dont la puissance est réorientée au services d’intérêts privés et d’une
minorité qui peut s’accommoder et tirer avantage d’une société de plus en plus inhumaine pour le
plus grand nombre. La transformation de l’espace social en espace de guerre économique n’a rien de
« naturel » ; c’est l’effet de choix politiques délibérés et réversibles, c’est la victoire politique du
néolibéralisme que l’auteur prend le soin de distinguer très rigoureusement du libéralisme.
L’extension permanente du néolibéralisme et de la dissociété, dans les grandes nations démocratiques,
est dès lors énigmatique. Près de trente ans après l’amorce de cette mutation, on sait en effet que ce
nouveau modèle est économiquement inefficace, écologiquement insoutenable et psychiquement
pénible pour la plupart. Le seul coût économique du stress au travail représente plusieurs points du PIB.
Le coût humain d’un climat de guerre contraire aux aspirations naturelles n’est pas mesurable mais
clairement repérés par toutes les enquêtes de psychologie sociale. La logique de guerre économique
s’accompagne partout d’une montée des violences et de l’intolérance, d’une « guerre incivile » qui dresse
les individus les uns contre les autres. Alors comment un modèle de société peu efficace, source de violence
incivile et de souffrance psychique à grande échelle peut-il s’imposer dans des sociétés démocratiques ?
La réponse favorite de la gauche et des altermondialistes met en cause une domination des néolibéraux,
des patrons, ou encore des médias soupçonnés d’être à la solde de ces derniers. Mais l’auteur, quoique très
engagé dans l’aile gauche du PS, se méfie de ces explications trop simples. Il soutient qu’il faut prendre
très au sérieux le fait que nous vivons dans des sociétés où le mode production exige une coopération
volontaire des travailleurs et où une majorité de citoyens peut régulièrement sanctionner une
orientation qu’elle juge inacceptable. Les néolibéraux s’appuient d’ailleurs sur ce dernier constat pour
avancer, qu’en réalité, la généralisation d’une société de marché privilégiant la quête solitaire de l’intérêt
personnel est conforme à l’aspiration du plus grand nombre, parce qu’elle correspond à la nature humaine.
L’auteur rejette sans surprise cette thèse et, dans ce but, il mobilise tout ce que nous enseignent aujourd’hui
la paléoanthropologie, l’archéologie, l’ethnologie, l’éthologie et la neurobiologie sur la nature effective de
l’être humain et des sociétés humaines.

À savoir : l’évolution a façonné un être social par nature, constitué par ses liens aux autres, incapable de
se développer et d’épanouir sa personnalité en dehors d’une interaction harmonieuse avec les autres. La
conception néolibérale de l’être humain et de la société est donc scientifiquement fausse.
Nous voilà au cœur de l’énigme qui distingue ce livre de tant de thèses simplistes et paresseuses. La
gageure consiste en effet à comprendre comment une conception inhumaine de l’homme et de la société
peut s’étendre, alors même qu’elle engendre une souffrance réelle, dans un cadre social qui suppose la
coopération volontaire des travailleurs et l’assentiment politique de la majorité ? C’est, nous
démontre l’auteur, que cette conception fonde en réalité, non seulement le néolibéralisme, mais
l’ensemble de la culture moderne et, partant la quasi-totalité des courants de la pensée politique. Tous
ces derniers puisent en effet leurs fondements philosophiques et anthropologiques dans les prémisses de la
pensée moderne fondée, à partir du XVIIe siècle, sur une conception atomistique de l’homme : un individu
autonome, indépendant des autres, préexistant à la société. L’individu des modernes est naturellement
dissocié, un atome isolé et rival des autres atomes humains. Le désir d’être avec et les liens sociaux, n’ont
aucune place dans la constitution de cet individu. Dès lors, toute la pensée politique moderne se débat dans
un dilemme insoluble. Comment faire vivre ensemble des individus par nature non sociaux, tout en évitant
un état de guerre permanent ? On ne peut que les tenir à distance les uns des autres, les séparer (dissociété),
ou bien les fusionner dans un tout social sous l’emprise d’un pouvoir autoritaire (hypersociété).
Cette grille d’analyse permet une relecture complète et éclairante de l’histoire de la pensée politique
moderne. Généreux montre en effet qu’aucun courant politique n’a pu sortir d’un dilemme artificiellement
créé par une conception erronée de l’être humain. Les tentatives prometteuses opérées par les libéraux et les
socialistes au XIXe siècle seront finalement balayées par la domination de l’économie néoclassique chez les
libéraux, et par celle du marxisme chez les socialistes. Si l’enquête sur les fondations de la pensée politique
montre assurément que les prémisses du néolibéralisme sont à mille lieues de la vérité scientifique, elle
révèle surtout que tous les courants politiques ont contribué à inculquer les mêmes erreurs et à faire de ces
dernières des éléments de la culture commune des occidentaux. Si le productivisme, l’individualisme,
l’économisme, l’affrontement nécessaire des intérêts privés, etc, et tant d’autres traits de la culture
néolibérale s’installent sans grande résistance, c’est en fait qu’ils constituent un héritage commun,
cultivé et transmis autant par les socialistes et les communistes que par la droite libérale, autant par
le marxisme et le néolibéralisme que Généreux décrit comme deux idéologies quasiment identiques, au
détail près des instruments économiques divergents qu’elle proposent pour atteindre un idéal commun !
Toutefois cela ne suffit pas à expliquer la tolérance à la souffrance psychique réelle que suscite une
dissociété et les nouvelles méthodes de production qui la caractérisent. L’auteur montre alors comment les
individus développent des mécanismes de défense qui, tout en les protégeant contre le conflit
psychique entre leurs aspirations, les dispensent de résister au modèle qui les fait souffrir et les
conduit à une forme de servitude volontaire. La dissociété apparaît ainsi comme un processus
psychopathologique autoentretenu, et même renforcé par les mécanismes de défense qu’il suscite ! Par
conséquent, la résistance à la dissociété et la refondation d’une société humaine ne peuvent résulter d’un
mouvement spontané des individus : même si tous ces derniers se trouveraient mieux dans une société de
progrès humain que dans une dissociété, leur réaction solitaire et rationnelle les piège dans une société
inhumaine. Seule une issue collective, politique est envisageable, c’est donc au blocage contemporain de
cette issue politique et aux moyens d’y échapper que l’auteur consacre la conclusion de ce livre.
Ce livre bouscule tant d’idées reçues qu’il risque de déranger tout le monde. Il propose une
refondation anthropologique du discours politique et des sciences sociales, il pose les bases d’une pensée
« néomoderne » qui accomplirait la promesse d’émancipation de l’individu, en la dépolluant de
l’anthropologie erronée qui a fourvoyé la culture moderne dans l’impasse d’une alternative opposant deux
sociétés inhumaines (dissociété et hypersociété). Démarche ambitieuse mais accessible à tous, non
seulement en raison du talent pédagogique déjà bien connu de l’auteur, mais parce que ce livre de
philosophie, de psychologie, d’anthropologie, de sociologie, d’économie, de science politique, etc., prend
toujours appui sur nos intuitions et nos expériences familières.
1
/
2
100%