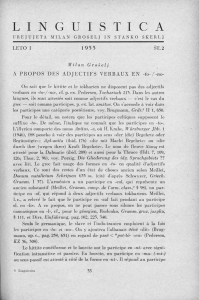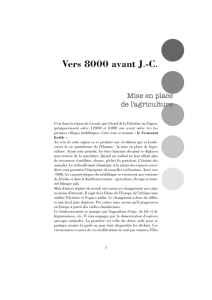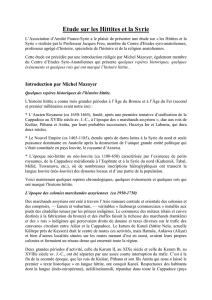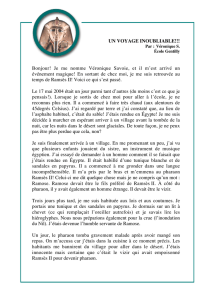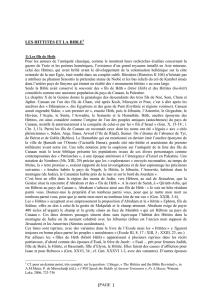A la découverte des Hittites

1
L’histoire hittite
Questions posées par Raphaël Nicolle à J. Freu, le 10 juillet 2010
Raphaël Nicolle a rédigé un master 1 sur les relations entre les Hittites et l’Assyrie sous la direction
de Francis Joannès (Paris I) et un master 2 sur le dieu de l’Orage et Jupiter à l’époque archaïque sous
la direction de Charles Guittard (Paris X).
Jacques Freu, agrégé d'histoire est un éminent chercheur en histoire antique. Son intérêt se porte plus
particulièrement sur le Proche Orient du second au premier millénaire avant Jésus-Christ. Spécialiste
de l'histoire événementielle il publia de nombreux ouvrages sur la cité d'Ugarit, l'Egypte, le Mitanni
mais son attention se porta surtout sur le royaume hittite.
Ses travaux sur les relations entre les Hittites et le pays d'Ahhiyawa ou encore sa synthèse sur
l'histoire du Mitanni font autorité. Son histoire des Hittites en quatre tomes écrite avec Michel
Mazoyer est un ouvrage de référence par la masse des informations traitées et les thèses présentées. La
chronologie des événements est corrigée est obtient une homogénéité dont avait besoin les chercheurs.
Ainsi la succession même des rois est corrigée, par exemple Tuthaliya I (c. 1465-1440) est dissocié de
Tuthaliya II (c. 1425-1390). Son intérêt se porte également sur la construction du royaume hittite mais
aussi ses origines. Jacques Freu démontre l'impossibilité de croire en l'existence d'une civilisation
hattie contemporaine à la civilisation hittite.
Il est en train d’écrire une histoire des cités néo-hittites.
R.N. Le hittite est-il à ce jour la plus ancienne langue indo-européenne connue ? De quand
datent ses plus anciennes attestations ?
J.F. La langue hittite est attestée anciennement par des noms de personnes mentionnés dans les lettres
des marchands assyriens, qui ont fréquenté les centres commerciaux de l’Anatolie entre le 20ème et le
18ème siècle avant notre ère, puis par des textes rédigés aux noms des premiers rois hittites (17ème-15ème
siècles av. J.C.). Le premier de ceux-ci est l’inscription d’Anitta, un roi qui vivait à l’époque des
marchands assyriens (18ème siècle av. J.C.). Le « hittite » est donc la plus ancienne langue indo-
européenne connue par des textes. Ceux-ci sont plus anciens que les poèmes sanskrits les plus
vénérables, comme le chant X du Rig Veda (dont la composition est certainement très ancienne), ou
les textes grecs d’époque mycénienne rédigés en écriture linéaire B (15ème-13ème siècle).
R.N. D’où viennent les Hittites et quelles ont été leurs réalisations politiques?
J.F. L’origine des Hittites reste un problème controversé. C.Renfrew et d’autres admettent leur
autochtonie, ce qui ferait de l’Asie mineure et du Proche Orient le berceau et le centre de dispersion
des Indo-Européens, thèse très improbable pour ne pas dire paradoxale. La plupart des spécialistes
estiment, à juste titre, qu’ils ont été des envahisseurs et qu’ils se sont installés en Cappadoce, soit par
conquête, soit par une lente infiltration, au cours du 3ème millénaire avant notre ère. Sans doute,
pendant une longue période, ont-ils parlé une langue commune (l’anatolien commun) proche de la
langue-mère indo-européenne. Cette langue, sous l’influence de substrats (le hatti en Cappadoce) et
d’adstrats divers (le hourrite, une langue « caucasienne » en Anatolie orientale), s’est différenciée en
trois grands idiomes indo-européens :
a) le nésite (hittite proprement dit) parlé en Cappadoce et devenu la « langue officielle » et
administrative du royaume de Œatti
b) le palaïte parlé au nord-ouest de la Cappadoce (Paphlagonie et pays voisins), connu par quelques
textes religieux et proche du nésite
c) le louvite, langue largement répandue au sud et à l’ouest de la péninsule qui finira par influencer le
nésite et lui survivra. Il continuera à être parlé après la chute de l’empire hittite dans les royaumes néo-

2
hittites de l’Anatolie orientale et de la Syrie du nord et donnera naissance aux langues parlées aux
époques perse et hellénistique dans l’ouest de l’Anatolie (lycien, carien, lydien, etc.)
Il est probable que les Anatoliens de langue indo-européenne sont arrivés en Anatolie encore
indistincts, venant des Balkans. Leur origine lointaine se situait dans les steppes s’étendant du Dniepr
à la Volga (les steppes pontiques). Là s’était développée dès le 5ème millénaire av. J.C. la « civilisation
des kourganes (tumulus funéraires) » d’où sont issus tous les peuples de langue indo-européenne, des
Celtes aux Aryas de l’Iran et de l’Inde, selon le schéma le plus vraisemblable, celui proposé par une
archéologue de génie, Marija Gimbutas.
Les premiers souverains hittites, Labarna, Œattušili I, Muršili I (l’éphémère
conquérant de Babylone en 1595 av.J.C.) ont organisé un royaume dont
la capitale Œattuša (près du village de Boğazköy/BoÖazkale) était
située au centre de la Cappadoce. Le pays de Œatti proprement dit était enserré
par la boucle du K¦z¦l¦rmak (le Maraššantiya hittite).
Le Grand Roi, roi de Œatti, qui portait le titre de Tabarna et a été rapidement désigné comme « Mon
Soleil » renfermait en sa personne tous les pouvoirs, religieux, politiques et militaires et était le prêtre
de tous les dieux. A ses côtés la Grande Reine, la Tawananna, a toujours gardé un grand prestige et un
pouvoir certain, ce qui a entraîné parfois des crises, en particulier lorsqu’elle était une princesse
étrangère. Ceci d’autant plus que la reine-mère conservait ses prérogatives après la mort de son mari,
sa belle-fille, l’épouse du nouveau roi, n’étant qu’une « Grande Princesse » et non une reine, en
attendant la disparition de sa belle-mère.
Le roi gouvernait avec des hauts dignitaires qui étaient souvent des membres de la famille royale au
sens large. Leurs titres, Grand Echanson, Grand Berger, Grand Ecuyer, etc., avaient un caractère
aulique qui couvrait en général des fonctions administratives et surtout militaires. Le Chancelier
dirigeait les bureaux peuplés de scribes, qui maîtrisaient la pratique des cunéiformes et des
hiéroglyphes « hittites » et étaient capables de rédiger des textes en 7 ou 8 langues différentes. Des
gouverneurs administraient les provinces. Un « code de lois » a, dès l’Ancien Royaume », servi de
référence aux personnels administratifs et aux juges.
Pour mettre fin aux meurtres qui avaient ensanglanté le premier siècle de l’histoire du royaume
(Muršili I et plusieurs de ses successeurs avaient été assassinés), le Grand Roi Télipinu (c.1550-1530
av. J.C.) a publié un édit comportant une règle stricte en ce qui concernait la succession royale, un fils
légitime du roi et de la reine, à défaut le fils d’une épouse secondaire ou, enfin, l’époux d’une fille (de
premier rang) du couple régnant ayant seuls le droit, dans cet ordre, à monter sur le trône. Véritable
« constitution » qui sera respecté en général par la suite.
Leurs conquêtes ont permis aux souverains hittites de contrôler la plus grande partie de l’Asie
mineure. Ils y ont possédé un « domaine royal » formé du Haut et du Bas-Pays, administré par des
gouverneurs, et des pays vassaux ayant leurs propres dynastes et liés à leur suzerain par des traités
solennels dans lesquels se traduit l’esprit juridique des Hittites. Ils étaient situés dans les pays louvites
de l’Ouest et du Sud-ouest (Mira, Œaballa, pays de la rivière Šeœa, Wiluša).
Quand l’empire s’est étendu en Syrie du nord (aux dépens du Mitanni
et de l’Egypte) au cours du règne du Grand Roi Šuppiluliuma (c.1350-1320 av.
J.C.) le même système a prévalu. Certaines régions rebelles ont été annexées au domaine royal mais la
plupart des anciens « royaumes » sont devenus des pays vassaux liés par des traités formels au pouvoir
hittite : Ugarit, l’Amurru, Qadeš, etc. Deux ont été donnés aux fils du conquérant et à leurs
descendants, Karkemiš et Alep. Le Mitanni lui-même, reconquis au profit du gendre de Šuppiluliuma,
est resté pendant un temps un pays vassal des rois hittites.
Maîtres de la plus grande partie de l’Anatolie, y compris la Cilicie (Kizzuwatna hittite), les Grands
Rois n’ont jamais pu, du 15ème au 13ème siècle avant notre ère soumettre les montagnes pontiques et les
rives de la mer Noire peuplées de redoutables ennemis, les Gasgas, qui ont souvent pillé les provinces
frontières du royaume et, une fois, sa capitale. D’autres régions restaient en marge du royaume (pays
de Lukka/Lycie, nord-ouest de la péninsule). Mais la conquête de la Syrie du nord a été durable. Elle a
provoqué un long conflit avec l’Egypte (bataille de Qadeš en 1274 av. J.C qui a opposé Muwatalli II
au pharaon Ramsès II). Il s’est terminé par la conclusion d’un traité de paix et d’une alliance éternelle
entre Œattušili III, et le roi d’Egypte qui a été suivi par le mariage

3
de la fille du roi hittite (et de la reine Puduœepa) avec Ramsès II.
La Syrie du nord est restée hittite, le pays de Canaan égyptien.
A l’est les rois d’Assyrie ont fini par conquérir le Mitanni
(Œanigalbat) et ramener, vers 1260 av. J.C., la frontière de l’empire
hittite à la haute vallée de l’Euphrate.
R.N. Que signifie le terme indo-européen ? Quelle réalité recouvre-t-il ? Scientifiquement le
terme est-il justifié ? On a parfois associé ce terme à certaines idéologies. Qu’en penser ?
J.F. Il faudrait un volume pour répondre à la question (cf. B.Sergent , Les Indo-Européens , 1995).
Dès le 18ème siècle av. J.C. , et même auparavant, des missionnaires et des savants ont compris que des
traits communs, de vocabulaire, de morphologie et de syntaxe existaient entre les langues de l’Europe
et celles, dérivées du sanscrit, parlées dans l’Inde du nord. Les études de grammaire comparée menée
par de grands linguistes comme F.Bopp ou K.Brugman ont définitivement démontré, dès le début du
19ème siècle, qu’un vaste domaine indo-européen (indo-germanique pour la plupart des savants
allemands) s’étendait des îles britanniques jusqu’à l’Inde, domaine que des découvertes ont ensuite
étendu à l’Anatolie hittite et à l’Asie centrale ( Turkestan chinois) où vivaient les « Tokhariens » qui
ont disparu mais dont on a retrouvé des écrits.
Le terme indo-européen désigne donc avant tout un groupe de langues mais de même que les locuteurs
de l’allemand sont appelés les Allemands, on a baptisé « peuples indo-européens » ceux qui parlaient
des idiomes apparentés dérivés de la langue-mère. Il y a peu de doute qu’à l’origine (5ème et 4ème
millénaire av. J.C.) il s’agissait bien d’un groupe humain ayant des caractéristiques communes qui le
distinguaient des ancêtres des peuples de langue sémitique, des sumériens, des égyptiens, des chinois,
etc. et , en particulier, des gens de la « vieille Europe » dont la civilisation pacifique (en gros) et
agricole était antagoniste de celle des Indo-Européens, peuples semi-nomades des steppes pontiques,
installés entre le Dniepr et la Volga, vaste région où ils ont élevé les tumulus funéraires de leurs chefs,
parfois gigantesques, les kourganes. De tradition guerrière, ils ont rapidement domestiqué le cheval et
se sont dotés de chars, un moyen de leur formidable expansion, vers l’Ouest jusqu’aux îles
britanniques, vers l’est jusqu’en Iran et en Inde ainsi qu’en Asie centrale (où les Turcs les ont
submergés tardivement).
Marija Gimbutas a cherché à caractériser les « vagues » successives qui se sont succédé et leur ont
permis d’occuper une grande partie de l’Europe et de l’Asie. Ils ont détruit la « vieille Europe » mais
se sont mêlés aux populations indigènes, leur imposant leur langue, leurs croyance et leur « idéologie
tripartite » qu’a définie G.Dumézil dans une série mémorable de travaux. Il est certain qu’ils ont aussi
beaucoup reçu des peuples conquis et que leur expansion a favorisé la distinction entre les dialectes
parlés par les groupes installés dans des régions de plus en plus éloignés du foyer originel.
Ainsi sont apparus des sous-groupes de l’indo-européen commun qui sont devenus eux-mêmes des
familles de langues apparentées. D’ouest en est on peut distinguer de grands ensembles :
1) les langues celtiques
2) les langues italiques (dont le latin et ses dérivés modernes)
3) les parlers germaniques
4) les langues baltes (les plus archaïques)
5) les langues slaves
6) l’illyrien (dont l’albanais est la survivance)
7) le grec
8) le daco-thrace ; groupe éteint
9) l’anatolien (hittite, louvite, palaïte, lycien, carien, lydien, etc.), groupe éteint
10) l’arménien
11) le kurde
12) l’iranien, proche des langues dérivées du sanscrit
13) le sanskrit et les langues indiennes dérivées
14) les deux langues « tokhariennes » (éteintes).
On sait que le groupe occidental, plus archaïque a conservé l’occlusive ‘k’ à l’initiale et dans le cœur
des vocables là ou les « langues orientales », comme le groupe indo-iranien, ont, en général, placé une
sifflante par un phénomène de labialisation. Cent se dit centum (=kentum) en latin, satem en sanscrit.

4
Bien que la découverte du hittite et du tokharien ait modifié les perspectives la séparation entre
langues du groupe ‘centum’ et celles du groupe ‘satem’ reste pertinente.
La présence des laryngales, notées œ/œœ, en hittite a confirmé les intuitions de F.de Saussure sur la
structure phonétique ancienne de l’indo-européen.
Les correspondances de vocabulaire, en particulier dans les termes de parenté, avaient frappé les
premiers chercheurs. Père se dit pater en latin, pitar en sanscrit, patêr en grec, fater en vieux haut
allemand, pƒcar/pƒcer en tokharien etc. Mère, mater, mƒtar en sanscrit, mêtêr en
grec, mƒcar/mƒcer en tokharien, etc. D’innombrables substantifs ou
adjectifs ont des racines communes indo-européennes dans ces
diverses langues et les verbes de même. Le verbe être (je suis) est
dérivé de l’indo-européen *ésmi, grec eimi, sanscrit ásmi, latin sum, hittite
esmi ; lithuanien esmi ; vieux slave jesmÔ, etc.
G.Dumézil a montré que des rapprochements comparables pouvaient être
faits entre les mythologies anciennes des Indiens védiques (les
Vedas), des Iraniens (les Gathas), des Celtes (l’épopée irlandaise)
des Germains (Sagas et Edda scandinaves) et l’histoire épique des
Romains. Une structure tripartite de « l’idéologie » de ces peuples
qui était l’héritage du vieux fond indo-européens répartissait les
dieux en trois groupes : les dieux souverains (Mithra et Varuna aux
Indes), les guerriers (Indra) et les dieux protecteurs (les jumeaux
Nasatya) associés à une grande déesse. La société humaine était
pensée dans ce cadre.
On peut conclure en disant qu’il est impossible de se passer de la notion de « langues indo-
européennes » dans les études linguistiques. Le terme est justifié sans discussion possible mais la
tendance à identifier les locuteurs de ces idiomes avec une race, germanique et supérieure par
exemple, explique les craintes de ceux qui ont décelé des tendances racistes dans les études indo-
européennes. Il faut bien évidemment ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et ne pas déconsidérer sur
des prétextes de ce genre l’œuvre de G.Dumézil. D’un autre côté on a dénoncé le caractère
« idéalisé », pacifique, agraire et en voie d’urbanisation et de maîtrise de l’écriture que M.Gimbutas
attribuait aux civilisations de la vieille Europe. Féministe elle a sans doute accentué l’opposition entre
les Indo-européens, guerriers et conquérants qu’elle avait étudiés mais dont elle réprouvait, à l’opposé
des racistes glorifiant les peuples agressifs de « race pure », les instincts guerriers et prédateurs.
Il y a eu certainement un peuple de langue indo-européenne (des tribus) relativement homogène sur un
territoire limité (environ 500000km2 du Dniepr à la Volga) au 5ème millénaire avant notre ère. Son
expansion et le métissage avec les peuples conquis a donné naissance à des populations ayant une
langue dérivée de la langue-mère mais qui ne se comprenaient plus entre elles et étaient souvent
ennemies (Celtes et Germains puis Celtes et Romains, Indiens et Iraniens, etc.). Elles avaient
cependant gardé dans leurs mythologie, leurs pratiques cultuelles, leur « idéologie » (les « trois
couleurs » !), des éléments qui tenaient à leurs origines indo-européennes et d’autres qui venaient des
populations pré-indo-européennes, sans doute majoritaires, qu’elles avaient soumises et assimilées.
L’exemple des « temps historiques » dont l’histoire est connue par des textes permet d’ignorer la
tendance actuelle de nombreux archéologues et préhistoriens à rejeter toute idée de conquête et de
migrations de peuples au cours de la « préhistoire ».
Les langues indo-européennes ont occupé un immense espace à la suite des peuples guerriers qui
l’avaient conquis. Toute autre hypothèse, comme la « Wellentheorie » supposant une évolution des
idiomes parlés en Europe et en Asie par la propagation d’ondes linguistiques de proche en proche sans
conquête et sans grands apports de population peut être rejetée même si l’indo-européanisation a été le
fait d’une minorité d’envahisseurs en Europe et en Asie.
R.N. Quelle langue parlaient les Hittites ?
Les Hittites appelaient leur langue le nésite ( ils parlaient en nešili, našili, nešumnili),
du nom d’une ancienne capitale, Kaneš/Neša (l’actuelle Kültepe), qui
avait été celle d’un précurseur de le dynastie hittite, Anitta, et
surtout le grand centre (karum) des marchands assyriens dans les

5
demeures desquels ont été découvertes des milliers de tablettes,
témoignage de leurs activités commerciales et de la présence des
Hittites en Cappadoce à cette haute époque.
Le nésite (hittite) peut être considéré comme un représentant, le
seul connu, des premiers idiomes issus de l’indo-européen. Ses
caractères archaïques ont frappé les premiers chercheurs qui ont
avancé l’hypothèse qu’il avait existé une langue originelle indo-
hittite dont une branche avait donné le hittite et l’autre toutes
les autres langues indo-européennes. Mais les caractères archaïques
du hittite ; présence des laryngales, déclinaison hétéroclitique -
r/-n pour les inanimés (watar, génitif wetenaš, « l’eau »), médio-passif en -r,
comme en latin et en celtique, absence de féminin, de comparatif et de superlatif, d’aoriste, d’optatif,
de subjonctif, etc., sont simplement la marque de l’archaïsme de l’anatolien. Contrairement à l’idée
avancée par certains spécialistes que les langues anatoliennes avaient perdu en cours de route et sous
l’influence de substrats ou d’adstrats divers des catégories grammaticales présentes ailleurs il est
certain que cette situation est le reflet de l’archaïsme de ces langues restées au stade II de l’indo-
européen alors que toutes les autres parlers antiques appartenant à ce groupe (du latin au grec, à
l’iranien et au sanscrit) appartenaient au stade III, défini par K.Brugman, de l’ensemble indo-
européen. A.Meillet avait montré il y a un siècle que le féminin, par exemple, était une innovation
relativement récente des langues indo-européennes qui avaient dépassé le stade archaïque du hittite.
Certaines langues parlées à la périphérie du domaine indo-européen, celles du groupe ‘kentum’ en
particulier (de l’italique et du celtique au tokharien d’Asie centrale) ont conservé des traits anciens qui
les rapprochent du hittite mais les éloignent du grec et du groupe ‘satem’ (indo-iranien, langue des
Vedas (sanscrit) et des Gathas).
Quelques exemples permettent de situer le nésite parmi les langues indo-européennes et d’affirmer son
appartenance au groupe occidental de celles-ci (‘kentum’) :
eš- « être », ešœar- « sang », ed- « manger », œarki- « blanc »,
œašter- « étoile », œaštai- « os », i-
« aller », kard- « cœur, genu- « genou », keššar- « main, gim-
« hiver », laman- « nom », milit- « miel », tekan- « terre », watar-
« eau », witt- « année » ; etc. Le relatif kuiš est le parfait équivalent du latin
quis, etc.
Le nésite était parlé en Cappadoce, au centre de l’Asie mineure. Son usage administratif s’est étendu
aux pays vassaux dont la langue, apparentée au nésite, était le louvite. Les invasions des Gasgas et le
repeuplement des régions dévastées ont entraîné un fort apport de populations louvites au 13ème siècle
avant notre ère dans le vieux pays hittite. Certains spécialistes ont même pensé que le nésite était
devenu une langue morte avant la fin de l’empire. Dans les royaumes néo-hittites, du 12ème au 7ème
siècle av. J.C., le louvite survivra (écrit en hiéroglyphes « hittites ») mais toute trace du nésite (hittite)
aura disparu. On ne peut affirmer que le nésite ait été parlé par d’autres peuples que les Hittites mais
ces derniers ont imposé leur langue aux indigènes de la Cappadoce, les Hattis.
Le problème est compliqué par le fait que les textes retrouvés à Boğazköy montrent que 7 langues,
vivantes ou mortes, ont été pratiquées par les scribes de l’administration des Grands Rois en plus du
nésite :
1) le « hatti », langue des indigènes de la Cappadoce (apparentée à des idiomes du Caucase ?) qui ont
été intégrés au peuple hittite et lui ont fourni une part de sa civilisation, de son onomastique et de ses
croyances. On en possède quelques textes religieux et cérémoniels.
2) le palaïte parlé au nord-ouest (Paphlagonie), proche du nésite, connu par quelques textes religieux
3) le louvite, de tendance agglutinante et plus éloigné du nésite, dont on a de nombreux textes rédigés
en cunéiformes et en hiéroglyphes
4) le sumérien, langue morte à l’époque du Nouvel Empire hittite mais langue d’une vieille civilisation
qui avait rayonné dans tout le Proche-Orient et qui avait créé l’écriture cunéiforme. Les scribes hittites
ont recopié des textes sumériens, conjurations, rituels, recettes, textes magiques. Le sumérien a aussi
fourni des idéogrammes aux textes cunéiformes rédigés en nésite ou en louvite
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%