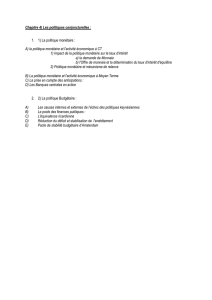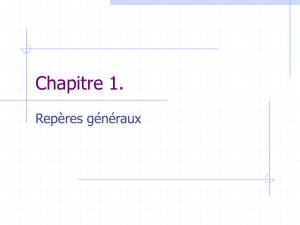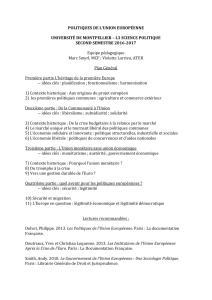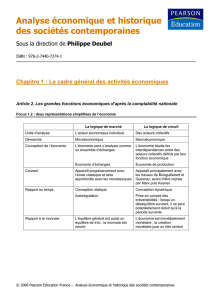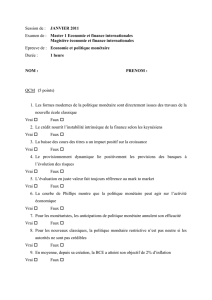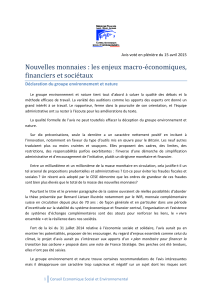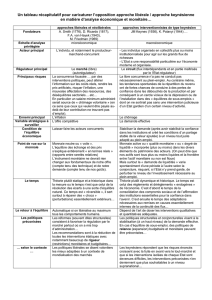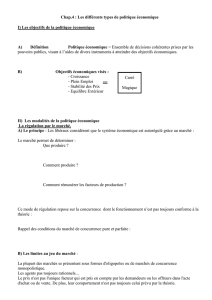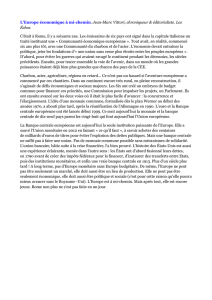CRISES FINANCIERES ET REGULATION POLITIQUE EN

Colloque organisé par le GREITD, l’IRD
et les Universités de Paris I (IEDES), Paris 8 et Paris 13
«Mondialisation économique et gouvernement des sociétés :
l’Amérique latine, un laboratoire ? »
Paris, 7-8 juin 2000
Session I : MONDIALISATION MARCHANDE ET FINANCIERE.
Session I-2 : Mondialisation et souveraineté monétaire

2
CRISES FINANCIERES ET REGULATION POLITIQUE
EN AMERIQUE LATINE
JAIME MARQUES-PEREIRA
RESUME
On étudie dans ce texte les ressorts politiques de l’endettement et ses effets sur le régime monétaire. Le poids du
confit distributif apparaît ainsi comme force dominante d’une trajectoire macro-économique conforme un cycle
d’ ajustements des hausses des actifs financiers, entretenus par la politique monétaire. L’inconnue est alors de
savoir si la société civile peut amener un débat sur une alternative de souveraineté monétaire assise sur
l’intégration régionale. Cela suppose de nouveaux modes de délibération politique de la richesse tant par les
Etats que par la société civile. La question mérite toutefois d’être posée. Le règlement monétaire du conflit
distributif a conduit à une hégémonie de la finance qui est non seulement vulnérable d’un point de vue
économique mais qui, en outre, ne garantit pas nécessairement la légitimité politique. Pousser les organisations
des marchés à définir des normes de prudence financière ne lève en rien les aléas économiques et politiques.
Estuda-se neste texto as raízes políticas do endividamento e seus efeitos sobre o regime monetário. O peso do
conflito distributivo apparece assim uma força dominante de uma trajetória macroeconômica conformando um
cyclo de ajustes da inflação dos ativos financeiros, entretida pela política monetária. O que permanece no escuro
é a evolução possível da sociedade civil, no sentido de saber se ela pode vir a abrir um debate sobre uma
alternativa de soberania monetária se assentando na integração regional.Tal perspectiva supõe novos padrões de
deliberação política da riqueza tanto pelos Esados quanto pela sociedade civil. A questão merece no entanto ser
levantada. A regulação monetária do conflito distributivo fez o leito da hegemonia da finança mas esta é
vulnerável, não apenas do ponto de vista econômico mas tambem enquanto a legimidade política não pode ser
considerada consolidada. Levar as organizações do mercado a prescreverem regras de prudencia financeira não
anula os riscos poíticos ou econômicos da aposta néo-liberal.
Que peuvent faire les gouvernements latino-américains pour prévenir la menace de
nouvelles crises financières ? Qu’est devenue leur souveraineté monétaire dans le contexte de
la mondialisation financière ? Les Etats composent désormais avec le pouvoir financier, la
souveraineté monétaire n’est donc pas inexistante. Celle-ci est, plus que jamais, est un enjeu
de politique intérieure. La légitimité des Etats est désormais liée à celle dont dispose le
pouvoir de la finance mais le choix du régime de change (et la négociation internationale
allant de pair) ne sont pas des questions seulement financières. Le débat de « politique »
monétaire, à proprement parler, ce sont aussi des questions d’économie et la façon de les
poser modifie la politique des intérêts en jeu.
Dans cette optique, la politique monétaire des trente dernières années en Amérique
latine, paraît une parfaite illustration de la thèse classique en sociologie politique sur la
modernisation conservatrice, une modernisation économique qui reproduit les anciens
systèmes politiques. Dans la longue durée, à la différence des autres pays occidentaux et
d’une partie du monde asiatique, l’industrialisation n’aura pas été, en Amérique latine,
l’occasion de liquider l’héritage des inégalités, propres aux sociétés rurales oligarchiques. La
politique monétaire a joué dans cette pesanteur de l’histoire un rôle décisif. Depuis les années
Professeur d’économie à l’Université de Lille I, chercheur au Centre de recherche et documentation de
l’Amérique latine (CREDAL-CNRS) ; Email : jmarques@club-internet.fr

3
70, elle est redevenue, comme à l’époque de gloire de l’exportation de produits primaires au
début du 20ème siècle, une politique d’endettement international. Celle-ci gouverne les prix
relatifs de l’économie et aura ainsi réduit à néant l’espoir de voir la démocratie modifier
substantiellement le cours de l’histoire sociale en Amérique latine.
Avec l’endettement extérieur, le titre financier s’impose comme forme d’énonciation
de la richesse qui déterminera toujours plus sa répartition
1
. La dette n’était pas qu’un excès
fortuit de dépenses de l’Etat. D’un point de vue macro-économique, la dette a transformé en
problème de paiements externes le déclin de rentabilité de l’investissement productif dans les
années 60, du à des marchés trop restreints. De façon récurrente, les opérateurs financiers
craignent l’occurrence de ruptures de paiement depuis la crise de la dette extérieure des
années 80. Dans la nouvelle phase critique inaugurée par la crise mexicaine de 94, à l’inverse
de la décennie dite perdue des années 80, marquée par la dévaluation constante du taux de
change, c’est la montée des déficits commerciaux et/ou budgétaires, autorisés par l’ancrage
des parités sur le dollar, qui augmente le service de la dette ; à un point où le creusement des
déficits est jugé insoutenable et force – dans la crise - à la dévaluation.
La finance finit par être victime de son propre succès. En imposant à l’Etat un usage
de la monnaie qui limite sa liberté pour répartir la richesse sociale, elle engendre les
déséquilibres qui la font passer de l’optimisme au pessimisme. La crise de la dette des années
80 et les crises financières récentes sont, de ce point de vue, l’expression d’un conflit
structurel entre deux modes de partage de la richesse où se jouent les marges de manœuvre de
l’action gouvernementale. Ce conflit est d’abord politique même s’il se donne à voir sous la
seule apparence économique du prix des biens, des services et du travail. Il est, en dernier
ressort, un conflit symbolique portant sur l’énonciation des titres de la richesse entre le
pouvoir du marché, surtout financier, et le pouvoir politique. Dans ce conflit se délimite
désormais le territoire du pouvoir de la finance, le monde économique où peut s’imposer son
mode d’évaluation. Ce ne sont plus seulement de titres de richesse qu’il s’agit, mais de
moyens de production en général. La finance évalue le prix du capital physique de
l’entreprise et le coût de son financement éventuel. En fixant les taux d’intérêts et les taux de
change, elle détermine en grande partie la compétitivité de l’entreprise ; elle dicte l’arbitrage
technique entre capital et travail, elle soumet à la concurrence internationale l’emploi et les
salaires.
Cette régulation des rapports sociaux est à la fois économique et politique. Le cours de
bourse et les taux de change deviennent des facteurs décisifs de la conjoncture. Le débat
d’experts sur la politique monétaire oriente alors, voire régente, le débat de politique générale
et s’impose dans la parole publique une représentation financière de la souveraineté. Ce qui
devient une doctrine monétaire produit les crises et les règle par ailleurs, ceci sur deux plans.
Le prêteur en dernier ressort, devenu en partie international, la légitimité politique se pose au
premier chef en termes de capacités de règlement. La loi du marché, entonnée dans la
rhétorique politique ressource alors la légitimité gouvernementale sur ce qui est
manifestement une illégitimité flagrante : l’anomie sociale engendrée par le chômage et la
précarité du travail. La vulnérabilité financière se double d’un déficit de légitimité mais celui-
ci n’ouvre manifestement pas, jusqu’à présent, de voie à une quelconque alternative. Le
1
Rappelons que l’endettement est aux origines historiques de la monnaie, contrairement à ce que laisse croire la
fable du troc qui l’assimile à une procédure marchande à terme différé. La souveraineté monétaire des Etats,
dans sa forme contemporaine qu’est la banque centrale, renvoie dans la longue durée à la fonction originelle
mais toujours actuelle de la monnaie comme représentation de la totalité sociale. Cette qualité symbolique lui
permet précisément d’être un instrument crédible à la fois de l’échange marchand et de la finance (Aglietta et
Orléan, 1998).

4
blocage de la demande par la croissance des inégalités reproduit, sur un plan sociologique, le
pouvoir de la finance.
Une monnaie unique du Mercosur pourrait être le moyen qui donne à un
gouvernement économique supranational la capacité de soutenir des politiques étatiques
susceptibles d’engager un régime de croissance plus créateur d’emploi reposant sur
l’expansion d’un grand marché régional. L’inconnue est de savoir si la société civile peut
amener un tel débat. L’alternative d’une souveraineté monétaire assise sur l’intégration
régionale suppose de nouveaux modes de délibération politique de la richesse tant par les
Etats que par la société civile. On arrive à cette conclusion en retraçant tout d’abord comment
le règlement monétaire du conflit distributif a conduit à une hégémonie de la finance sans
garantir réellement la légitimité politique. On montre ensuite comment la politique consistant
à pousser les organisations des marchés à définir des normes de prudence financière ne lève
en rien les aléas économiques et politiques. Le risque systémique de paniques financières
existe bel et bien sur les marchés émergents.
LA MONTEE EN PUISSANCE DE LA FINANCE
Le règlement monétaire du conflit distributif
Le pouvoir de la finance globale en Amérique latine s’est mis en place sur la base de
l’endettement avec lequel ont renoué les gouvernements dans les années 70 après avoir
cherché à y échapper durant un demi siècle d’effort de substitution des importations.
L’endettement a sonné le glas d’une stratégie de développement qui cherchait à réduire la
dépendance extérieure due aux déficits récurrents du compte courant. Les banques
internationales ont poussé les pays à s’endetter dans les années soixante-dix mais, bien
évidemment, ceux-ci y ont aussi trouvé leur intérêt. La dette n’a pas été que spéculation
financière ; la facilité de contracter des emprunts dans les années 70 a pu être mise à profit
pour financer l’importation d’intrants de plus en plus coûteux. Ils ont alors permis
l’implantation d’une industrie de biens d’équipement. On a ainsi réduit le coût du capital et
limité le déclin de la rentabilité du à une progression insuffisante de la demande grevant les
économies d’échelle. La croissance de la consommation reposait essentiellement sur les
classes moyennes.
Au tournant des années 80, les grandes banques internationales ont considéré que la
dette accumulée devenait insoutenable une fois qu’a commencé, à la fin des années 70, la
hausse des taux d’intérêt et du dollar, suite à l’apparition du double déficit, commercial et
budgétaire, des Etats-Unis. La dette interne prendra alors le relais pour assurer le financement
des paiements externes qu’il n’était plus possible d’obtenir auprès des banques
internationales. Cette nouvelle situation induit dévaluation et montée des taux d’intérêt
internes. Le conflit distributif se développe alors dans cette conjoncture, déjà donc marquée
par de fortes pressions inflationnistes. Lorsque s’arrête la possibilité de refinancement des
intérêts et des encours arrivant à échéance, les paiements de la dette latino-américaine seront
ponctionnés sur la richesse nationale. Cela se fera d’abord par l’inflation et ensuite, dans un
contexte de stabilité des prix, par la mise en œuvre de la flexibilité du travail.

5
Dans un premier temps, la dévaluation permet de dégager l’excédent commercial significatif
qui procure les devises nécessaires pour solder le service de la dette externe. L’inflation
s’accélère dans la foulée de l’émission de titres de dette interne, ceci à des taux d’intérêts
croissant au rythme de la dévaluation. L’emprunt par le Trésor public des devises aux mains
des exportateurs accélère au même rythme la concentration de la richesse : ceux qui n’ont pas
de pouvoir sur le marché – les salariés qui ne sont des faiseurs de prix que s’ils en ont la
capacité politique – voient leurs revenus réels diminuer ; même lorsque les grèves se
multiplient pour obtenir une récupération ex post de la perte de pouvoir d’achat engendrée par
ce qu’on a alors appelé l’impôt inflationniste.
Dans un second temps, le conflit distributif, après avoir été contourné par le régime monétaire
inflationniste, peut alors être neutralisé dans un environnement de stabilité des prix que
procurent les régimes de change fixe (ou de bandes de flottaison), associés à la concurrence
des produits importés2. Dans la foulée du retour de la croissance que permet la désinflation, la
politique de libéralisation des marchés est largement approuvée dans l’opinion publique. Les
effets distributifs de la désinflation conduisent à une envolée provisoire de la demande
interne, par ailleurs renforcée par celle du crédit à la consommation s’appuyant sur
l’endettement international des banques locales. La différence entre les taux d’intérêts interne
et externe garantit leurs profits. Mais la croissance creuse le déficit commercial qui conduit
alors à une convergence d’effets récessifs. La crise monétaire est, en quelque sorte,
l’anticipation qu’en font les opérateurs financiers.
L’inflation des années 80 n’a pas été, de façon générale, le fait d’un laxisme
budgétaire ou d’une dérive distributive face à la montée des grèves (même s’il existe des
exceptions), comme l’ont prétendu dans les années 80 les experts des organismes
internationaux en taxant les gouvernements latino-américains de populisme économique
(Dornbusch et Edwards, 1987 ; Sachs, 1990). La dérive inflationniste matérialise la
convergence des nouveaux impératifs comptables des banques internationales et des intérêts
des détenteurs de titres de la dette. Les banques doivent d’autant plus recouvrir désormais le
service de leurs créances que la concurrence se développe entre elles. L’exercice de la
souveraineté monétaire est, dans la foulée, délégué au FMI qui dirige dès lors la conduite de
la politique économique. Les acteurs et les arènes de décision de la nouvelle donne de la
gouvernance monétaire mondiale sont mis en place. Le plan Brady la consolidera dans la
relance de l’endettement, désormais nourri par le déficit commercial que provoque la
libéralisation économique.
Le déficit commercial commence à prendre un tour critique, faisant monter la prime
de risque des emprunts internationaux, ce qui renchérit le crédit à la consommation et les
coûts financiers des entreprises. La désinflation arrive par ailleurs à son terme et ses effets
positifs sur la demande interne disparaissent sans que l’essoufflement de cette dernière soit
relayé par un dynamisme des exportations suffisant pour tirer la croissance. La tendance à la
stagnation de la demande interne est en outre accentuée par le renouvellement des
équipements que favorise la surévaluation du change faisant suite à l’afflux massif de
capitaux, qu’il s’agisse d’investissements directs ou de portefeuille
3
. L’économie d’emploi
2
Pour une analyse détaillée voir Lo Vuolo et Marques-Pereira, 1999.
3
Les investissements directs s’orientent principalement sur les privatisations outre le rachat d’entreprises locales
qui ne sont pas compétitives face à l’aiguisement de la concurrence qu’engendre l’ouverture commerciale. Les
investissements de portefeuille sont favorisés par la libéralisation financière et leur expansion s’entretient d’elle-
même par la tendance à la hausse des cours de la bourse qu’ils provoquent et par la stabilité du change nominal
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%