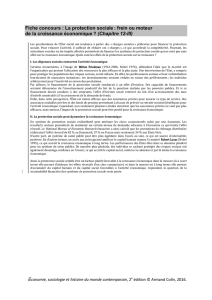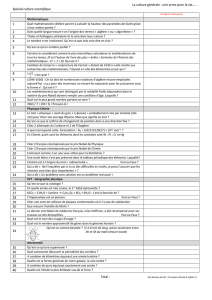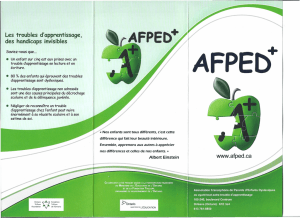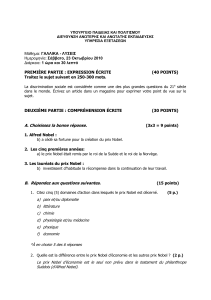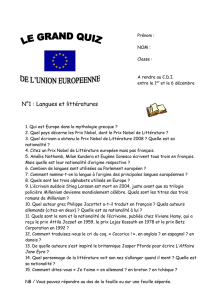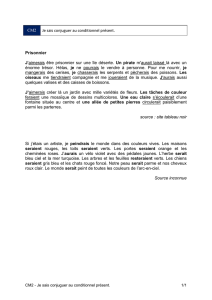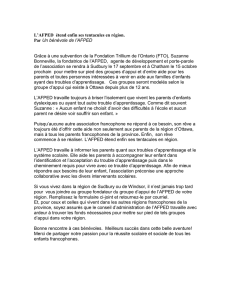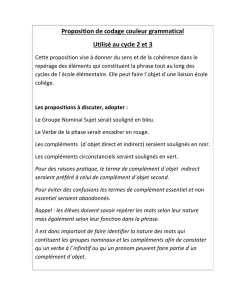Enjeux et conséquences de l`utilisation de l`anglais pour les études

1
Enjeuxetconséquencesdel’utilisationdel’anglaispourlesétudes
d’économieetdegestionàl’université1
19novembre2009
ProfesseurMarcChesney
UniversitédeZurich
DenombreusesUniversitésdepaysourégionsfrancophonessesont
orientéesversl’utilisationintensivedel’anglaisenparticulierpour
l’enseignementdel’économie,delagestionetdelafinance.La
recherchedanscesdomainessefaitpresqueexclusivementdans
cettelangue.Commentcechoixstratégiques’est‐ilopéré,quelsen
sontlesjustificationset...lesconséquences?L’objectifdecetarticle
estd’analyserl’étatdeslieux,puisdetenterd’apporterdesréponses
àcesquestions.Auparavant,ilconvientd’identifierbrièvementles
enjeuxglobaux.
Lesenjeuxglobaux
Ilexisteactuellementdanslemondeenvirontroismillions
d‘étudiantsétrangers.Cevolumevaprobablementêtreamenéà
s’accroitre.Ils’agitd’undomainestratégiquepourlesdifférentspays
concernés.Êtrecapabledelesattirerpermetàceux‐cidepouvoir
exercerunecertaineinfluencesurlafutureélite.Encequiconcerne
1Articleprésentélorsducolloquesur«LeFrançaisdansl’enseignementuniversitaireetlarecherche
scientifique»,organiséàl’UniversitédeGenèvele18mars2009.

2
laFrance,ildevraits’agirdedévelopperainsiauniveauinternational
uneélitefrancophileetfrancophoneetdepermettreauxétudiants
françaisenapprofondissantleursconnaissancesàl’étranger,de
trouveruntravailplusfacilement.
Etatdeslieux
Lestâchesprincipalesd’unprofesseursontcenséesêtrelarecherche
etl’enseignement.Quelrôlejouel’anglaisaujourd’huidanscesdeux
domaines?
Encequiconcernel’enseignementdansledomainedel’économieet
delagestion,lesinformationssuivantessontobtenuespourun
échantillonreprésentatifd’universitésréputéesd’Europe
continentale.Denombreuxprogrammesontcomplètementbasculé
versl’anglais.D’autres,sontsusceptiblesdelefaire,ousontbilingues.
Suruntotalde153Mastersrecensés2,44utilisentexclusivement
l’anglaiset31sontbilingues(anglaisainsiquelalanguenationale).
AuseindecetéchantillondeMasters,l’anglaisestainsidevenula
premièrelangued’enseignement,trèsloindevantlefrançaisou
l’allemandparexemplequidanscegroupeneseraientlalangue
exclusivequederespectivement10et11Masters.Lamême
tendanceestobservabledansunemoindremesure,danslesautres
domainesd’enseignement.LesaccordsdeBologneontaccentuéce
phénomène.
EnéconomieetFinance,lepassagedeslanguesd’Europe
continentaleversl’anglaisconcernesurtoutlesprogrammesde
Masteretdedoctorat,leBachelor,oulalicence,étantpourle
2Ils’agitdeMastersenéconomie,financeougestiond’universitéseuropéennesréputées.Sixpayssont
concernés:l’Allemagne,l’Autriche,l’Espagne,laFrance,l’ItalieetlaSuisse.EnFrance32Masterssont
répertoriés.Lalistedesuniversitésoudesgrandesécolesestlasuivante:laSorbonne,ParisXNanterreParis‐
Dauphine,Lyon1‐ClaudeBernard,Lyon3,HEC,etl’ESSEC.

3
momentpréservé.Cetteimpressionnantemontéeenpuissancede
l’utilisationdel’anglaisestsouventperçuepositivementdansle
mondeacadémique.Quelssontlesargumentsinvoqués?
1) Celafaciliteraitlesséjoursàl’étrangerpourlesétudiants,ainsi
quepourlesprofesseurs.
2) Celadonneraitauxprogrammesd’enseignementplusde
visibilitéetleurpermettraitdeseprofessionnaliser.
3) Desprogrammesdéveloppésconjointementparplusieurs
UniversitésenEurope,seraientsusceptiblesderecevoirune
aidefinancièredeBruxelles.Conjointementsignifiebiensuren
anglais.
4) Lechoixd’unelangueseraitneutre.N’influençantnilecontenu
del’enseignementnilamanièredeleprésenter,ilne
représenteraitdoncaucundanger.
5) Continuerd’enseignerdansleslangueslocalesseraitabsurde
carl’industriefinancièreetlesactivitéséconomiquesengénéral
requièrentl’utilisationdel’anglais.
D’autresargumentsmoinspolicéscirculent.Lesuniversitésquisont
capablesd’opérercebasculementlinguistiqueontunsavoirfaireque
lesautresnepossèdentpas.Cesdernièressontdoncenretard.
Untelbasculementgénèredessituationscocasses,pournepasdire
ridicules.Unprofesseurdelanguematernellefrançaisepeutainsi
êtreamenéàenseignerenanglaisfaceàunpublicconstitué
uniquementd’étudiantsfrancophones.
Dansledomainedelarecherche,latendanceestlamême.
Actuellement,l’évaluationdesprofesseursd’universitéestenvogue.
Celle‐cis’effectuesurlabasedelistederevuesscientifiquesclassées
leplussouvententroisgroupesenfonctiondeleursqualités
supposées.DanslegroupeA,setrouventlessoi‐disantmeilleures(ou

4
«top»).DanslegroupeB,apparaissentcellesquisontjugées
intéressantessansêtre«top».DanslegroupeC,ledernier,se
situentlesrevuesprésentéescommeétantpassables,cequileplus
souventestperçucommeuneuphémisme.Généralement,lesrevues
enlanguenonanglaisesontabsentesdesgroupesAetB.Pourquoi?
Ilseraittentantderépondre:parconstruction,siellesacceptentdes
articlesdansune«languelocale»,c’estjustementqu’ellessontde
mauvaisequalité!
Ilestdoncaujourd’huiquasimentimpossibledes’appuyersurdes
articlesdansuneautrelanguequel’anglaispoureffectuerune
carrièreuniversitaire.Lesarticlespubliésdansd’autreslanguessont
mêmeparfoismalperçus.Cequiestécritenanglais,àqualitéégale,
aaujourd’huiplusdepoidsquecequiestrédigéparexempleen
français.C’estunphénomènequiestconnudansledomaine
cinématographiqueparexemple.Lesstarsaméricainesnesontpas
intrinsèquementmeilleuresqueleseuropéennes,maisellesarrivent
às’imposeraudétrimentdeleursconsœurseuropéennes.
Leséditeursdeces«top‐journals»,sontleplussouventprofesseurs
auxEtats‐Unis.Ainsilescollèguesdespaysanglophonesjouissent
d’unavantagecertain,puisqued’unepartilsécriventdansleur
languematernelleetqued’autrepart,ilsdisposentd’unevéritable
proximitéavecceséditeurs.
Lescongrèsimportantsonteuxaussipourlaplupartadoptél’anglais
commeuniquelanguedeprésentation.Danslesannées1980,les
conférencesinternationalesorganiséesenFrance,dansledomaine
delafinanceparexemple,étaientsouventbilinguesavectraductions
simultanées.L’anglaiss’estrapidementimposé.Iln’étaitalorspas
rarederencontrerdescollèguesaméricainseux‐mêmesétonnés
d’untelbasculement,latraductionsimultanéeétantàleursyeux,
suffisante.Possédantquelquesconnaissancesenfrançais,ilsauraient
souhaitépouvoirlesutiliser.

5
Pourcertainsprofesseurs,responsablesdel’organisationdecongrès
internationaux,qualitéestsynonymed’utilisationdel’anglais.En
effet,commeonpeutl’entendre,cetterecherchedequalitépasse
parl’exclusiondetoutarticlesoumisenfrançais.Seulsceuxrédigés
enanglaissontsusceptiblesd’êtreretenus.Iln’estpasrarequeces
conférencessoientenpartiefinancéespardesfondspublicsd’origine
française.Unetelletendanceestconstatéeauniveauinternational.
Dessociétéslatino‐américainesorganisentdescongrèsoùles
collègueslusophoneethispanophoneserencontrent.Lalangue
officielleétantl’anglaisbienqu’àprioritrèspeudechercheurs
américainsneparticipentàcescongrès.
Sil’onconsidèrelesprixNobeld’économie,ilestintéressantde
constaterqu’en60ansenviron,seulunprixaétédécernéàun
francophoneaffiliéàuneuniversité(ougrandeécole)francophone.Il
s’agitdeMauriceAllaisen1988.Danslalistenousnetrouveronsque
5lauréatssur64,professeursdansuneuniversitédelanguenon‐
anglaise.C’est‐à‐direqu’approximativement92%deslauréatssont
affiliésàuneuniversitédelangueanglaiseetenviron86%àune
universitéaméricaine.
Ilestpeut‐êtrenaturelqu’ilensoitainsi.Celaneferaitquetraduirela
puissancedel’économieaméricaineetl’apportdeslauréatsdece
paysauprogrèséconomiqueetsocialinternational.Or,l’économie
américainenereprésentepas86%del’économiemondiale,mais
beaucoupmoins,environ25%(avantlacrise,en2007).Parailleurs,il
convientderemarquerquedeuxdeceslauréats(RobertMertonet
MyronScholes,nobélisésen1997)ontparlasuiteétéassociésàla
faillitedufondd’investissementLTCMen1998etque10d’entreeux
proviennentdel’UniversitédeChicagoconnuepourprônerla
dérégulationlaplusgrandepossiblepourlesmarchés,celle‐ciétant
unedescausesdelagravecrisedesannées2007et2008.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%