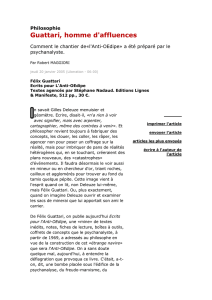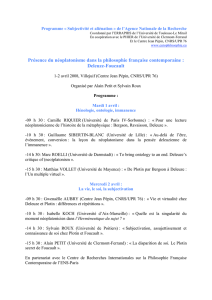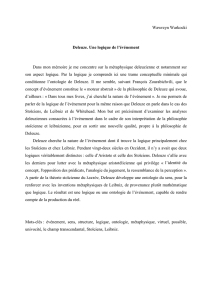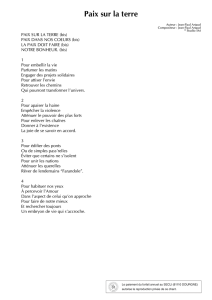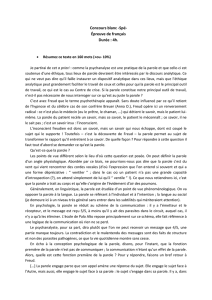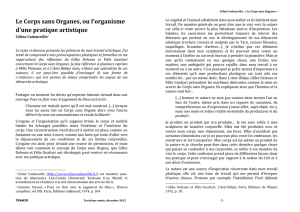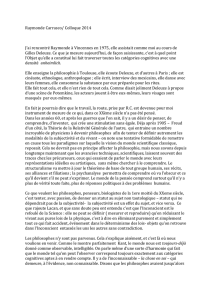Le problème du jugement et le Corps sans Organes

Faculté des Lettres
MEMOIRE DE LICENCE EN PHILOSOPHIE
Le problème du jugement et le Corps sans Organes
par
Mathias Clivaz
sous la direction de
Hugues Poltier
et
Michel Vanni
2007

2

3
TABLE DES MATIERES
I
NTRODUCTION
De la valeur d’un problème
5
P
REMIERE SECTION
Présentation d’Antonin Artaud
I.1. Entre vie et pensée
11
I.2. Le Pèse-Nerfs
17
I.3. Le théâtre et son double
21
I.4. Aliénation et magie noire
24
I.5. Le jugement de dieu
29
I.6. Le corps sans organes
35
D
EUXIEME SECTION
Psychanalyse du jugement
II.1. Raison, psyché et réalité
43
II.2. Economie de l’interprétation
47
II.3. La guerre des impondérables
55
II.3.1. Le refoulement originaire
57
II.3.2. Psycho-politique du sujet
61
II.4. La culture et la mort
64
T
ROISIEME SECTION
Philosophie du Corps sans Organes
III.1. La révolution moléculaire
77
III.1.1. Grégarité et corps pleins
79
III.1.2. Du Despote au Capital
85
III.1.3. Capitalisme et schizophrénie
89
III.2. La production du réel
93
III.2.1. Retour sur la tradition
94
III.2.2. Les machines désirantes
98
III.2.3. La production d’inconscient
102
III.4. Psycho-politique du Corps sans Organes
108
III.4.1. Danser avec l’adversaire
108
III.4.2. Le plan de consistance
114
III.4.3. Les quatre dangers du désir
118
III.5. Pour en finir avec le jugement
124
C
ONCLUSION
La pensée et le chaos
127
B
IBLIOGRAPHIE
131

4
P
REAMBULE
Dans l’introduction de leur dernier livre Qu’est-ce que la philosophie ?, Deleuze et
Guattari ont parlé de l’importance de ce qui n’est pas philosophique — et du lecteur non
philosophe — pour l’exercice philosophique lui-même. Tel que je l’ai expérimenté c’est
surtout une question de présence. Non pas tellement une présence à soi ou au monde, mais
une présence qui est le devenir-ensemble de soi et du monde, qui est l’affirmation d’un
devenir, sans but préalable, sans origine a posteriori. Une présence d’entre-deux, ou pour
mieux dire peut-être : une tension. Arc à double courbure, lorsqu’on le tend à l’envers jusqu’à
ce que ses deux extrémités se touchent à l’endroit où la main empoigne le bois. Et elle est là
dans l’effort, entre les yeux par où marche la matière, et elle est là dans la pensée, même
lorsque je ne la pense pas, toujours déjà là quand je la pense. L’effort de la pensée se produit
ainsi dans un présent déjà ouvert, quand l’exercice se confond avec cette ouverture et son
affirmation. Et l’écrit de ce mémoire de licence se donne d’emblée dans une telle ouverture,
comme un regard à travers lequel devenir autre que l’on était. La pensée se produit ainsi dans
un présent qui semble bien peu distinct de tous ces futurs où un lecteur me rencontrera,
comme si tous mes lecteurs futurs étaient là, à côté de l’écrit, à une ombre près qui en serait la
condition : celle que le regard porte lorsqu’il est vision, et non seulement lecture.
Si mon lecteur est présent, il me verra, déjà là si je suis présent, ma vision rejoignant
l’horizon où la vision de mon lecteur elle aussi sera réelle pour moi. Jusqu’à ce qu’on ne
sache plus si la philosophie avait commencé par être incompréhensible, ou bien si c’est
seulement là le résultat de tout ce qui s’est passé depuis que les hommes ont commencé à
penser… L’important, dirait-on, c’est que la philosophie ne se reconnaisse plus elle-même.
Non qu’elle commence par se devenir étrangère, mais comme s’il n’y avait que l’aveugle de
naissance pour voir, parce qu’il ne sait pas du tout ce que cela veut dire « voir ». L’important
ne serait pas que le philosophe se sache non-philosophe avant tout, parce qu’il saurait encore
quelque chose, après tout… Mais qu’il se constitue dans l’entre-deux où cela n’a plus aucune
importance d’« être philosophe ». Ce ne sera plus être ou devenir philosophe, mais se
déterminer dans l’être du devenir qui se moque éperdument de savoir ce que peut bien être un
philosophe. C’est ainsi qu’il y aura dans le jeu tout le sérieux de l’enfant, et dans les règles
facultatives qui auront été les siennes, peut-être, la part qui revient à l’académie et à la
philosophie comme discipline : tout d’abord, fais comme si tu ne savais pas où tu vas, ensuite,
une fois que tu y es, fais comme si tu savais où tu allais nous emmener, comme si tu l’avais
toujours su, même si pendant ce temps à nouveau tu ne sais plus très bien où tu vas, et à la fin,
quand ayant tout expliqué tu ne sauras vraiment plus rien, écrit l’introduction.

5
I
NTRODUCTION
De la valeur d’un problème
J’ajuste ces mots pour quatre personnes,
Quelques autres les entendront peut-être,
Ô monde, je suis navré pour toi :
Tu ne connais pas ces quatre personnes.
E
ZRA
P
OUND
,
1915.
1. Comment le philosophe et le non-philosophe seraient-ils, l’un et l’autre, l’un dans
l’autre, concernés par le problème du jugement ? Il me faut en donner les éléments et en
dégager les enjeux, comme s’il était possible de dire ce qu’est un tel problème. La philosophie
considérée comme discipline, essaye de dégager des vérités qui se diraient de l’être, par
l’expérimentation et par la pensée, des vérités qui doivent permettre de construire une action,
de stabiliser le chaos, d’entrer dans le devenir d’une manière qui exprime au mieux et ‘pour le
meilleur’ toute la puissance de l’être humain. La philosophie disciplinaire dit qu’elle voit des
problèmes et qu’elle a des solutions. Elle dit aussi qu’elle sait qu’elle ne sait pas tout, que
c’est même cela qui lui permet de savoir quelque chose, puisque elle a, dès Platon, appris à se
défier des ombres qui s’agitent dans les cavernes de l’opinion. Et depuis là, le jeu des
‘philosophes’ fut de dire qu’ils n’étaient pas les détenteurs du savoir, comme les anciens sages
prétendaient l’être, mais les amis/amants de la sagesse, Isis, Sophia. Mais c’est un amour
ambigu, une amitié problématique, surtout dès l’instant où l’on arrête de faire de la
philosophie pour se demander ce qu’elle est, lui donner un statut et l’inscrire dans une
hiérarchie des valeurs, au sommet de la pyramide des disciplines. Et dès le moment où le
philosophe se croit ainsi capable d’entreprendre la réalité humaine telle qu’elle est en vérité,
nous pourrons commencer à l’entendre dire ce qui est bien, ce qu’il faut et ne faut pas faire :
philosophe-conseil ou roi-philosophe, qui connaît la mesure de toutes choses et cherche à
convaincre les hommes de l’excellence de la règle que la Sagesse lui aurait découverte.
La Sagesse ne dit mot, elle laisse faire. Peut-être a-t-elle déjà abandonné celui vers qui, à
travers ses voiles nombreux, elle lançait jadis ses regards énigmatiques. Mais peut-être
n’avait-elle jamais été autrement qu’indifférente au sort de celui qui maintenant se détourne
d’elle, vers une idole qu’il nomme sa vérité, et en fonction de laquelle il juge les hommes,
leurs actions, leurs pensées, les encourageant à se juger les uns les autres de la même manière.
Le philosophe était-il redevenu un vieux sage ? Il se réclamait de la sagesse mais ne la
courtisait plus. Il avait quitté le plan de leur relation commune. Il en avait eu assez de courir le
monde et ses dangers, il était devenu sédentaire, avait construit un temple soutenu par des
colonnes qu’il avait nommées problèmes, et autour desquels il faisait sa publicité : “oui mes
amis, ce problème vous concerne vous aussi !” Ainsi avait-il tourné le dos au devenir, il avait
fait comme si la sagesse lui était acquise et, lassé de son désir, en avait résolu l’énigme.
Ce n’est pas une question d’espoir ni d’attente, mais d’amour : jusqu’à quand continuera-
t-on d’aimer tel ou tel de nos désirs ? Le philosophe en habit de philosophe continue de se
demander qu’est-ce que le désir ? et c’est un peu sa manière d’être au monde. Mais le
philosophe qui se met à nu demande : qu’est-ce que ce désir de connaître qu’est-ce que le
désir ? Ce qu’on appelle la ‘réflexivité’, c’est cette façon de réaliser que nous sommes en
train de voir, de désirer, de penser, c’est ce manque de pudeur... Le désir n’est-il pas ce qui
fait la vie même ? Et s’il est cela, désirer connaître ce qui fait la vie, n’est-ce pas seulement
une manière parmi le jeu complexe de tant d’autres de désirer et de vivre ? Le désir de la
connaissance : peut-être s’aveugle-t-il lui-même au soleil de son désir ? Ou ne devient-il pas
déjà autre chose que désir de connaissance dès l’instant où le désir devient un problème ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
1
/
134
100%