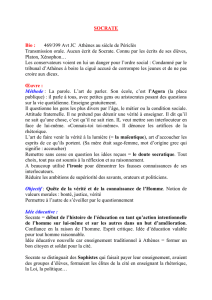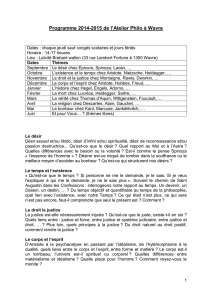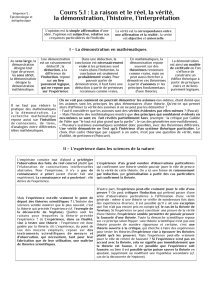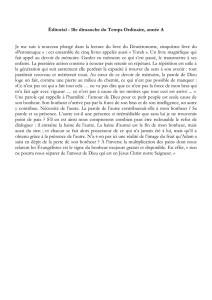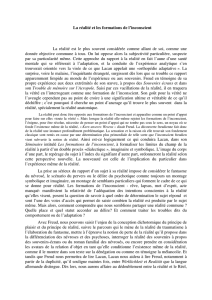1
Les Notions de philosophie
________________________
Réussir l’épreuve du bac
ϕ
Les Philosophes.fr

2
Préface
Vous passez le bac dans quelques mois, et vous voulez réussir votre épreuve de
philosophie ?
Il vous semble que vous manquez de connaissances sur telle ou telle notion au programme ?
Vous pensez que cela peut vous pénaliser et que vous n’arriverez jamais à rédiger une
dissertation satisfaisante le jour du bac ?
Pas de panique, vous êtes au bon endroit !
Vous trouverez ici l’essentiel de ce qu’il y a à savoir sur chaque notion au programme de
philosophie du bac.
Cela vous permettra de rédiger une belle dissertation le jour du bac, quel que soit le sujet.
Il vous suffit de repérer la notion qui vous intéresse dans la table des matières : un cours
vous récapitulera tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet, de manière claire et pédagogique.
Idéal pour vos révisions !
Cela vous donnera toutes les armes pour obtenir une bonne note au baccalauréat. Bon
travail !
Note : Vous remarquerez peut-être qu’un même texte est parfois utilisé pour plusieurs
notions. C’est normal : comme les notions se croisent, et ne sont pas indépendantes les unes
des autres, un même texte peut être utilisé pour des sujets différents.
C’est pratique, puisqu’il suffit de comprendre un texte pour pouvoir l’utiliser dans de
multiples occasions !

3
Table des matières
L’art .......................................................................................................................................................4
Le devoir ...............................................................................................................................................9
La justice ............................................................................................................................................ 13
La science ........................................................................................................................................... 19
Le travail ............................................................................................................................................ 23
Le bonheur ......................................................................................................................................... 28
L’Etat .................................................................................................................................................. 34
Le langage .......................................................................................................................................... 39
La raison ............................................................................................................................................. 44
La vérité ............................................................................................................................................. 49
La conscience ..................................................................................................................................... 54
L’inconscient ...................................................................................................................................... 60
La liberté ............................................................................................................................................ 66
La religion ........................................................................................................................................... 72
Le temps ............................................................................................................................................ 77

4
L’art
Sujet possible : L’art nous éloigne-t-il de la réalité ?
Lorsqu’on se trouve devant une œuvre d’art dans un musée, on rentre parfois dans une profonde
rêverie. Le monde réel autour de nous disparaît, et l’on se plonge dans le monde propre à l’œuvre
qui peut être angoissant, apaisant ou étrange.
Il semble donc que la contemplation esthétique nous éloigne de la réalité. Pourtant, on peut se
demander si au contraire, une œuvre d’art n’a pas pour fonction de nous révéler un aspect de la
réalité que nous n’aurions pas encore découvert.
La question se pose donc : une œuvre d’art nous fait-elle quitter, l’espace d’un instant le monde réel,
ou au contraire nous apprend-elle quelque chose de lui ?
L’art comme imitation de la nature – Aristote
On a tendance à considérer comme réussie une peinture qui ressemble au modèle original. Pline
l’Ancien relate avec admiration dans ses Histoires naturelles la prouesse de Zeuxis, un peintre grec
qui avait réussi à peindre des grappes de raisin si ressemblantes que des oiseaux se posaient dessus
pour les becqueter.
Zeuxis était lui-même fasciné par le modèle de l’imitation, puisque dans sa peinture, les raisins
étaient portés par un enfant, et il émit ce regret : « j’ai mieux peint les raisins que l’enfant; car si
j’eusse aussi bien réussi pour celui-ci, l’oiseau aurait dû avoir peur ».
Qui n’a pas été fasciné par une peinture en trompe-l’œil ? Il semble que ce soit là le point de
perfection de l’œuvre d’art, puisque si elle parvient à tromper l’œil humain, cela montre que l’œuvre
est aussi riche de nuances et aussi complexe que la réalité elle-même : l’artiste devient vis-à-vis de
l’œuvre l’égal de Dieu vis-à-vis de sa Création.
C’est ce qui amène Aristote à définir l’art comme imitation dans ce texte célèbre :
« À l’origine de l’art poétique dans son ensemble, il semble bien y avoir deux causes, toutes deux
naturelles. Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes, et ils se
différencient des autres animaux en ce qu’ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu’ils
commencent à apprendre à travers l’imitation » (la Poétique).
La seconde cause est le plaisir pris aux images (Aristote note qu’on prend plaisir aux représentations
dont l’original déplairait, comme la peinture d’un cadavre).
L’image, là aussi, est comprise comme l’imitation d’un modèle ; et Aristote soutient même qu’on
prend plus de plaisir à la vue de l’imitation que du modèle.

5
On voit donc qu’Aristote définit l’art comme imitation, et dans ce cas, l’art ne nous éloigne pas de la
réalité, mais au contraire vise celle-ci comme un idéal à atteindre. Le but de l’artiste n’est pas de
nous détourner du monde réel, mais de nous en rapprocher le plus possible.
Néanmoins, on peut remettre en question l’idée qu’imiter la nature serait nous rapprocher de la
réalité. L'imitation ne nous éloignerait-elle pas de la réalité ? Telle est la conception, surprenante,
défendue par Platon.
L’artiste nous éloigne de la réalité de trois degrés – Platon
On a jusqu’à présent retenu l’idée selon laquelle la « réalité » était le monde sensible, celui que nous
voyons. Dans ces conditions, il est logique de considérer que l’œuvre d’art qui imite le monde
sensible nous rapproche de la réalité.
Tout change si l’on considère, comme Platon, que la réalité n’est pas le monde sensible que nous
contemplons. Platon considère que le monde sensible n’est qu’une apparence, un simple reflet du
monde réel, le monde intelligible, ou monde des Idées.
Alors que les choses du monde sensible sont soumises au changement et sont donc caractérisées par
une forme dégradée d’être, les Idées du Monde intelligible sont éternelles : alors que les hommes
vieillissent et meurent, l’Idée de l’Homme en soi reste éternellement ce qu’elle est.
De plus les étants sensibles tirent leur être des Idées auxquelles ils participent : c’est en participant à
l’Idée d’Homme que Pierre est homme. Ou en participant à l’Idée de Bien qu’une action est bonne.
Les choses du monde sensible ne sont donc que des reflets, au sens où ils ne tirent pas leur être
d’eux-mêmes, mais de manière dérivée, en participant à ce qui est réellement : le monde intelligible.
Dans cette perspective, qu’est-ce qu’un artiste ?
En imitant le monde sensible, l’artiste imite un reflet, une apparence. En tant que reflet, le monde
sensible est en lui-même une copie, une imitation du vrai monde, intelligible. L’artiste imite… une
imitation ! Il nous éloigne donc de la vraie réalité de trois degrés, ainsi que l’explique Platon dans le
livre X de la République. Il distingue le Lit en soi, la vraie réalité, le menuisier qui imite le lit, et le
peintre qui imite l’imitation du lit :
« Et le menuisier ? Nous l'appellerons l'ouvrier du lit, n'est-ce pas ? G. - Oui.
S. - Et le peintre, le nommerons-nous l'ouvrier et le créateur de cet objet ? G. - Nullement.
S. - Qu'est-il donc, dis-moi, par rapport au lit ?
G. - Il me semble que le nom qui lui conviendrait le mieux est celui d'imitateur de ce dont les deux
autres sont les ouvriers.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
1
/
82
100%