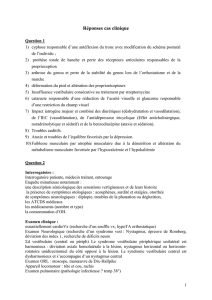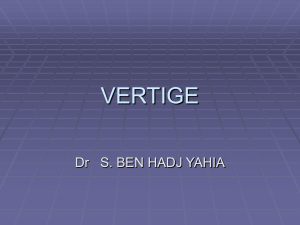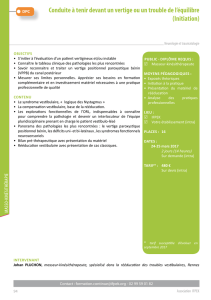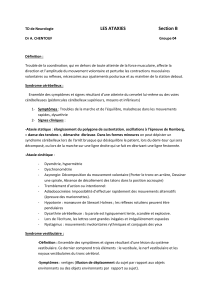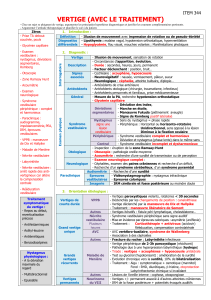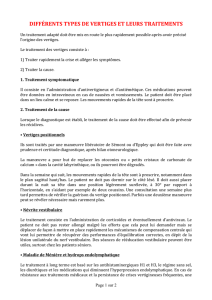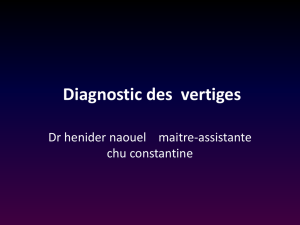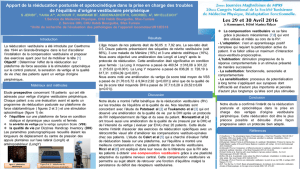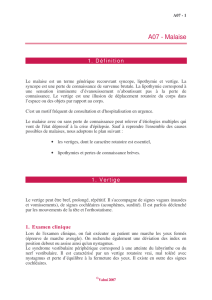Rééducation kinésithérapeutique vestibulaire : Cours complet
Telechargé par
ghitakine89

Rééducation
Kinésithérapeutique
de la
Fonction Vestibulaire
François DEBSI
masseur-kinésithérapeute -DU atteintes vestibulaires, troubles de l’équilibre- CH Le Mans
IFMK Rouen mai 2010

François DEBSI masseur-kinésithérapeute DU rééducation vestibulaire mai 2010
2
RÉÉDUCATION KINÉSITHÉRAPEUTIQUE DE LA FONCTION VESTIBULAIRE
A . Le système vestibulaire
A 1 . Le récepteur sensible 3
A 2 . Les noyaux vestibulaires et les intégrateurs 4
A 3 . Les afférences sensorielles et leurs suppléances 5
A 4 . Les efferences 5
A 5 . Le dysfonctionnement vestibulaire 5
A 6 . Mise en place d’une rééducation vestibulaire 6
B . Les bilans
B 1 . Introduction 7
B 2 . Les troubles perceptifs 7
B 3 . Les troubles oculaires 7
B 4 . Les troubles posturaux 8
B 5 . Les déficits influents 9
B 6 . Conclusion 9
C . La rééducation vestibulaire
C 1 . Préambule 10
C 2 . Les principes 10
C 3 . Les objectifs 10
C 4 . Les moyens 11
- Action préparatrice 11
- Travail de l’entrée vestibulaire 11
- Travail de l’entrée visuelle 15
- Travail de l’entrée posturale 16
- Conflit d’informations 17
- Education et prévention 18
D . Le traitement de rééducation adaptée aux pathologies
D 1 . Le syndrome pressionnel 18
D 2 . Le syndrome déficitaire 19
D 3 . L’atteinte mécanique intra vestibulaire (VPPB) 20
D 4 . L’ataxie 22
E . Conclusion
G . Questionnaire choix unique 26

François DEBSI masseur-kinésithérapeute DU rééducation vestibulaire mai 2010
3
RÉÉDUCATION KINÉSITHÉRAPEUTIQUE DE LA FONCTION VESTIBULAIRE
A . Le système vestibulaire
A 1 . Le récepteur sensible
L’appareil vestibulaire de l’oreille interne a la grosseur d’un pois. Il est situé dans la masse
pétreuse de l’os temporal.
Il est un des éléments essentiels de la fonction de l’équilibre (Flourens 1824; expérience sur des pigeons).
- c’est un capteur sensible aux mouvements (angulaires et linéaires) de la tête dans l’espace. La
stabilité de la posture est ainsi assurée ; l’équilibre dynamique est contrôlé..
On cite le terme de « propriocepteur céphalique ».
- c’est le point de départ de réflexes permettant l’équilibre en position statique. Seules les
statues sont immobiles, L’être humain ne l’est jamais.
- c’est le stabilisateur du regard qui, à partir du fonctionnement correct des extérorécepteurs
rétiniens, permet d’associer position et mouvement oculaire.
Le vestibule perçoit une accélération, l’œil un mouvement. « On va vers ce que l’on voit »
(Berthoz).
- c’est un organe influent sur le système végétatif.
Les organes de l'oreille interne de l'homme adulte d'après un dessin original (Max Brödel
Archives. Art Applied to Medecine. The Johns Hopkins School of Medecine)

François DEBSI masseur-kinésithérapeute DU rééducation vestibulaire mai 2010
4
A 2 . Les noyaux vestibulaires et les intégrateurs
* Les noyaux vestibulaires situés dans le tronc cérébral reçoivent :
- des influx excitateurs provenant des éléments du labyrinthe membraneux (canaux semi-
circulaires et macules) et de nombreuses afférences
- des influx inhibiteurs provenant du cervelet
Ils assurent un équilibre permettant un fonctionnement opportun des deux oreilles internes (effet
Ruttin)
Les noyaux vestibulaires sont le siège d’une zone relais importante où se centralisent les
interactions permettant une fonction vestibulaire symétrisée.
Les noyaux vestibulaires (Neurophysiologie Nathan Université – Québec)
* Le cortex analyse le déséquilibre,
asservit les systèmes parasites,
entreprend ou délègue l’action pour la rendre efficace et utile (cortex moteur,
cortex visuel, cortex vestibulaire…).
* Le cervelet contrôle l’activité perçue au noyau vestibulaire (archeocerebellum)
régit la posture statique (paleocerebellum)
assure le séquençage et la qualité du mouvement qu’il mémorise (neocerebellum).

François DEBSI masseur-kinésithérapeute DU rééducation vestibulaire mai 2010
5
* Les noyaux de la base permettent le lien entre le cortex associatif (idée du mouvement) et le
cortex moteur (exécution du mouvement). Leur rôle de programmation et de planification du
mouvement est possible grâce à un neurotransmetteur, la dopamine.
A 3 . Les afférences sensorielles et leurs suppléances
Les récepteurs qui influencent les noyaux vestibulaires proviennent :
- du cortex vestibulaire (zone pariéto-temporale) (1),
- de l’œil (information rétinienne),
- de la voie réticulée,
- des parties sensibles cutanées, articulaires, musculaires, viscérales (voies réflexes
proprio et extéroceptives transitant par la moëlle épinière).
De nombreux organes ont donc une relation intime avec le système vestibulaire pour parfaire
l’équilibre.
A 4 . Les efférences
Ce sont essentiellement :
- les muscles axiaux du tronc (surtout des rachis cervical et dorsal)
- les six muscles extrinsèques de chaque œil
- les add-abducteurs de la hanche
- le triceps sural, les muscles des arches plantaires, le grand fessier et le psoas.
A 5 . Le dysfonctionnement vestibulaire
Des voies réflexes mènent aux noyaux vestibulaires.
A chaque voie réflexe endommagée va correspondre un trouble particulier.
Schématiquement,
une atteinte de la voie vestibulo-corticale donne un vertige, (illusion de déplacement de
l’environnement dans les trois plans de l’espace) (2),
une atteinte de la voie vestibulo-oculaire donne un nystagmus, (mouvement involontaire
d’oscillations et/ou de rotations des globes oculaires),
une atteinte de la voie vestibulo-spinale donne une ataxie, (désordre morbide des fonctions
nerveuses caractérisé par le manque de coordination motrice des mouvements volontaires),
une atteinte de la voie vestibulo-réticulaire donne nausée et vomissement.
Il faut bien noter que ces symptômes surviennent aussi pour des pathologies étrangères à
l’atteinte du système vestibulaire :
. lipothymie, hypotension artérielle donnent des vertiges qui ne sont pas d’origine
vestibulaire,
. un voyage dans un train provoque un nystagmus ne prouvant pas l’atteinte vestibulaire (la
vitesse de la scène visuelle dépasse la vitesse du déplacement de l’image sur la rétine et nécessite
un « rattrapage » physiologique),
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%